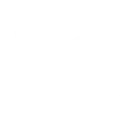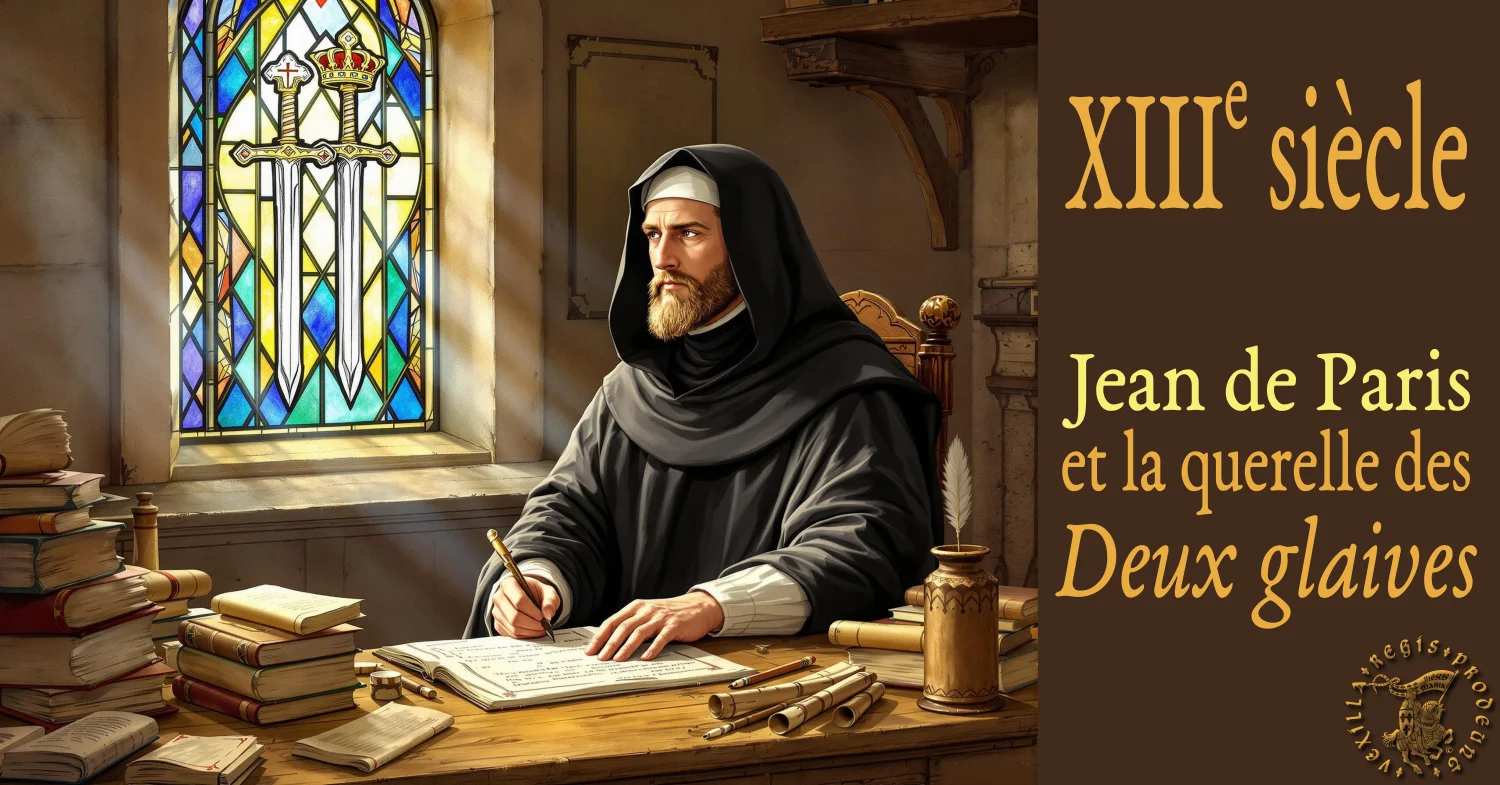Au XIIIe siècle éclate un conflit opposant Philippe le Bel à Boniface VIII : l’Église et l’État s’affrontent pour la suprématie. Dans ce climat de tension, Jean de Paris — théologien dominicain de l’Université de Paris, et disciple de saint Thomas d’Aquin — adopte une position rationnelle et équilibrée. À une époque où les Écritures sont souvent détournées pour servir les intérêts, il impose une lecture rigoureuse et contextuelle des textes sacrés, refusant les interprétations allégoriques et partisanes. Loin des excès des régaliens comme de ceux des théocrates, dans son traité De potestate regia et papali, il défend l’autonomie du glaive temporel du roi, tout en reconnaissant l’éminence du glaive spirituel du pape. En prônant la collaboration plutôt que la domination, Jean de Paris rappelle les bases de la Chrétienté : les autorités royales et pontificale doivent coexister harmonieusement, chacune dans leurs prérogatives au service du bien commun. [La Rédaction]
Table des matières
Introduction de Vive le Roy
Dom Jean Leclercq, O. S. B., Jean de Paris et l’ecclésiologie du XIIIe siècle, Chap. II « L’Écriture Sainte », Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1942, p. 42-51.
AVERTISSEMENT : Les sous-titres ont été ajoutés par la Rédaction pour faciliter la lecture en ligne.
Introduction
Jean de Paris a fréquemment recours à l’Écriture Sainte. Pour apprécier l’usage qu’il en fait, nous le comparerons à celui qu’en faisaient ses prédécesseurs et ses contemporains : bien plus que d’examiner chacun de leurs arguments en particulier, il nous importe de comparer les méthodes.
La méthode exégétique.
Les abus de l’allégorie chez les régaliens et les théocrates
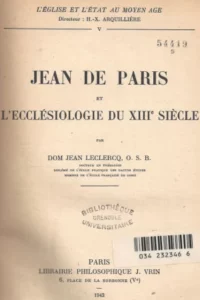
Régaliens et théocrates déployaient un zèle égal à scruter l’Écriture Sainte ; ils y apportaient aussi le même vice de méthode. Ce qu’ils cherchaient dans la Bible était moins une doctrine que la justification d’une doctrine puisée ailleurs. Le textes se refusaient-ils à favoriser leurs théories, il fallait les y plier : on demandait alors aux interprétations allégoriques les plus diverses les arguments que refusait le sens littéral.
Un tel procédé n’étonnait alors personne. Les écrivains politiques ne faisaient qu’adopter la méthode suivie depuis longtemps par les prédicateurs et les moralistes, toujours habiles à exploiter pour l’édification des fidèles les textes scripturaires que la technique du sermon médiéval les forçait à commenter1. Les exégètes de profession eux-mêmes n’échappaient pas à cette préoccupation allégorique ; plus soucieux d’exciter la volonté que d’éclairer l’intelligence, ils accordaient plus de prix au sens moral et mystique qu’au sens littéral2. Ils se contentaient d’ailleurs le plus souvent de répéter les exhortations des Pères de l’Église sans rechercher le sens exact des textes de l’Écriture.
Les controverses politiques posaient des questions précises ; elles donnaient l’occasion d’examiner les réponses précises qu’y apportaient les Livres Saints. Mais les intérêts mis en jeu par ces controverses entretenaient des préjugés et des passions, et celles-ci à leur tour déformaient les solutions qu’on ne savait pas demander aux textes avec la sérénité d’une recherche désintéressée. De là ces interprétations allégoriques tendancieuses qui, après avoir traversé tout le Moyen Âge, vinrent se heurter plus que jamais dans la polémique de la fin du XIIIe siècle. Celles des théocrates se retrouvent en grand nombre parmi les objections rapportées par Jean de Paris ; les défenseurs de Philippe le Bel rivalisaient d’ingéniosité sur ce terrain avec leurs adversaires, et l’Écriture Sainte, mise au service des passions en conflit, n’était qu’une source nouvelle de confusions.
La rigueur méthodologique de Jean de Paris
Quelle est, au milieu de tous ces abus, la méthode de Jean de Paris ? Non content de critiquer chacun des arguments en particulier, il s’attaque à la mentalité d’où procèdent ces explications arbitraires.
Pour remédier au manque d’objectivité qui rendait si commode l’argument allégorique, il a le souci du sens littéral. Il s’en tient à « ce qu’exprime le texte » 3. Il ne propose d’interprétation symbolique qu’après avoir épuisé les possibilités d’explication les plus réalistes4. Il aime à résumer brièvement le contexte dont une citation est isolée pour rendre à celle ci sa portée exacte5. S’agit-il de paroles importantes, il rappelle les circonstances dans lesquelles elles furent prononcées6. Il évoque l’intention de l’écrivain sacré, telle que la révèle le contexte, pour interpréter un texte à cette lumière7. Il sait analyser un texte pour en discerner tous les éléments8. S’il s’agit d’un passage des Évangiles synoptiques, il renvoie aux versets parallèles9.
De tels procédés étaient rares à son époque. Si Jean de Paris y reste fidèle au cours de tout son traité, c’est parce qu’ils correspondent chez lui à une conception précise de la valeur doctrinale de l’Écriture Sainte. Exposée en détail dans son Commentaire sur les Sentences10, cette conception est simplement résumée dans le De notestate regia et papali. Son principe fondamental est le suivant : seul le sens littéral d’un texte peut fournir un argument probant, à moins qu’un autre passage de la Bible n’autorise expressément l’interprétation allégorique de ce texte. Jean de Paris emprunte à saint Thomas ce principe qu’il énonce jusqu’à trois fois11 ; il s’y conforme avec exactitude, et s’il lui arrive de suggérer, lui aussi, un sens « moral », c’est qu’une « autorité » scripturaire lui en garantit le droit12.
Il interprète l’Écriture d’après elle-même. Mais il l’interprète en même temps à la lumière de la tradition. Jamais il n’invoque l’une sans l’autre. C’est l’Écriture entourée de ses gloses autorisées qu’il appelle « scriptura canonica » 13. Il demande toujours aux « saints commentateurs » la confirmation du sens obtenu par l’analyse philologique. Il n’utilise la Bible qu’avec une glose qui lui fournit la plupart de ses textes patristiques ; celle-ci est généralement la Glose ordinaire et interlinéaire, dont l’autorité était alors incontestée ; s’il s’en sépare pour adopter une autre de ces gloses si nombreuses au Moyen Âge, c’est sur des points sans importance. Il utilise aussi, bien que moins fréquemment, les Chaînes et les Commentaires de saint Thomas. Ces sources sont d’ailleurs traitées avec liberté : tantôt il leur emprunte de longues citations14, tantôt il se contente de les résumer, ce qui rend parfois impossible l’identification certaine du commentaire utilisé.
Ainsi, bien qu’il restitue à l’Écriture Sainte toute sa valeur d’argumentation, il se garde de voir en elle l’unique règle de la foi 15.
L’autorité de l’Ancien Testament.
Les
Le procédé qui consistait à demander à l’Ancien Testament la solution des problèmes posés par le Nouveau jouissait au Moyen Âge d’une grande faveur. Une telle recherche était légitime, à condition d’être poursuivie selon les normes établies par les Pères de l’Église et en particulier par saint Augustin.
Mais ces précautions de méthode, quand elles étaient connues, étaient rarement mises en pratique, et l’on se contentait de faire l’application à la vie de l’Église des institutions du peuple d’Israël et des événements de son histoire. On interprétait les deux Testaments l’un par l’autre par voie de simple transposition. On éclairait surtout le Nouveau par l’Ancien : la Nouvelle Alliance n’ayant fait que porter à leur perfection les ébauches qui la préparaient, on devait, pensait-on, retrouver dans l’Église du Christ tout ce qui avait existé sous la Loi et les Prophètes16.
De telles transpositions abondent dans les écrits du XIIIe siècle. Mais leur terrain d’élection semble avoir été la littérature politique. Les pontifes et les rois de l’Ancien Testament y sont proposés en exemple aux papes et aux princes chrétiens17 ; les relations qui existaient alors entre eux fournissent la norme de celles qui doivent se réaliser dans l’Église. Plusieurs théoriciens érigeaient en principe ce procédé d’argumentation18 et, selon leurs conceptions différentes de la dépendance à établir entre le Sacerdoce et l’Empire, imposaient à des textes identiques les interprétations les plus opposées19.
Il eût suffi, pour les concilier, d’utiliser avec discernement les textes de l’Ancien Testament. Les théologiens avaient su rappeler que la réalisation transcende parfois la figure et n’est pas toujours du même ordre qu’elle. Saint Bonaventure, par exemple, insistait sur la nécessité d’interpréter les textes selon leur sens propre20 ; lui-même avait soin, dans ses commentaires où l’allégorie occupe une si large place, de distinguer toujours le « sens spirituel » de « celui que montre la lettre »21.
Mais de tels conseils restaient lettre morte pour les écrivains emportés par les passions politiques : Gilles de Rome abusait de l’allégorie dans son De ecclesiastica potestate, alors que ses commentaires sur l’Écriture Sainte sont des modèles d’interprétation objective et littérale.
L’application faite à l’Église des institutions du peuple élu s’était vu ramener par les théologiens à de justes limites : si les prêtres de l’Ancien Testament jouissaient du pouvoir temporel, celui-ci était la figure de la juridiction spirituelle que possèdent désormais le pape et les évêques ; on ne peut donc appliquer sans réserve à ces derniers ce que l’Écriture nous dit d’Aaron et de Melchisédech 22.
La méthode de Jean de Paris
Plus que les autres, les théocrates restaient rebelles à ces normes d’interprétation, pourtant si traditionnelles. Les régaliens allaient assumer la mission de réagir sur ce point : certains d’entre eux allaient renvoyer leurs adversaires au sens littéral, seul valable dans l’argumentation23, et Pierre Dubois se ferait l’écho des grands Docteurs de l’École pour réfuter le parallélisme établi par les théocrates entre l’Ancien et le Nouveau Testament24 : au nom de principes légitimes, il allait formuler, lui aussi, en faveur de Philippe le Bel, des revendications excessives.
Ici encore, Jean de Paris revient à la saine méthode et l’applique avec mesure. Persuadé que l’Ancien Testament n’était que la figure et la préparation du Nouveau25, il demande au Nouveau la clef de l’Ancien. Il recherche d’abord le sens historique. Pour l’établir, il sait confronter au besoin plusieurs chronologies26. Puisque les institutions du peuple élu ont subi une évolution au cours de son histoire, il est nécessaire d’interpréter les textes d’après l’époque à laquelle ils ont été écrits : il faut en déterminer le sens historique d’après les circonstances qui les expliquent, en confronter les termes avec ceux des textes qui les éclairent27, et connaître aussi les conditions psychologiques toutes particulières du peuple juif 28.
Le sens historique une fois établi, Jean de Paris se garde d’en dégager sans précautions les lois de la vie actuelle de l’Église. D’une part, il n’oublie pas les privilèges exceptionnels qu’entraînaient pour Israël son élection et l’alliance divine29 : les prescriptions portées pour ce peuple ne sont pas nécessairement valables pour d’autres peuples, même chrétiens 30. D’autre part, les livres de l’Ancien Testament contiennent des prophéties et des figures du Messie : de tels textes ne peuvent être accomplis que depuis l’avènement du Christ et doivent être entendus de lui seul31. De l’Ancien au Nouveau Testament s’est effectué le passage de la figure à la réalité et du moins parfait au plus parfait32. Le sens d’une même institution peut donc avoir été sous l’Ancienne Loi différent de celui qu’elle doit revêtir dans l’Église33.
Si Jean de Paris réduit ainsi l’importance attribuée à l’Ancien Testament en matière de doctrine politique, il ne sacrifie rien de la valeur du texte sacré ; il lui restitue au contraire son véritable sens et se rapproche en cela de la tradition catholique et des plus grands Docteurs de son siècle.
L’argument des deux glaives.
Le débat politique et ses enjeux
Un exemple entre bien d’autres permettra d’apprécier l’originalité de Jean de Paris en matière d’interprétation scripturaire.
On sait que, depuis saint Bernard, les deux glaives dont il est parlé en l’Évangile de saint Luc (XXII, 38) désignaient fréquemment le pouvoir séculier et le pouvoir ecclésiastique. La même allégorie était invoquée à l’appui des théories les plus opposées concernant les rapports de ces deux pouvoirs34. Nul doute que l’Église ne possède le glaive de la juridiction spirituelle. Possède-t-elle aussi celui de la juridiction temporelle, à charge d’en confier l’exercice au prince séculier ? L’affirmer, c’était faire dépendre le pouvoir séculier du pouvoir ecclésiastique comme de sa cause35.
Les théocrates n’hésitaient pas devant cette conséquence : ils ajoutaient d’ailleurs que l’Église se réservait en certain cas l’usage direct du glaive de la juridiction temporelle. Les régaliens s’inscrivaient contre de telles assertions. Pour établir leur thèse sur l’autorité du texte de saint Luc, les uns et les autres avaient recours aux interprétations allégoriques les plus subtiles ; conscients de ce qu’un tel procédé présentait d’artificiel, ils éprouvaient le besoin de s’en excuser : ils arguaient alors de l’impossibilité de trouver à ce texte un sens littéral satisfaisant36.
Sans doute quelques adversaires de la théocratie suggéraient-ils des explications plus réalistes37 : leur exemple n’était pas suivi. Loin de nier que le sens allégorique fut légitime, la plupart des théoriciens politiques s’efforçaient de le tourner à leur avantage.
L’interprétation de Jean de Paris
Si l’on admettait communément que ce texte dût avoir un sens mystique, les écrivains que ne dominait aucune préoccupation allégorique ne croyaient pas devoir appliquer ce sens à la théorie des deux pouvoirs. Les glossateurs les plus autorisés de l’Écriture n’y faisaient aucune allusion en expliquant ce verset38.
Les commentateurs de Pierre Lombard se bornaient à voir dans le glaive spirituel la sentence d’excommunication et dans le glaive matériel la peine de mort infligée en cas d’adultère, sans que le problème politique fût même soulevé39. À leurs yeux, revendiquer pour l’Église le glaive matériel était lui garantir le droit d’infliger des peines corporelles : droit de cœrcition matérielle sur des individus, non d’intervention dans le gouvernement des États.
Parmi les interprétations allégoriques auxquelles donnait lieu le glaive attribué à l’Église, il en était une qui pouvait se prévaloir d’une antiquité et d’une diffusion exceptionnelles. Jean de Paris allait l’adopter en pleine conformité avec les principes qu’il avait posés : il existait, en effet, une « autorité manifeste » qui donnait, à son avis, la clef du problème posé par le texte de saint Luc. C’était le verset de l’Épître de saint Paul aux Éphésiens où « le glaive de l’esprit » est identifié à « la parole de Dieu »40. Tel est, dit Jean de Paris, le glaive de l’Église41. Sans doute propose-t-il du texte de saint Luc d’autres explications possibles et toutes conciliables avec l’indépendance du pouvoir temporel42. Mais il revient avec prédilection à cette explication du glaive spirituel par la « parole de Dieu ».
Ce n’était pas là une innovation. Cette interprétation pouvait se prévaloir d’une longue tradition. Elle était particulièrement chère aux écrivains dominicains. Selon une formule qu’on retrouve dans toutes les Légendes de la vie de saint Dominique, les Prêcheurs n’avaient-ils pas été fondés pour « réfuter par le glaive de la parole les hérétiques que le glaive matériel ne pouvait vaincre »43 ? Insinuée par saint Bernard lui-même44, cette interprétation du glaive spirituel par la parole de Dieu avait été reprise par Moneta de Crémone45, et confirmée par l’autorité de saint Thomas46.
Récuser l’interprétation théocratique des deux glaives n’était donc pas pour Jean de Paris rompre avec une tradition vénérable ; c’était en renouer une autre, aussi ancienne et plus solidement fondée, et qui présentait en outre l’avantage de se concilier avec les principes traditionnels énoncés par saint Thomas au sujet du sens spirituel de l’Écriture. À la lumière de ces principes, le glaive de l’Église ne désignait plus sa juridiction, mais son magistère.
Fort de cette explication, Jean de Paris allait revenir sur l’argument des deux glaives plus souvent que sur aucun autre47. Non qu’il faille voir dans cette allégorie une pièce maîtresse de son raisonnement : celui-ci se fonde sur les données immédiates de la révélation et de la philosophie. Mais l’argument des deux glaives existait : Jean de Paris ne pouvait le méconnaître. Il consent à donner au texte de saint Luc un sens allégorique, à condition toutefois qu’il soit conforme aux lois de l’herméneutique. Ayant ainsi restreint la portée de ce texte, il en tire avec une logique hardie et sûre les conséquences qui favorisent sa thèse : le pape possède le glaive de la prédication ; qu’il instruise donc les fidèles, et, parmi eux, les rois. Les rois, de leur côté, possèdent le glaive matériel ; ils peuvent en user, même contre le pape, si celui-ci nuit aux intérêts temporels du royaume48. Normalement, cependant, les deux glaives doivent collaborer au bien commun intégral, naturel et surnaturel, des États49.
Conclusion : Une
Comme on a pu le voir, les théoriciens politiques se transmettaient des arguments allégoriques sans en contrôler les fondements. L’esprit de parti empêchait qu’on déployât dans la polémique les mêmes rigueurs de méthode que dans les exposés théologiques : à propos, des mêmes textes s’opposaient les interprétations allégoriques les plus opposées. Le seul moyen de mettre fin à ces joutes stériles était de revenir au sens imposé par les textes eux-mêmes. Telle est l’œuvre de Jean de Paris : à toute allégorie, il préfère le sens littéral ou le sens spirituel qu’il croit authentique, et si son interprétation ne concorde pas toujours avec celle de l’exégèse moderne, du moins apporte-t-il dans la polémique des qualités de théologien.
- Les interprétations allégoriques de l’Écriture abondent, par exemple, dans les Sermons universitaires parisiens de 1230-1231, édités par M.-M. Davy, Paris 1931, ou dans les sermons de Jean Halgrin (+ 1237), édités sous le nom de S. Antoine de Padoue dans Bibliotheca patristica Medii-Aevi, 1880, t. I, col. 576 et suiv. Les règles étroites auxquelles était soumise l’allégorie dans la rhétorique médiévale concernaient plutôt les procédés d’exposition que l’interprétation elle– même, cf. E. Gilson, Michel Menot et la technique du sermon médiéval, et De quelques raisonnements scripturaires usités au Moyen Âge, dans Les idées et les lettres, Paris, 1932, p. 93-169.↩
- Hugues de Saint-Gher, O. P. (t 1263), par exemple, attribue une large place aux interprétations allégoriques dans ses commentaires sur l’Écriture, éd. Venise 1754. Cette prédilection pour l’allégorie est justifiée spéculativement par Pierre-Jean d’Olieu, O. F. M., De S. Scripturæ mysterio, édité dans Bonelli, Prodromus ad opera omnia S. Bonaventuræ, Bassano 1757, t. I, col. 284-347, et De S. Scripturæ dignitate, ibid., t. II, col. 1054-1115.↩
- Hoc non est affirmandum cum non inveniatur expressum, 195, 17 ; littera Apostoli hoc ostendit, 226, 33 ; non dicit : papæ, sed : Dei, 199 ; non : cum, sed : si 201, 11-12.↩
- Telle, par exemple, l’explication donnée 191, 1-3 à l’incident des porcs, rapporté par S. Matthieu, vii, 30-33. Telle encore l’interprétation réaliste donnée (218, 27-34) à l’argument théocratique tiré des deux luminaires : Jean de Paris se contente d’appliquer au texte de la Genèse I,16, une donnée cosmologique communément admise de son temps, cf. S. Thomas, De Cælo et mundo, 1. II, c. viii, lect. X, éd. Léonine, t. III, Rome 1886, p. 159, et Meteorologicorum, II, lect. I, n. 7, ibid., p. 388. Jean de Paris avait lui-même exposé longuement dans son commentaire sur les Sentences, ms. Mazar. 889, fol.49, G-D, la théorie cosmologique dont il fait ici l’application. On voit combien une interprétation aussi réaliste s’éloigne du symbolisme profond attribué par le haut Moyen Âge, sous l’influence surtout de Byzance, à ces allégories cosmologiques, cf. F. Kampers, Vom Werdegange der abendländlichen Kaisermystik, Leipzig 1924, p. 8-9.↩
- De rege et principe, 199, 17 ; de même 218, 14.↩
- 208, 32-209, 32 ; 192, 16-25.↩
- Secundum intentionem B. Petri, 228, 26 ; de même 230, 1 ; 200, 33-36.↩
- 209, 15-27.↩
- 211, 16. On voit que, parmi les écrivains politiques, Jean de Paris avait devancé Marsile de Padoue dans la voie de l’exégèse littérale. L’originalité attribuée en cette matière à Marsile de Padoue par G. de Lagarde, Marsile de Padoue ou le premier théoricien de l’état laïque, Vienne 1934, p. 73-77, s’en trouve restreinte.↩
- Ms. Mazar.889, fol. 1, B. Jean de Paris y renvoie explicitement à S. Thomas, Sum. Theol., I, q. 1, a. 10.↩
- 218, 18-21 ; 232, 2-6 ; 235, 17-20 ; cf. S. Thomas, In Sent. I, Prolog. q. 1, art. 5, c, t. VI, p. 9 ; Sum. Theol., I, q. l,a. 10, ad. 1. Cet argument était emprunté aux traductions latines du Pseudo-Denis. Cf. J. Lecler, L’argument des deux glaives, R. S. R., XXIII (1932), p. 152-154. À S. Thomas aussi Jean de Paris emprunte l’une de ses autres règles d’interprétation de l’Écriture, 226,14, cf. S. Thomas, In Psalmum XLIV, n. 5, t. XIV, p. 323 ; In Evangelium Matthæi, c. XXVIII, t. X, p. 277 ; Sum. Theol., III, q. 13, a. 2, ad. 1.↩
- 235, 20-35. Lorsqu’il s’agit non plus d’argumenter, mais de prêcher, Jean de Paris sait faire appel à l’allégorie, autant que les prédicateurs de son temps, comme en témoignent ses Sermons, conservés dans le ms. Nat. Lat., 3557, fol. 63-267. Nous avons édité l’un de ces sermons dans La vie spirituelle, t. LVII (1938), p. 293-300.↩
- 199, 16 ; 200, 20.↩
- La réponse à l’argument 22 des théocrates (226, 11-34) par exemple, est empruntée intégralement à la Glose ordinaire et interlinéaire, Biblia Sacra, éd. Anvers 1634, t. VI, p. 213-214.↩
- C’est donc arbitrairement qu’un « radicalisme rationaliste » est attribué à Jean de Paris par H. Kæmpf, Pierre Dubois und die geistigen Grundlagen des französischen Nationalbewusstseins um 1300, Leipzig 1935, p. 58. Jean de Paris, il est vrai, écrira vers la fin de son traité que l’Écriture sainte est la « règle de foi » 242, 34 : il s’agit dans ce texte non d’interpréter le sens de l’Écriture, mais d’ajouter de nouvelles vérités de foi à celles que contient l’Écriture. L’opinion de Jean de Paris sur ce point est influencée par ses tendances aux théories conciliaires (voir plus bas troisième partie, ch. iv, p. 127), non par la conception de l’Écriture comme unique règle de foi, telle que la formuleront Marsile de Padoue et les Réformateurs. Jean de Paris prouve d’ailleurs cette même assertion par l’autorité de la tradition. Ailleurs, il montre que cette assertion ne vise pas seulement le contenu de l’Écriture, mais aussi celui de la tradition : esset contra Scripturam et communem doctrinam, 250, 15.↩
- L’opposition, au dualisme sans cesse menaçant (voir plus bas, troisième partie, ch. III, p. 108-110) incitait à cette assimilation des deux Testaments l’un à l’autre. Contre les cathares on avait été amené à défendre l’autorité de l’Ancien Testament et parfois à l’exagérer ; à la séparation qu’établissaient les « nouveaux manichéens » entre les deux Testaments, on opposait une continuité qui prenait figure, chez certains écrivains, de véritable identité. Joachim de Flore de son côté n’attribuait à l’Ancien Testament qu’une valeur purement symbolique, ainsi qu’en témoigne le résumé donné de ses erreurs par Eudes de Chateauroux en 1255, éd. Denifle, A. L. K. G., I, p. 107. Contre une telle conception, on se plaisait moins à insister sur le sens historique de l’Ancien Testament qu’à montrer dans le Nouveau sa réalisation historique et littérale : nouvel écueil que tous n’évitaient pas.↩
- Jean Peckham, par exemple, explique la juridiction de l’Église romaine par le pouvoir que possédait Moïse, Questio de paupertate, éd. L. Oliger, O. F. M., dans Franziskanische Studien, 1917, p. 146. Frédéric II en avait appelé à David comme à « son prédécesseur », Huillard-Bréholles, Hisloria diplomatica Frédéric II, Paris 1852, t. IV, p. 528. Humbert de Romans fait des rapprochements analogues, Opus tripartitum, Ip.,c.2 1, éd. Brown, Appendice ad fasciculum rerum expetendarum, Londres 1690, t. II, p. 201-203.↩
- Ex scriptura Veteris Testamenti, cujus actus et opera Ecclesia imitatur quia quæcumque in ea scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt, Determinatio compendiosa, éd. R. Kbammer, p. 12 ; cf. Rom. xv, 5. Dans le même sens Gilles de Rome, De ecclesiaslica polestale, éd. E Scholz, p. 55 ; Adam de Marsh, O. F. M., Epistolæ, éd. Brewer, Monumenta franciscana, I (1858), p. 484.↩
- L’auteur du traité Rex pacifîcus soutient que les rois ont existé avant les prêtres dans l’Ancien Testament, éd. P. Dupuy, Histoire du différend, p. 671. Le Card. Jean Lemoine soutient la thèse contraire dans sa glose de la bulle Unam Sanctam éd. Corpus juris canonici, Lyon 1549, t. III, col. 11. De même, Tolomeo de Lucques, continuation du De regimine principum de S. Thomas, t. XVI, p. 248-249. Ce genre d’argumentation par l’Ancien Testament est particulièrement fréquent chez Gilles de Rome, éd. R. Scholz, p. 21, 27, 102 et passim.↩
- Attendat autem expositor quod non ubique repetenda est allegoria, nec omnia sunt mystice exponenda, Breviloquium, Prologus, éd. Quaracchi, t. V, p. 207– 208.↩
- In Lucam, XX, 43, éd. Quaracchi, t. VII, p. 517, n. 49.↩
- S. Albert le Grand, In Sent. IV, d. 18, a. 14, ad. 13, éd. Paris 1894, t. XXIX, p. 789 ; Alexandre de Hales, Summa theologica, III p., q. 40, membr. V, éd. Venise 1575, fol. I59v ; Henri de Gand, Quodlibet IV, q. 28, éd. Venise 1613, fol. 213 ; Richard de Menneville, In Sent. II, d. 44, q. 2, a. 3, éd. Brescia 1591, p. 532.↩
- Tractatus de clerico et milite, éd. R. Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen, p. 484-485 ; Dante, De monarchia, 1. III, c. 3, éd. Florence 1921, p. 383.↩
- Summaria brevis, éd. H. Kæmpf, p. 11 ; Pierre Dubois prouve son assertion par l’autorité d’Averroès. De même p. 52.↩
- L’Ancien Testament n’est donc pas pour Jean de Paris « purement allégorique, sans réalité », comme le prétend K. Burdach, Vom Mittelalter zur Reformation, Berlin 1913, t. II, p. 553. Il est « figuratif » au sens précis que revêt ce mot dans la tradition théologique.↩
- 182, 6-183,25. La source de ce passage est Pierre le Mangeur, Ristoria scholastica, liber Genesis,c.40, suiv.. P.L.,t. 198, col. 1090, complété de quelques autres chronologies. Le goût de Jean de Paris pour les chronologies apparaît dans son traité De antichristo, ms. Laon 275, fol. 9 et suiv.↩
- 215, 11-6 ; 217, 34.↩
- 236, 25.↩
- 229, 9 ; 236, 25 33.↩
- 232, 29.↩
- Et in persona Christi dicit in Psalmo : Accingere gladium tuum, 232, 29. Comparer S. Thomas, In Psalmos, Prœmium, t. XIV, p. 149.↩
- 195, 34 ; 233, 17-35.↩
- 185, 5-8. Au ch. XIII, 215, 15, Jean de Paris applique à la déposition du pape un exemple tiré du IVe Livre des Rois, c. XXII. Il ne donne à cet exemple que la valeur d’un confirmatur historique, non celle d’un argument spéculatif absolument probant.↩
- De nombreux textes ont été rassemblés et analysés avec pénétration par J. Lecler, L’argument des deux glaives dans les controverses politiques du Moyen Âge : ses origines et son développement, R. S. R., t. XXI (1931), p. 299-339, et t. XXII (1932), pp.151-177 et 280-303. Nous n’utiliserons, en général, que des textes non indiqués par cet auteur.↩
- Materialem gladium causam habere a spirituali : Conjuncti enim sunt isti duo gladii ut alter non possit esse sine alio. Ünde Dominus : Ecce duo gladii hic, quasi simul conjuncti. Sed materialis a spirituali est, Simon de Tournai, Dispuiationes, disp. 82, q. 4, éd. J. Warichez, Louvain 1932, p. 239. Chez Godefroid de Fontaines, Quodlibet XIII, q. 5, éd. H. Hoffmanns, Louvain 1935, p. 288, l’argument des deux glaives sert à prouver que le pape possède sur tous les biens temporels sans exception « l’autorité première et radicale » ; cf. Tractatus contra græcos (anonyme, 1252), éd. H. Canisius-J. Basnage, Thesaurus Monumentorum, Anvers 1725, t. IV, p. 78. Parmi les questions quodlibétales inédites du XIIIe siècle dans lesquelles l’argument des deux glaives est invoqué, indiquons Eustache de Grandcourt, Quodlibet, q. 104, ms. Nat. Lat. 15850, fol. 37 A ; Gérard d’Abbeville, Quodlibet V, q. 3., ms. Vat. Lat. 1015, fol. 64, A-G, Nat. Lat. 16405, fol. 54, C-D.↩
- Quod quidem scriptum nihil esset… Ergo videtur quod Christus hoc tantum dixerit mystice. Quodlibet I attribué à Pierre Jean d’Olieu, q. 18, éd. Venise 1509, fol. 9. Dans le même sens, un peu plus tard, Panormitanus, ln Decretales, II, tit. II, cap. 13, Novit, éd. Venise 1578, fol. 40 v. Voir plus bas, deuxième partie, chapitre v, p. 67.↩
- Par exemple dans le même Quodlibet attribué à Pierre-Jean d’Olieu, ibid., les deux glaives auraient été destinés à couper le pain et la viande au cours de la dernière cène.↩
- Hugues de Saint-Cher, In Lucam, XXII, 38, éd. Venise 1754, t. VI, fol. 263 ; de même in Johannem, XVIII, 11, ibid., fol. 389 ; cf. S. Bonaventure, In Lucam, XXII, 50, éd. Ouaracchi, t. VII, p. 566, n. 4. Le Commentaire anonyme sur l’Apocalypse édité parmi les œuvres de S. Thomas, t. XXIII, pp. 341-489, 692, donne au glaive spirituel plusieurs sens dont aucun ne comporte d’allusion au pouvoir politique.↩
- S. Thomas, In Sent. IV, d. 37, expos, textus, t.VII, p. 1001. Hannibald de Hannibaldis, In Sent. II, d. 37, q. l, a1. 4, ad. 1, édité parmi les œuvres de S. Thomas, t. XXII, p. 403. Dans le même sens, Pierre de Tarentaise, Quodlibet, éd. P. Glorieux, R. T. A. M., t. IX (1937), p. 245.↩
- Ephes, VI, 17.↩
- 232, 6-18.↩
- 232, 18-35.↩
- Monumenta historica S. Patris nostri Dominici, fasc. II, éd. M. H. Laurent, O. P., dans Monuments. Ordinis Prædicatorum, t. XVI (1935), p. 22 (légende de Pierre Ferrand), p. 331 (légende de Constantin d’Orvieto), p. 384 (légende d’Humbert de Romans). Cf. Tractatus de approbations Ordinis Fratrum Prædicatorum, éd. Th. Kæppeli, dans Archivum Fratrum. Prædicatorum, t. VI (1936), p. 158.↩
- De consideratione, 1. Il, c. 6, n. 13, P. L., t. 182, col, 749, cité par Jean de Paris.↩
- Gladius enim materialis juvat spiritualem, id est prædicationem, Lucas XXII : Ecce duo gladii hic. Âdversus catharros et valdenses, éd. Rome, 1743, p. 522.↩
- Lectura Johannem, c. 18, lect. II, t. X, p. 604 ; In Psalm XLIX, n. 3, t. XIV, p. 321.↩
- 196, 8 ; 198, 1 ; 199, 18 ; 210, 22.↩
- 239, 21-24 ; 242, 30 ; 250, 31.↩
- 215, 25.↩