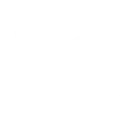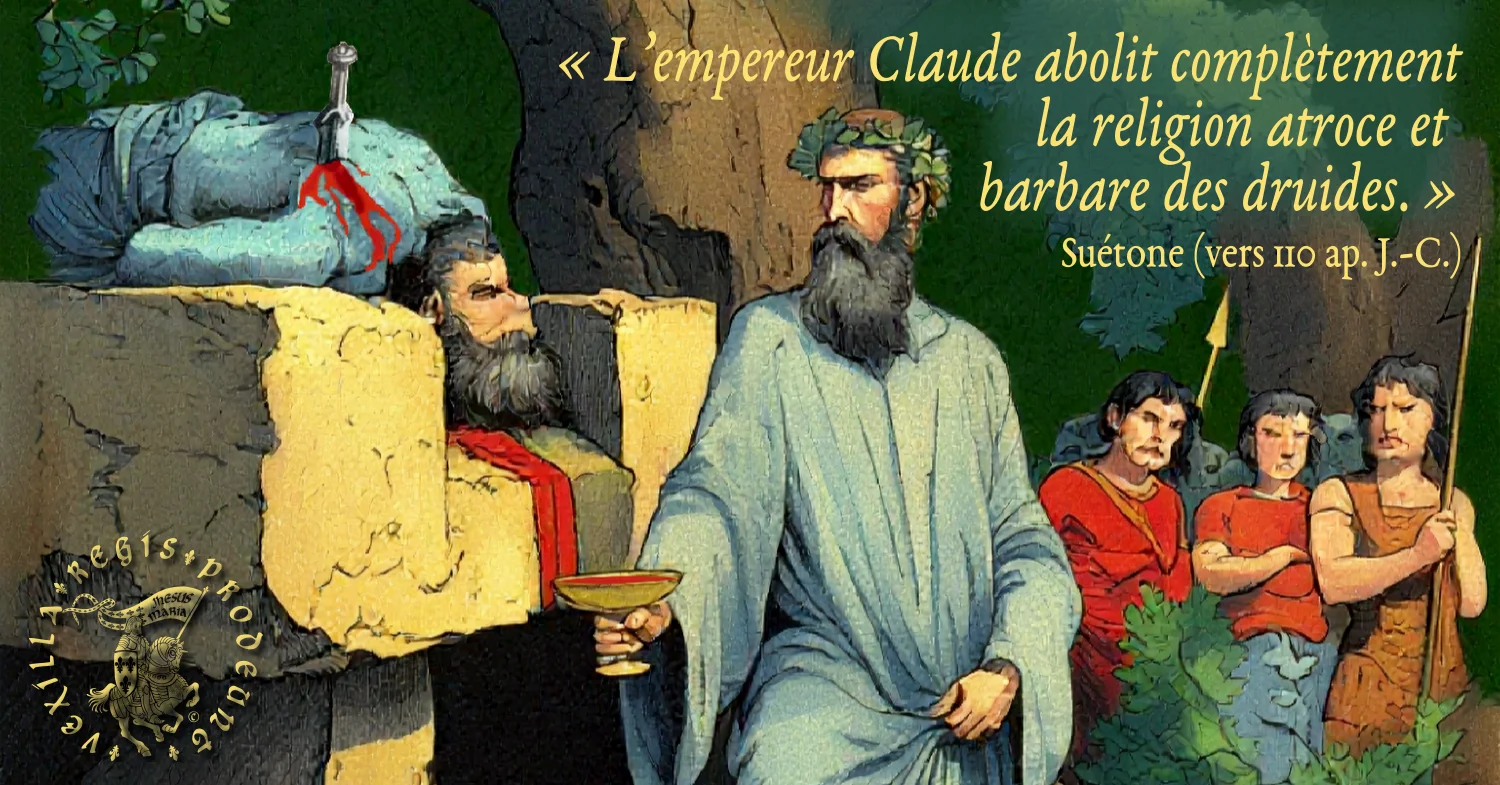Pour effacer l’acte fondateur de la France — le baptême de Clovis —, la Gauche replace les origines nationales en 1789, réduisant l’histoire à la Révolution. La Droite n’est pas en reste, elle construit un artificiel « roman national », faisant des Gaulois les héros civilisateurs d’une nation française traversant les âges. Pourtant, derrière cette image d’un peuple gaulois pacifique et inventif se cache une réalité bien plus sombre : une civilisation façonnée par la violence et les sacrifices humains. Comme le montre le professeur Michel Rouche, les druides enseignaient un culte obsessionnel de la mort et de la guerre, à travers des rituels sanglants et une brutalité organisée qui horrifièrent Rome. Loin des « doux Gaulois » du folklore moderne, leur société exaltait une violence collective, où des figures comme la prêtresse de Vix incarnaient une barbarie méthodique. Rome, confrontée à ces pratiques, les réprima sans hésiter. Une plongée dans une histoire bien plus crue que ne veulent l’admettre les récits politiques contemporains. [La Rédaction.]
Introduction de Vive le Roy
Article du Professeur Michel Rouche paru dans le N° 30 du mensuel L’Histoire, janvier 1981.
AVERTISSEMENT : Les titres notés [VLR] ont été ajoutés par notre rédaction, ainsi que les références des citations qui ne figuraient pas dans l’article original destiné au grand public.
Introduction [VLR]
« Un peuple inventif aux vertus intactes » ? Pour Michel Rouche, bien des historiens, victimes du mirage celtique, font un silence total sur les sacrifices humains de « nos ancêtres les Gaulois » et préfèrent nous montrer les druides comme de doux poètes alors qu’ils étaient les grands prêtres de la mort.
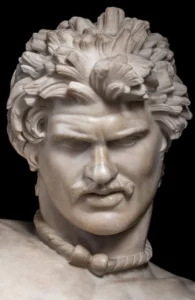
La Gaule revient à la mode. Le désir de remonter au-delà des origines chrétiennes et romaines fait fleurir actuellement une série d’ouvrages qui remettent en honneur un peuple inventif aux vertus intactes. Les Gaulois seraient alors notre source des plus authentiques valeurs humaines1. En même temps, ce retour aux pures origines considère que l’Empire romain, en faisant disparaître la civilisation gauloise, a détruit des qualités qui nous manquent aujourd’hui cruellement. Effectivement, les empereurs se sont acharnés à détruire certains traits, mais pas tous, de la civilisation gauloise. Ils ont visé tout particulièrement les druides et la religion qu’ils enseignaient. Ces mesures, visiblement sélectives, avaient un but précis : supprimer l’éducation à la violence, courante chez les tribus gauloises. Il importe ici d’éclairer un aspect peu connu et particulièrement révélateur des mœurs de nos ancêtres.
César une fois entré en Gaule découvrit une civilisation fort différente de la sienne2. Il s’aperçut que deux groupes sociaux dominaient la soixantaine de tribus qui composaient le peuple gaulois : les druides et les guerriers. Les premiers possédaient la science qui leur permettait d’éduquer les jeunes aristocrates à cultiver la violence :
Les druides s’occupent des choses de la religion, ils veillent à l’observance des rites dans les sacrifices publics et privés, et règlent les pratiques religieuses. Un grand nombre d’adolescents viennent à eux pour s’instruire et ils sont très honorés3.
Les druides comportent une espèce de sous-groupe, les bardes, qui sont la mémoire du peuple. Ils apprennent par cœur des poèmes aux milliers de vers qui rappellent les hauts faits des grands chefs, les généalogies des plus célèbres guerriers et les mythes cosmogoniques expliquant le rôle des dieux dans le monde.
Druides et bardes
L’enseignement des druides était secret car ils estimaient qu’on ne pouvait donner la clef du monde à n’importe qui. Pour eux, tout tourne autour de la mort qu’il faut savoir donner ou recevoir pour que survive le peuple gaulois. Comme pratiquement ils tiennent intellectuellement le pouvoir en Gaule depuis la disparition de la royauté vers 250 av. J.-C, ils ont une influence totale sur chaque tribu et son attitude politique. C’était déjà une cause aux yeux des Romains de leur nécessaire élimination.
Le contenu de leur message était à la fois exaltant et effrayant. Pour eux, les Gaulois sont nés de Dis Pater, le dieu de la mort. Leur âme est donc immortelle. Elle passe à la mort de chacun dans le corps d’un autre. Cette croyance en la réincarnation a donc pour résultat de ne point faire craindre la mort : elle n’est qu’un fossé plein de flammes qu’il faut savoir sauter gaiement. L’éducation des jeunes à la violence guerrière est donc facilitée par ces croyances. César le reconnaît lui-même :
Il y eut un temps où les Gaulois l’emportaient en bravoure sur les Germains, où c’étaient eux qui leur portaient la guerre et qui, par suite de leur nombreuse population et de l’insuffisance des terres cultivables, envoyaient des colons au-delà du Rhin4.
Et l’on connaît encore mieux la phrase de César sur la bravoure des Belges qui l’emportent sur tous les Gaulois. Cela n’était point un simple coup de chapeau d’un vainqueur élégant qui, tout en jetant des fleurs aux vaincus, cherchait à mieux faire éclater sa propre gloire.
Un certain Manlius Torquatus…
En effet les druides apprenaient aux guerriers gaulois à combattre nus. En s’offrant ainsi aux coups des adversaires, ils escomptaient, soit les effrayer par leur mépris de la mort, soit mourir en sacrifice agréable aux dieux qui, satisfaits de cette offrande préliminaire des plus courageux, ne pouvaient que leur donner ensuite la victoire en remerciement de leur piété. Déjà la divinité infernale apparaît ici comme dévorante et assoiffée de chair humaine. Mais il existait aussi une autre méthode pour se concilier la force divine et provoquer la défaite de l’adversaire.
Chaque jeune l’apprenait lors des danses guerrières5. Tous ceux qui ont reçu quelque teinture de latin au lycée se souviennent probablement d’un texte qu’il fallait inévitablement traduire : l’histoire de Manlius Torquatus. Tite-Live raconte comment, lors de l’invasion gauloise en Italie qui faillit prendre le Capitole sauvé par les oies, un gigantesque guerrier gaulois vient provoquer l’armée romaine et lancer un défi en combat singulier. Malgré l’aspect imposant du géant, un petit Romain court et râblé, Manlius, accepta. Et le nouveau David finit par blesser le Gaulois et lui trancher la tête une fois tombé à terre. Il lui enleva alors son collier, le célèbre torques, sorte de jonc circulaire terminé par deux boules, et le passa à son cou devant les Gaulois atterrés. On l’appela dès lors Manlius Torquatus. Malheureusement nos bons maîtres avaient toujours la détestable habitude de couper le passage de Tite-Live au mauvais endroit.
En effet, avant la scène du combat, Tite-Live décrit une curieuse danse guerrière du Gaulois. Nu, les armes à la main, il tournait en chantant et en tapant du pied sur le sol de manière rythmée. Par ses contacts répétés avec la terre, il appelait ainsi à lui les dieux chtoniens, comme s’ils entraient en son corps. Alors, pris de transes extatiques, la poitrine gonflée de fureur homicide, il ouvrit la bouche jusqu’à faire entrevoir le fond de sa gorge et tira une langue énorme à l’adresse de l’ennemi. Dans la croyance païenne de ces guerriers, ils avaient l’impression d’ouvrir ainsi toute leur personne à l’être divin infernal qui entrait en eux et sortait par leur bouche, telle une flèche de feu projetée par leur langue sur l’adversaire. Déjà l’opposant était ainsi comme dévoré à l’avance. Cette véritable technique de possession divine rendait à leurs yeux le jeune Gaulois invulnérable et invincible. On comprend la déception des compagnons de notre champion lorsqu’ils virent que le dieu de la mort les avait abandonnés.
Le sang et la mort
Il n’empêche que cette croyance laissa de nombreuses traces dans l’inconscient collectif. Les chimères et les dragons de l’art romain qui sortent une langue démesurée, tout comme celles du cratère de Vix, en sont les traces durables. Le folklore français conserva, lui aussi, par le biais des romans celtiques et bretons, tel Tristan et Iseut, le souvenir des combats contre les monstres, où le véritable vainqueur n’était pas celui qui avait coupé la tête mais plutôt celui qui, soigneusement, avait tranché la langue et l’avait cachée dans un linge. Tout le monde connaît la légende de la bête à sept têtes, où justement le héros triomphe de l’usurpateur, en montrant les sept langues. Dans la perspective éducative gauloise, le symbolisme de la langue était donc, au strict sens du terme, capital en tant que siège de la vertu belliqueuse et meurtrière.
Cet art de rendre le désir homicide conscient, recherché et développé n’en restait pas au stade individuel. Il était habilement cultivé jusqu’au stade du groupe. Les jeunes étaient rassemblés par classes d’âge auxquelles les anciens apprenaient à se battre. Ils étaient littéralement coupés de la société des adultes tant qu’ils n’avaient pas terminé leur apprentissage militaire. César explique que les Gaulois…
… n’admettent pas d’être abordés dans un lieu public par leurs propres enfants, avant que ceux-ci ne soient en âge de porter les armes ; ils estiment honteux qu’un fils encore enfant se tienne en public sous les yeux de son père6.
Ces collèges de jeunes, appelés hétairies par l’historien grec Polybe (v. 200-v. 125-120 av. J.-C), devaient se terminer par un rite de passage, qui les intégrait dans la société des guerriers adultes. Ces collèges, au reste, continuèrent leur existence sous l’autorité romaine, puisqu’en 21 ap. J.-C, Sacrovir, un Gaulois révolté, parvint à faire se soulever les jeunes de la ville d’Autun et à leur distribuer des armes qu’ils manièrent aussitôt avec dextérité.
Une bonne partie de leur entraînement était consacrée à la chasse. L’art de tuer un sanglier ou un cerf s’apprenait en même temps que celui du dressage des chiens. Il fallait savoir lâcher à temps tel ou tel type de chien, soit le super-coureur, le vertragus que nous appelons en chasse à courre le vautre, soit le dogue dont l’unique fonction est de planter ses crocs dans l’arrière-train de la bête. Les Gaulois importaient même des chiens de race d’Irlande. Ils en dressaient d’autres pour la guerre afin qu’ils se jetassent à la gorge des ennemis. Une fois vainqueurs, au retour de la bataille, ils suspendaient à l’encolure de leur monture les têtes tranchées de leurs adversaires. Ils en clouaient d’autres devant les portes ou les encastraient dans les montants de leurs temples. Dans d’autres cas, ils les embaumaient à l’huile de cèdre. Le sang et la mort étaient donc leurs compagnons habituels. Les jeunes Gaulois étaient même sévèrement punis s’ils prenaient de l’embonpoint et si leur tour de taille dépassait la mesure fixée.
Enfin, comme toujours dans les milieux de compagnonnage militaire où règne la ségrégation sexuelle, il était normal que ces jeunes adolescents se prodiguassent mutuellement leurs charmes. Ces couples d’amants ne pouvaient que s’exciter l’un l’autre à surenchérir de courage pour éblouir l’aimé. Ainsi l’amour pédérastique était une autre forme d’exaltation des sentiments créateurs d’agressivité et de violence.
Et n’oublions pas les combats de gladiateurs7 se déroulant auprès des sanctuaires religieux, où des esclaves s’entr’égorgeaient avec un armement inégal sous les yeux des spectateurs. Si des individus aussi vils mouraient avec courage, comment des hommes libres auraient-ils pu faire moins ?
La vérité de Vix
Aussi les Romains ne pouvaient-ils qu’être frappés par la sauvagerie et la barbarie des Gaulois. Ils avaient bien vu que druides et bardes apprenaient à la fleur de la jeunesse l’art de démultiplier la violence et, comme dit César,.. .
… à craindre les dieux, à ne rien faire qui ne soit noble et à s’exercer aux qualités viriles.
Mais ils avaient trouvé mieux. Les Gaulois étaient parvenus à mobiliser l’intuition et les passions féminines au service de la violence. Seules, en effet, les femmes pouvaient créer, par l’attirance qu’elles exercent sur le sexe masculin, une atmosphère dérivant les pulsions érotiques en désir de tuer. Conscientes des biens et des valeurs de la tribu qui sont à protéger, elles n’en pouvaient que mieux exciter l’homme pour le faire entrer dans la démesure et l’exaspération des sens.
Dans la catégorie des druides existait une autre espèce de savant, les devineresses ou prophétesses, comme on voudra. Le géographe grec Strabon (v. 58 av. J.-C. — entre 21 et 25 ap. J.-C), montre quel rôle fondamental elles jouaient dans la société guerrière gauloise. Pendant longtemps, et même encore aujourd’hui, les historiens [3] ont refusé de croire ce qu’il disait. Il a fallu l’étonnante découverte du cratère de Vix en 1951 par René Joffroy et l’excellente explication de Félix Bourriot8 pour comprendre enfin la signification de ce mystérieux vase de bronze haut de plus d’un mètre soixante, orné d’anses en forme de gorgones et de frises de guerriers partant pour le combat.

On sait que le vase de Vix a été découvert dans un tumulus à côté d’un char et près du corps d’une femme aux bijoux extraordinaires avec un mobilier fort curieux. Les premières interprétations furent des plus embarrassées. Jérôme Carcopino parla d’un cadeau diplomatique fait par des marchands grecs à une princesse gauloise qui tenait avec sa tribu les routes menant de la Saône aux sources de la Seine, en direction de la Grande-Bretagne. Il se serait agi d’amadouer la maîtresse de la route de l’étain. C’était transposer le mythe de la reine de Saba en Gaule…
En réalité, si l’on compare terme pour terme le texte de Strabon avec les objets découverts lors de la fouille archéologique, une tout autre interprétation saute aux yeux, terrible et épouvantable. La jeune femme au diadème d’or orné de pavots et de petits Pégases était une prêtresse ou une devineresse chargée d’une mission religieuse. Elle devait faire passer la violence divine des dieux guerriers dans le corps des soldats de sa tribu. Avant la bataille, elle arrivait avec son gigantesque chaudron porté sur son char. Là, devant le front des troupes, elle faisait monter par une échelle un prisonnier de guerre, lui faisait pencher la poitrine à l’intérieur du vase et lui enfonçait un poignard en plein cœur. Le sang jaillissait sur les parois, puis se coagulait en laissant des dessins de formes diverses.
« Le meurtre, voilà la virilité gauloise ! »

La prêtresse lisait alors dans cet ancêtre du marc de café l’avenir du combat qui allait avoir lieu. Si les dessins étaient difficiles à interpréter, elle passait à un second ou à un troisième prisonnier, jusqu’à plus ample satisfaction. Alors, elle plongeait une louche dans le fond de la cuve où le sang s’était mélangé au vin, buvait d’amples gorgées de ce nectar divin, y trempait un jabellum, sorte de manche terminé par des lacets de cuir, et descendait du cratère. Puis, ivre de sang, au strict sens du terme, elle se mettait à vaticiner en prédisant la victoire devant les hommes rassemblés et les aspergeait à plusieurs reprises de son goupillon à lanières. Et c’était une horde déchaînée, tout éclaboussée de sang, sacralisée par les victimes propitiatoires, cuirassée de flaques rouges et hurlant à la mort, qui se ruait sur l’adversaire médusé, là encore au strict sens du terme, par ces véritables démons aux visages horribles et déformés.
Il suffit de regarder le chaudron celtique de Gundestrup trouvé au Danemark pour s’apercevoir que cette pratique était courante dans les tribus gauloises. Parmi les scènes de mythologie, on en remarque une où, de manière très stylisée, une femme renverse un homme contre une grande vasque, un poignard à la main. De toute évidence, il s’agit d’une scène de sacrifice humain, comme la prêtresse de Vix dut en pratiquer souvent. Si ce furent des Grecs qui offrirent le cratère, ils savaient pertinemment qu’ils flattaient ainsi le goût de la gloire la plus sanglante qui pût exister.
César et Lucain affirment l’authenticité des sacrifices humains chez les Gaulois.
Tout le peuple gaulois est très religieux ; aussi voit-on ceux qui sont atteints de maladies graves, ceux qui risquent leur vie dans les combats ou autrement, immoler ou faire vœu d’immoler des victimes humaines, et se servir pour ces sacrifices du ministère des druides ; ils pensent, en effet, qu’on ne saurait apaiser les dieux immortels qu’en rachetant la vie d’un homme par la vie d’un autre homme, et il y a des sacrifices de ce genre qui sont d’institution publique.
Certaines peuplades ont des mannequins de proportions colossales, faits d’osier tressé, qu’on remplit d’hommes vivants : on y met le feu, et les hommes sont la proie des flammes. Le supplice de ceux qui ont été arrêtés en flagrant délit de vol ou de brigandage ou à la suite de quelque crime passe pour plaire davantage aux dieux ; mais lorsqu’on n’a pas assez de victimes de ce genre, on va jusqu’à sacrifier des innocents9.
Tacite les confirme aussi à sa manière. Il raconte une des dernières révoltes gauloises contre Rome, celle de Civilis, dont on ne sait s’il était Gaulois, Belge ou Germanique. En tous les cas, en 69 ap. J.-C, il lança dans le Nord de la Gaule un grand soulèvement. Il était soutenu par Velleda. …
… Cette vierge exerçait un pouvoir étendu, conformément à une antique coutume […] qui prête à beaucoup de femmes le don de prophétie […]. L’autorité de Velleda grandit car elle avait prédit […] l’anéantissement des légions10.
Ce nom propre de Velleda n’a pas été compris par Tacite. Il s’agit en réalité d’un nom commun, d’origine celto-irlandaise, filid — au féminin filida —, qui signifie prêtresse savante, prophétesse. Le suffixe id comme dans dru-id, signifie « savant » en gaulois. Velleda, certainement, appuyait ses prophéties exaltantes sur les sacrifices humains. Nous sommes loin de la vierge romantique que Chateaubriand campe dans Les Martyrs, échevelée, diaphane, au milieu des glauques marécages du pays batave.
Il manquait jusqu’ici la confirmation archéologique. Louis Maurin vient de montrer qu’à Saintes, un puits dans un ancien sanctuaire celtique contenait dix-sept squelettes humains, dont l’un entravé, et trois enfants, des chiens, des chaînes, des chevaux, des branches d’arbres, etc. Le tout est datable des années 150 ap. J.-C. La présence d’entraves ne peut que suggérer qu’il s’agissait, au moins pour une part d’entre eux, de condamnés sacrifiés publiquement dans un temple.
D’autres puits du même genre existent à Paris et à Dourges dans le Pas-de-Calais. Étant donné la variété des types de sacrifices humains attestés par d’autres auteurs, il faut bien se rendre ici à l’évidence que des hommes ont été réellement tués pour plaire aux dieux gaulois de la mort, peut-être Esus ou Teutatès.
Pourquoi la violence des Gaulois frappait-elle à ce point les Romains ? Chez ces derniers, comme chez les Grecs, les sacrifices humains étaient inconnus. Leur conception religieuse du contrat avec les puissances divines était à base d’une véritable négociation rituelle. Le mot latin fides, la foi, a la même racine que celui de fœdus, le traité de paix. Si la cité de Rome respecte fidèlement les rites des cérémonies ancestrales, les dieux sont avec elle et lui donnent la paix à la suite d’un conflit victorieux qui n’est qu’une brève interruption d’un processus habituel de vie paisible. Le Romain n’achète pas un dieu assoiffé de sang. Il discute d’égal à égal : do ut des, je te donne (sous-entendu une belle cérémonie cultuelle) et tu me donnes (sous-entendu la victoire sur l’ennemi). Un peuple de paysans, habitué à régler les conflits de bornages par des arbitrages mutuels, met inévitablement la violence au rang de la sauvagerie.
En revanche, des peuples comme les Gaulois et les Germains qui sont encore au stade d’une agriculture itinérante n’ont pour seuls biens que leurs troupeaux et leurs femmes. Un territoire de chasse, une pâture ne se bornent pas. Le conflit dégénère aussitôt en violence armée. Vivre en discutant est impossible. Survivre en tuant est la seule issue. La nature avec sa loi sauvage du plus fort qui tue est comme une déesse qui enseigne aux tribus gauloises et germaniques qui vivaient côte à côte encore au Ve siècle av. J.-C, entre le Rhin et l’Elbe, que la violence est la voie du salut. Cette parenté entre Gaulois et Germaniques est visible dans les noms de peuples. Franc vient de frekkr, hardi, courageux. Gaulois vient de galata, brave ! Dans les deux cas, une seule vertu est prisée : le courage physique. Le meurtre, voilà la virilité ! Pour l’obtenir, offrons aux dieux ce que nous avons de meilleur : des hommes. Et voici pourquoi Gaulois et Germaniques pratiquaient les sacrifices humains.
« Atroce et barbare »
Pour les Romains, fiers de l’héritage grec et de ses philosophes qui, comme Platon, proclament que « l’homme est la mesure de toute chose », ces pratiques étaient contre nature. Or, même en Gaule romaine, elles réapparurent à Saintes, à l’époque du sage empereur Marc Aurèle le stoïcien (161-180) ! Le temple celte en question fut du reste rasé peu après par les autorités municipales et une habitation construite par-dessus. Cela faisait partie des mesures de suppression de la religion gauloise inadmissible aux dieux romains policés.
Auguste fut le premier à proclamer la suppression des druides et de leurs cultes. Drusus, légat impérial en Gaule, remplaça leur réunion annuelle chez les Carnutes par le culte fédéral de Lyon en l’honneur de l’empereur. Mais Tibère, en 21 ap. J.-C, dut réitérer l’interdiction des cultes druidiques.
En 69, la révolte de Civilis fut, nous l’avons vu, inspirée par les druides devenus clandestins. Outre les prophéties de Velleda, d’autres avaient circulé après un incendie accidentel du Capitale à Rome. Elles affirmaient :
Par ces flammes le destin donnait un signe de la colère céleste et un présage que la souveraineté du monde allait passer aux nations transalpines [c’est-à-dire aux Gaulois.] 11
Aussi, après l’échec de la révolte, l’empereur Claude…
… abolit complètement la religion atroce et barbare des druides 12.
À ces expressions on reconnaît ici que l’interdiction visait surtout les sacrifices humains. En fait, nous avons vu qu’ils furent encore pratiqués à Saintes au IIe siècle.
En 235 encore, l’empereur Alexandre Sévère rencontra dans les bois une prêtresse qui lui prédit en gaulois sa destinée.
Au IVe siècle, l’un des ancêtres d’un professeur gallo-romain de Bordeaux était un druide de Bayeux. Il devait vivre vers 300. C’est le dernier que nous connaissons.
Comme on le voit, le druidisme mit plus de quatre siècles à s’éteindre et, avec lui, les sacrifices humains. Avec eux disparut aussi toute une tradition éducative qui visait à assurer la survie d’un peuple par le massacre d’une partie de ses guerriers ou de ses prisonniers. Cette exaspération de la violence, ce mépris du trépas, cette transformation de la femme en créatrice de mort et de victoire, parurent aux Romains comme une perversion fondamentale du sens de l’homme. Dans cette intuition religieuse païenne qui sacrifie la vie à la mort pour que renaisse la tribu, ils ne virent, avec leur sens pratique, que des meurtres stupides et un instinct de mort dévoyé. Car pour eux l’éducation consistait non pas à cultiver l’agressivité mais à discipliner le désir.
Et voilà pourquoi, aujourd’hui encore, bien des historiens, victimes de la glorification de nos ancêtres les Gaulois, font un silence total13 sur ces horribles cérémonies religieuses et préfèrent nous montrer les druides comme de doux poètes grimpant dans les chênes au mois de décembre pour y couper le gui avec une faucille d’or !
- Cf. « Autopsie de « Nos ancêtres les Gaulois », par Jean-Pierre Rioux (L’Histoire n° 27, octobre 1980, p. 85).↩
- On regardera d’abord La Guerre des Gaules de Jules César dans la traduction de L.-A. Constans, Paris, 9e éd., 1967, et, pour une image d’ensemble, P.-M. Duval, La vie quotidienne en Gaule romaine, Paris, Hachette, 1953.↩
- César, La Guerre des Gaules, livre VI, par. 13.↩
- César, La Guerre des Gaules, livre VI, par. 24.↩
- En ce qui concerne l’aspect proprement éducatif chez les Gaulois : M. Rouche, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation, tome I, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1980.↩
- César, La Guerre des Gaules, livre VI, par. 18.↩
- Sur les gladiateurs, on peut lire Paul Veyne, « Les gladiateurs, artistes maudits » (L’Histoire n° 2, juin 1978, p. 4). 3. et 4. Cf. « Pour en savoir plus ».↩
- Pour le détail de la démonstration, lire Félix Bourriot, « La Tombe de Vix et le mont Lassois », Revue historique, 1965, où l’auteur fait un rapprochement très convaincant entre les découvertes archéologiques et le texte de Strabon. Pour la survivance des sacrifices humains, la thèse de L. Maurin, Saintes antique, Saintes, 1978, démontre scientifiquement leur réalité.↩
- César, La Guerre des Gaules, livre VI, par. 16. (Citation insérée dans le texte par VLR)↩
- Tacite, Histoires, livre IV, chap. 61, par. 5.↩
- Tacite, Histoires, livre IV, chap. 54, par. 4.↩
- Suétone, Vie de Claude, XXV, 13.↩
- Pour ceux que le curieux silence des historiens sur cette éducation à la violence chez les Gaulois intrigue, ils pourront se reporter à la dernière présentation abrégée de l’Histoire de la Gaule de Camille Jullian, Paris, Éd. Robert Laffont, 1971 ; ou encore M. Dillon, N.K. Chadwick, Les royaumes celtiques, Paris, Fayard, 1974, 88,00 francs et évidemment l’ouvrage de Régine Pernoud, Les Gaulois, Paris, Seuil, 1979, 60,00 francs.↩