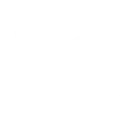Si l’on essaie de symboliser l’année 1815 par une image, celle qui s’imposera ne sera probablement pas celle du Roi, ni d’ailleurs celle de l’Empereur, mais celle du champ de bataille de Waterloo… Image héroïque, littéraire et romanesque, mais qui illustre une catastrophe considérable pour la France. Ce 18 juin 1815 n’a pas été seulement funeste par lui-même, en tant que défaite militaire. Son ombre portée a hypothéqué la Restauration et rendu pérenne la cassure de l’histoire de France que Louis XVIII avait essayé de réparer en 1814.
Table des matières
Introduction de Vive le Roy
Nous remercions le Professeur Franck Bouscau pour cet article.
AVERTISSEMENT : Les titres notés [VLR] ont été ajoutés par la Rédaction pour faciliter la lecture en ligne.
Introduction
Un trône restauré, un royaume divisé : le contexte politique de 1815 [VLR]
Si l’on compare le 1er janvier et le 31 décembre 1815, l’on verra, dans les deux cas, le même roi Louis XVIII sur le trône. Mais l’entre-deux est bien différent, et le Roi et son royaume ont aussi beaucoup changé au cours de cette année. Au début de 1815, Louis XVIII n’a que quelques mois de règne effectif, ayant récupéré le royaume de ses pères depuis mai de l’année précédente. Ses partisans ont réussi à s’emparer du pouvoir en obtenant le ralliement massif des autorités constituées de l’Empire, municipalités, notables, voire sénateurs, et en profitant la division et de l’absence de projet politique précis pour la France de la part des étrangers vainqueurs, les souverains de Grande-Bretagne, Russie, Prusse et Autriche. Réticents à l’égard du Roi comme le Tsar, sympathisants comme l’anglais Wellington, les « Alliés » ont finalement laissé les royalistes imposer leurs solutions. Napoléon lui-même, avant de quitter le pouvoir, a recommandé à sa Vieille Garde de continuer de servir la France, ce qui revient à accepter le régime qui lui succédera.
Un compromis constitutionnel fragile : la Charte de 1814 et ses limites [VLR]
De retour d’exil, le Roi a fait des concessions au plan intérieur : il a octroyé, apparemment par sa seule volonté, une charte constitutionnelle le 4 juin 1814. Curieusement, le Tsar, lui-même autocrate absolu, a favorisé cette combinaison. Aux termes de la Charte, le Roi dirige le gouvernement avec ses ministres.
Pour la législation, deux chambres apportent leur concours au monarque, les pairs, nommés à vie ou à titre héréditaire, et les députés des départements, élus par quelques milliers d’électeurs sélectionnés en fonction de leur richesse. Les chambres votent les lois et le budget, et cette participation obligatoire constitue le talon d’Achille du régime — l’on ne s’en apercevra que plus tard — puisque les assemblées peuvent utiliser leur pouvoir pour mettre en échec la politique des ministres du Roi. Au surplus, le pays légal est étroit et, alors que nombre de Français, dont beaucoup de royalistes, n’ont pas voix au chapitre ; seuls les plus riches, dont il n’est pas démontré qu’ils soient attachés au régime, sont représentés.
Louis XVIII a gardé les députés en place à l’époque de son retour, sous réserve de leur appartenance au territoire conservé par la France, et a garni la chambre des pairs avec les sénateurs non régicides, auxquels il a adjoint les pairs subsistants d’Ancien Régime. Par ailleurs il a amnistié tous les agissements politiques depuis 1789, y compris le vote des régicides. En outre la charte a ratifié le nouvel état social, notamment l’égalité des Français devant la loi et devant l’impôt et l’accessibilité de tous aux emplois. Dans le titre premier du document constitutionnel, intitulé « Droit public des Français », le Roi a reconnu diverses libertés publiques, proclamées naguère par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et d’ailleurs bafouées par les régimes révolutionnaires et impérial, telles que les libertés d’opinion, de presse, des cultes1… Rendant ses titres à l’ancienne noblesse, il a également confirmé ceux de la nouvelle ainsi que les grades militaires et les décorations. Enfin, il a garanti les propriétés existantes, sans omettre — concession obligée et quelque peu compromettante — celle des « biens nationaux », c’est-à-dire des biens du clergé et des émigrés confisqués et vendus pendant la Révolution. Curieusement, la Charte, accordée « à toujours » est un acte de roi absolu qui réalise une autolimitation du pouvoir. Ce compromis une fois établi, Louis XVIII a pu installer et faire fonctionner son régime. En particulier l’épuration des fonctionnaires a été limitée en 1814. Le maintien des institutions administratives et des codes peut même amener à se demander, en renversant la rhétorique de l’usurpation, si Louis XVIII n’a pas décidé d’occuper le trône de Napoléon plutôt que de rétablir celui des rois ses prédécesseurs…
Une paix extérieure négociée, mais une France réduite à ses frontières de 1792 [VLR]
Au plan extérieur le Roi a dû, lors du traité de Paris du 30 mai 1814, accepter de tirer un trait sur l’expansion révolutionnaire et impériale. La France s’est retrouvée dans ses frontières de 1792, avec en sus quelques modestes adjonctions comme des enclaves (Avignon, Mulhouse…) et quelques territoires frontaliers (partie de la Savoie). Les armées étrangères se sont retirées immédiatement et aucune indemnité de guerre n’a été exigée. La France n’a même pas été obligée de restituer les « biens culturels » dont elle s’était emparée lors de ses conquêtes. En outre, quoique vaincue, elle a été invitée à participer au Congrès de Vienne, organisé par les vainqueurs pour réorganiser l’Europe. Pour l’y représenter, le Roi a choisi Talleyrand. Celui-ci, rusé et vénal rejeton d’une grande famille d’Ancien Régime, évêque défroqué, ministre du Directoire, puis de Napoléon Bonaparte, qu’il avait d’ailleurs trahi, a mis sa connaissance de la diplomatie et son habileté manœuvrière au service de la royauté rétablie, en se montrant habile à diviser les vainqueurs2 et à opposer le principe de légitimité, dont ils se recommandaient, à leurs ambitions territoriales.
Si l’on compare cette situation avec celle de la fin de la même année 1815, l’on s’aperçoit que la position du royaume est bien moins favorable. Certes, Louis XVIII est toujours sur le trône, mais l’on verra comment il en a été un temps évincé. Certes, la charte régit toujours le pays, mais après une interruption. Les députés laissés par l’Empire ont cédé la place à une nouvelle chambre et un certain nombre de pairs ont été écartés. Une épuration sévère est en cours, visant divers hommes politiques et fonctionnaires. Un fossé sépare de nouveau les deux « Frances » que le Roi avait cherché à réunir. De même, les « Alliés » sont revenus, et, cette fois, ils ne sont pas pressés de repartir, et ils veulent faire payer leur intervention.
1815 : l’année des Cent Jours [VLR]
Que s’est-il donc passé au cours de cette année 1815 ? Elle a vu le retour surprenant et fulgurant de l’empereur Napoléon. Remonté sur le trône, il a gouverné la France trois mois avant d’être éliminé politiquement par le retour des Alliés. Cette aventure épique s’est terminée en catastrophe. C’est ce qu’on appelle les Cent Jours3. Et, à défaut de remettre en cause définitivement la Restauration, ce court épisode va la fragiliser.
Pour comprendre la situation de 1815, l’on étudiera successivement le bilan d’une année de Restauration, puis le vol de l’Aigle, et enfin la mise en place de la Seconde Restauration.
Le bilan de la Première Restauration
Un souci d’apaisement [VLR]
La royauté restaurée a paru à la fois combler les désirs de ceux qui regrettaient l’Ancien Régime et rassurer les bénéficiaires de l’ordre nouveau issu de la Révolution et de l’Empire. A priori le bilan du régime paraît positif pour une durée de moins d’un an. Comme il a été dit, la royauté a conclu une paix acceptable-la France s’est retrouvée dans ses anciennes frontières un peu améliorées, sans indemnité ni occupation — et le système politique nouveau mis en place par la charte a rompu avec le despotisme impérial.
Les frustrations et les tensions sociales sous la Première Restauration [VLR]
Mais la Restauration a aussi suscité des peurs, des frustrations et des déceptions. À vrai dire, elle est menacée de recevoir des reproches des deux côtés : partialité de la part de ses adversaires, ingratitude de celle de ses partisans. Ainsi les émigrés (les derniers ne sont rentrés qu’après la Restauration) ou les victimes des précédents régimes, estiment — ils avoir des raisons de se plaindre de l’ingratitude royale. Par exemple le maintien des biens nationaux entre les mains des acquéreurs, s’il paraît une nécessité politique, est ressenti avec douleur et colère par les anciens propriétaires ou leurs ayants droit et par l’opinion royaliste (et l’état des finances ne permet pas, dans l’immédiat, d’envisager une indemnisation qui mettrait fin à toute controverse)4.
Il a notamment fallu régler le sort de la Grande armée. Le royaume pacifique de Louis XVIII, au surcroît privé des conquêtes, a besoin d’une force militaire moindre que le belliqueux Empire européen de Napoléon. Si les maréchaux ont tiré leur épingle du jeu, il n’en a pas été de même de nombre d’officiers et de sous-officiers : beaucoup d’entre eux, qui profitaient d’une guerre interminable pour faire carrière5, se retrouvent en « demi-solde » et sans activité. Simultanément, pour donner des emplois à ceux qui s’étaient abstenus de servir les régimes de fait, la royauté reconstitue la maison militaire du Roi avec ses régiments de prestige. Vigny écrit que…
… la maison du Roi, en 1814, avait été remplie d’enfants et de vieillards ; l’Empire semblait avoir pris et tué les hommes6.
Par ailleurs, la situation du peuple s’est trouvée peu améliorée par le retour à la royauté. Certes, le retour du Roi a mis fin à l’impopulaire conscription et à la guerre. Mais, en revanche, au plan fiscal, le gouvernement royal n’a pas pu faire autrement que de maintenir les « droits réunis », impôts indirects rétablis par Napoléon, dont certains avaient espéré la disparition. D’autres craintes concernant des retours à l’Ancien Régime se sont fait jour, attisées par les républicains et les bonapartistes, et aussi par certains royalistes exaltés ou revanchards. Par exemple, selon certains bruits, le maintien de la propriété des biens nationaux en faveur des acquéreurs promis dans la Charte va être remis en cause, et le rétablissement des droits féodaux va avoir lieu…
À cela s’ajoutent des querelles personnelles. Les hommes de l’époque considèrent l’histoire du dernier quart de siècle d’une manière totalement opposée : ce qui est pour les uns victoires, voire épopée, n’est pour les autres que révolte et brigandage… Les duels entre royalistes ou émigrés rentrés d’une part, et anciens militaires de l’armée napoléonienne de l’autre, sont fréquents. De même, il y a des disputes de préséances. La bonne société d’Ancien Régime « snobe » parfois la noblesse d’Empire et ses dignitaires ou ses glorieux chefs militaires… En outre le régime est assailli de demandes qu’il est hors d’état de satisfaire, depuis les petits qui demandent des places en vertu de mérites personnels ou paternels jusqu’aux grands, par exemple des émigrés qui, n’ayant pu combattre depuis 1789, voire ayant combattu dans les rangs des « Alliés » demandent des reconstitutions de carrière… Bref, le gouvernement de la Restauration applique avant la lettre l’adage maurrassien « la politique est l’art du possible », mais ce possible paraît terne ou choquant aux contemporains.
Napoléon à l’île d’Elbe : un exil surveillé et des rumeurs de retour [VLR]
Pendant cette année de mise en place de la royauté restaurée, qu’est devenu Napoléon ? Après sa défaite, il a dû signer une abdication sans conditions, le 6 avril 1814. À la suite d’une intervention bienveillante du tsar, il s’est cependant vu reconnaître par traité la souveraineté de la minuscule île d’Elbe (214 km²), au large de l’Italie, et accorder une rente de deux millions de francs mise à la charge du gouvernement français7. Pour quitter la France et gagner son nouveau royaume, l’Empereur déchu est passé par la vallée du Rhône, de sympathie royaliste, ce qui lui a valu d’être conspué et même de devoir un moment se dissimuler sous un uniforme étranger. Après cette désagréable expérience, pendant la dizaine de mois de son règne elbois, Napoléon a utilisé son énergie à améliorer ce territoire exigu. Il a réformé le droit, ouvert des routes, s’est occupé d’urbanisme et de développement économique. Mais il s’est plaint de la petitesse de son île. Au surplus il y est assez délaissé : l’impératrice Marie-Louise, après la fin de sa régence, est totalement retombée sous l’influence de la cour d’Autriche et ne songe pas à rejoindre son époux. Elle a en outre emmené leur fils à Vienne. De même, le clan Bonaparte, déchu et obligé de trouver des lieux de refuge, ne l’a pas appuyé, à l’exception de sa mère et de sa sœur Pauline. Enfin le Roi ne verse pas la pension prévue8, et certaines rumeurs courent, suivant lesquelles certains hommes politiques voudraient envoyer l’Empereur déchu plus loin de la France.
Napoléon est tenu au courant de l’évolution de l’opinion française par ses partisans. Sur l’île d’Elbe défilent des curieux, d’anciens militaires de l’Empire en quête d’emploi, et des espions… Il y a des rumeurs relatives à des projets d’enlèvement ou d’assassinat du souverain insulaire. En France, la royauté restaurée se méfie des bateaux qui font escale dans l’île9, mais la surveillance de la marine française ne sera pas efficace quand Napoléon décidera de tenter une aventure a priori impossible, la reconquête du trône de France, épisode que l’on appellera les « Cent Jours. »
L’intermède des Cent Jours.
Le débarquement de Napoléon et la reconquête éclair du pouvoir [VLR]
« Cent Jours » : L’expression, qui devait passer à l’histoire, a été utilisée par le préfet de la Seine, le comte de Chabrol, accueillant le Roi le 8 juillet 1815 lors de son retour à Paris. C’est approximativement la durée qu’a eue l’équipée napoléonienne10.
Le 1er mars 1815, Napoléon, parti discrètement de l’île d’Elbe depuis le 26 février, débarque à Golfe-Juan, sur la côte méditerranéenne du royaume dont il veut refaire un empire. La légende s’est emparée de l’épisode de cette reconquête rapide, « l’Aigle volant de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame. » Napoléon a su montrer, à l’occasion, du courage physique en s’exposant au tir des troupes qu’il voulait rallier. Ceci étant, la spontanéité des ralliements est sans doute moins réelle ou profonde qu’il n’y paraît. Ainsi Napoléon a-t-il évité, cette fois, la royaliste vallée du Rhône et a-t-il traversé rapidement la Provence, de même sensibilité, pour aller vers un Dauphiné chaudement bonapartiste. Les anciens militaires ont agi comme un réseau (probablement renforcé par les accointances maçonniques fortes dans l’armée).
De son côté, Louis XVIII ne peut opposer à Napoléon que des troupes de ligne, composées d’anciens soldats de l’Empire et dirigées par des officiers de même origine11. L’envoi de soldats, solution d’urgence apparemment évidente, va vite paraître inefficace et même contre-productive, mais le gouvernement ne trouvera pas de solution alternative. Des volontaires royaux se sont présentés, mais ils n’ont pas pu être sérieusement organisés, à supposer qu’ils aient été utilisables, et le Roi n’a pas voulu demander l’aide des Alliés. Au surplus Napoléon exerce une véritable séduction, dont il sait user, à l’égard des militaires qui ont servi sous ses ordres. Le cas le plus célèbre est celui du maréchal Ney. Celui-ci, surnommé le « brave des braves », soldat courageux mais piètre politique, s’était rallié aux Bourbons. Sans être sollicité, il propose à Louis XVIII d’aller arrêter Napoléon et de le ramener dans une cage de fer. Puis, mis à la tête de l’armée royale, il part à la rencontre de son ancien chef. À plusieurs reprises, Napoléon lui écrit pour lui demander de se joindre à lui. Il lui propose même de le recevoir comme au soir de la victoire de la Moskova, si bien que, au lieu d’arrêter Napoléon, Ney lui tombe dans les bras à Lons-le-Saunier le 14 mars 1815, et que son armée change de camp.
L’effondrement de la résistance royaliste et la fuite de Louis XVIII [VLR]
Le ralliement des troupes à Napoléon est quasi total12. L’on peut estimer que l’Empereur l’a emporté par sa rapidité et que les partisans du Roi ont été frappés de stupeur et immobilisés par sa puissance momentanée fondée sur des ralliements apparemment universels. Si les documents d’époque montrent qu’il y a dans le pays beaucoup de gens incertains, et même de royalistes, il n’y a pas d’opposition forte au ralliement des militaires, qui entraîne celui des civils, ni, tout au moins dans un premier temps, d’insurrection ou de guerre civile.
À Paris, l’entourage de Louis XVIII ne sait plus comment réagir après l’échec de la résistance militaire13 et des projets, parfois étranges, sont élaborés par les conseillers, les ministres ou les familiers du Roi… Le baron de Vitrolles veut faire partir le roi vers l’Ouest, le comte Ferrand vers Toulouse… Le duc de Blacas propose que le Roi aille au-devant de Napoléon, suivi des chambres et de la cour, pour lui demander la raison de sa venue ! … Le maréchal Marmont, s’appuyant sur un plan chimérique de Chateaubriand, propose de mettre la famille royale en sûreté, le Roi restant aux Tuileries avec les chambres et le corps diplomatique pour attendre l’assaut napoléonien14…
Louis XVIII préfère ne pas courir de risques. Si, le 16 mars, lors d’une séance royale en présence des pairs et des députés, il avait déclaré être prêt à mourir pour la défense de la patrie, il apprend la défection de Ney le 17 mars et choisit le départ vers le Nord. Le 20 mars, le Roi quitte les Tuileries le matin, et l’Empereur y arrive le soir…
Protégé par la maison militaire, le voyage royal se passe sans incident15. Les autorités locales reçoivent le Roi avec respect et solennité, et les populations lui font un accueil chaleureux. Louis XVIII a envisagé de se fixer à Lille, et la réception enthousiaste de la population de cette ville peut l’y encourager. Cependant l’attitude de l’armée l’inquiète16 et il décide de passer la frontière belge (alors royaume des Pays-Bas) avec un trésor important dont, rendu prudent par sa longue émigration précédente, il s’est chargé. Les autres membres de la famille royale quittent aussi la France. Dans le Midi, le duc d’Angoulême a bien essayé de s’opposer militairement mais, vaincu, il est forcé de quitter la France. La duchesse, « le seul homme de la famille » selon Napoléon, a elle aussi tenté, à Bordeaux, de s’opposer à la marée militaire montante de l’Empire renaissant, mais en vain. Un peu partout mais les autorités refont à l’envers le ralliement de l’an passé en se prononçant pour Napoléon.
Le Roi se fixe à Gand, à l’hôtel d’Hane, ce qui lui vaudra le surnom ironique de « notre père de Gand. » Hôte d’un notable belge, il affecte de continuer de mener une vie royale17, entouré par une petite cour où se trouvent d’anciens et de nouveaux émigrés, augmentée de fidèles et curieux qui font le « voyage sentimental18. »
Napoléon au pouvoir : un régime constitutionnel inspiré de la Charte de 1814 [VLR]
Pendant ce temps, Napoléon s’est remis à gouverner. Il a justifié son retour en prétendant qu’il est le souverain légitime car le seul approuvé par la volonté nationale, et il attribue sa chute de l’année précédente à des trahisons et non à des défaites. Il présente les Bourbons comme les détenteurs d’un droit d’origine féodale désormais obsolète et leur attribue de sombres projets de rétablissement de l’Ancien Régime. Le changement intervenu attire d’anciens révolutionnaires, notamment les régicides, et même Carnot, l’organisateur de la victoire de 1793, qui, resté distant pendant l’Empire dont il avait désapprouvé l’établissement, accepte de devenir ministre. En revanche, Napoléon choisit de s’appuyer sur les notables plutôt que sur les masses : l’Empereur, qui n’aime pas le désordre, ne veut pas être le roi de la canaille ou le chef d’une jacquerie.
Cependant, en un an, la Restauration a beaucoup transformé le pays et Napoléon déplore que Louis XVIII lui ait gâté la France. De fait, la paix et les nouvelles institutions libérales, ainsi que le retour à un cadre géographique purement français, avaient tout modifié très rapidement. Et, une fois passé le moment d’euphorie lié au vol de l’Aigle, le pays va se reprendre : les libéraux vont s’avérer de plus en plus critiques et les royalistes vont relever la tête.
Napoléon décide de faire rédiger une constitution nouvelle. L’on est ici à fronts renversés : si Louis XVIII avait, en 1814, avalisé nombre de traits de l’Empire, en 1815 c’est Napoléon qui imite la royauté restaurée et joue au roi constitutionnel. La constitution est censée se placer dans la continuité impériale : elle aura donc pour nom « Acte additionnel aux constitutions de l’Empire. » Mais, en fait, c’est une copie édulcorée de la Charte de Louis XVIII. Le moindre paradoxe n’est pas son rédacteur : Benjamin Constant, libéral précédemment rallié à la Restauration, qui avait peu auparavant comparé aimablement Napoléon à Attila et à Gengis Khan… L’Acte additionnel prévoit un souverain — l’Empereur — et deux chambres, la chambre des pairs — imitation de la Charte jusque dans le vocabulaire — et la chambre des représentants. Le suffrage reste censitaire, comme il l’était d’ailleurs redevenu depuis l’an X. Cependant les représentants doivent être réellement élus, comme sous la Restauration, alors que précédemment, sous le Consulat et l’Empire, les élections se bornaient à la présentation de plusieurs candidats au choix du pouvoir. Comme la Charte, l’Acte additionnel énumère des libertés publiques (liberté individuelle, de la presse, des cultes…), et elles seront d’ailleurs effectives pendant la période : le despotisme impérial n’aura ni le temps ni la possibilité de renaître. Bien évidemment, le texte constitutionnel réaffirme l’égalité des citoyens et la garantie des propriétés nationales. Au total, l’on a affaire à une Charte que l’on veut améliorée et qui est bien loin du régime impérial de naguère.
L’article 67 de l’Acte additionnel est un manifeste politique. Il interdit en effet de proposer le rétablissement des Bourbons, même en cas d’extinction de la dynastie impériale, ou celui de la noblesse féodale (seuls sont reconnus les titres impériaux), des droits féodaux ou d’un culte dominant, ou encore la remise en cause de la vente des biens nationaux.
Le désenchantement rapide et la reprise de la guerre [VLR]
L’Acte additionnel est publié le 21 avril. Cependant le désenchantement ne tarde pas à apparaître. Ainsi le plébiscite organisé pour approuver le nouveau texte constitutionnel, s’il donne une majorité écrasante d’opinions favorables, est-il cependant marqué par l’abstention de trois quarts des électeurs19. De même, lors des élections à la nouvelle chambre des représentants — Napoléon ayant dissous la chambre des députés, ex-corps législatif impérial qui avait été conservé par le Roi — l’abstention est de nouveau massive, et, au surplus, un certain nombre d’élus, faisant contraste avec la soumission de leurs prédécesseurs impériaux, adopte une attitude critique à l’égard du pouvoir.
Par ailleurs, l’Administration est troublée. Napoléon, attribuant sa chute, en 1814, à la trahison au profit de l’étranger et s’en prenant à ceux qui ont favorisé la Restauration ou ont été nommés par le Roi, entreprend de l’épurer. La magistrature, la police et les préfets sont fortement touchés. Mais, au surplus, alors même que certains ex-révolutionnaires, écartés en 1814, reprennent du service, beaucoup d’hommes politiques, de notables, de fonctionnaires, de magistrats, et même de chefs militaires, refusent de servir Napoléon. Certains le font par fidélité envers le Roi ou par respect de leur serment, d’autres par prudence ou par scepticisme envers une entreprise dont ils mesurent le caractère aléatoire. Napoléon rencontre des difficultés pour pourvoir tous les postes (par exemple pour la chambre des pairs). Son retour entraîne un renouvellement du personnel politique et administratif par rapport à la Restauration, mais aussi à l’Empire antérieur.
Et surtout, la reprise de la guerre met fin à l’enthousiasme qui avait saisi une partie du pays. Napoléon essaie de lier un contact avec les Alliés et se dit prêt à accepter de se contenter de régner à place de Louis XVIII, c’est-à-dire de manière pacifique sur une France privée de ses conquêtes. Mais les Alliés refusent de négocier avec lui et le mettent hors la loi dès le 13 mars 1815. Par la suite, le 25 mars, L’Autriche, la Prusse, la Russie et la Grande-Bretagne renouvellent leur alliance de 181420, et Talleyrand, qui avait tenté de dissocier cette coalition, se trouve forcé d’y adhérer au nom du Roi le 27 mars.
Une nouvelle invasion menace donc la France, et il va donc falloir lever de nouveau des armées dont l’Empereur prendra la tête. L’impopulaire conscription, abolie par Louis XVIII, réapparaît, et avec elle le rappel des hommes renvoyés dans leurs foyers21. Face à la masse des armées alliées qui menacent la France, la nécessaire remise sur pied de guerre d’une armée de nouveau hypertrophiée pose des problèmes de financement et d’équipement insolubles dans des délais brefs. Pendant ce temps les libéraux de la chambre, profitant de la liberté qui leur est laissée, se montrent de plus en plus critiques. Simultanément, la France des Blancs se réveille : les royalistes redressent la tête et il se produit même une insurrection en Vendée en mai, qui va obliger l’Empereur à fixer des troupes à l’Ouest… Il y a aussi des révoltes « blanches » en Anjou et en Bretagne. De même, certaines villes du Midi vont s’insurger au mois de juin.
Waterloo et la chute définitive de Napoléon [VLR]
Au plan militaire, l’on connaît la suite : comptant sur sa rapidité pour écraser les Alliés séparément, et vainqueur à plusieurs reprises, Napoléon est finalement vaincu à la bataille de Mont-Saint-Jean22, dite aussi bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Il revient alors à Paris, mais les pouvoirs publics ne le suivent plus dans ses projets de contre-offensive, et il se résigne à signer une seconde abdication en faveur de son fils qu’il proclame sous le nom de Napoléon II, le 22 juin 181523. Cet avènement est conforme aux règles constitutionnelles de l’Empire et n’a pas besoin d’être ratifié par les chambres, mais celles-ci vont le priver d’effet en n’organisant pas la régence. Au surplus le nouvel Empereur, qui n’a que quatre ans, se trouve alors à Vienne avec sa mère, chez son grand-père l’Empereur d’Autriche24… En fait, le pouvoir réel tombe, comme en 1814, entre les mains d’un gouvernement provisoire. Cette fois il s’agit d’une « Commission de Gouvernement » dirigée par Fouché, oratorien défroqué, régicide et terroriste, ancien et efficace ministre de la police de Napoléon qu’il trahit pour essayer de se ménager un avenir…
Fouché ignore l’Empereur enfant25, occupe les députés en leur confiant la préparation d’une nouvelle constitution et intrigue de plusieurs côtés. Comprenant que le retour de Louis XVIII est probable, il garde le contact avec les royalistes, et il s’écarte des intrigues de ceux qui voulaient substituer d’autres solutions à la branche aînée des Bourbons26. Finalement Fouché s’entend avec les royalistes et avec Talleyrand, revenu de Vienne27. Dès lors il annonce à ses collègues de la Commission de Gouvernement que leur rôle est terminé. Nul ne pense plus à Napoléon II, et, le 8 juillet 1815, un peloton de gardes nationaux envoyés par le nouveau préfet de police, un certain Élie Decazes, futur favori de Louis XVIII, suffit à mettre fin à la chambre des représentants des Cent Jours en fermant simplement les grilles du palais législatif.
C’est aussi le 8 juillet que le Roi est rentré à Paris et s’est réinstallé aux Tuileries, d’où il va présider aux destinées de la Seconde Restauration.
La mise en place de la Seconde Restauration.
Le retour de Louis XVIII dans un contexte d’occupation étrangère et de divisions internes [VLR]
Dès qu’il l’a pu, Louis XVIII est rentré dans son royaume. La propagande antimonarchique a prétendu que le Roi était revenu dans « les fourgons de l’étranger ». En réalité, Louis XVIII est revenu par ses propres moyens et nonobstant l’indifférence ou la mauvaise volonté des « Alliés », sauf de Wellington qui le soutient. Il a compris la nécessité de reprendre rapidement possession de son trône et de rétablir son administration de toute urgence, afin d’éviter que des intrigues ne prétendent substituer d’autres combinaisons à la royauté légitime28.
Cette fois, l’occupation de la France et notamment de Paris se passe mal, en particulier du fait des Prussiens, humiliés au temps de Napoléon. Il y a des pillages, des viols, des meurtres. Les Prussiens exigent des sommes importantes des Parisiens. Le gouvernement royal est obligé de lever un impôt de douze millions pour s’acquitter des contributions exigées par eux. Les Prussiens veulent aussi détruire les monuments rappelant les victoires françaises remportées sur eux, notamment le pont d’Iéna. L’arrivée du Roi, puis plus tard celle des représentants de l’Autriche et de la Russie, modéreront leurs exigences. Néanmoins les Alliés enlèvent du Louvre les œuvres prises par voie de conquête sous la Révolution et l’Empire. C’est ainsi que les chevaux de Venise retourneront à Saint-Marc. Pour son retour, le Roi s’abstient de faire chanter un Te Deum à Notre-Dame, soulignant ainsi implicitement qu’il mesure l’effet catastrophique des Cent Jours.
Une épuration limitée et la réorganisation du pouvoir [VLR]
Louis XVIII remanie son gouvernement. Il y appelle Talleyrand comme président du Conseil et ministre des affaires étrangères, et aussi Fouché29, ministre de la police, au grand dam de certains ultras mais aussi, curieusement, à la satisfaction d’une partie du faubourg Saint-Germain. Plusieurs figures marquantes de la Première Restauration sont écartées du gouvernement, notamment le chancelier Dambray, qui quitte les sceaux et assure la présidence de la chambre des pairs, le comte Ferrand, qui quitte le ministère pour la pairie, ou le duc de Blacas, nommé pair et ambassadeur.
La grande question qui se pose au Roi concerne l’attitude qu’il doit adopter à l’égard de ceux qui ont favorisé le retour de Napoléon ou se sont ralliés à lui pendant les Cent-Jours. D’une part il ne peut faire comme si rien ne s’était passé et comme si les défections n’avaient pas eu lieu ; d’autre part, une répression trop forte ne peut que rouvrir les plaies qu’il a voulu fermer l’année précédente30. Dans une déclaration de Cambrai du 28 juin 1815, Louis XVIII a promis le pardon aux « égarés », mais en a excepté les complices du retour de Napoléon. Pour cette épuration, Fouché, spécialiste des retournements politiques, a préparé une liste de plusieurs centaines de personnes (sic), laquelle sera finalement réduite à cinquante-sept (ordonnance du 24 juillet 1815). Parmi les victimes célèbres de la répression légale31, l’on peut citer le Maréchal Ney ou les généraux Labedoyère et Mouton-Duvernet qui seront fusillés, ou le directeur des postes Lavalette, qui réussira à s’échapper. Il y aura aussi plusieurs contumaces32.
La chambre des pairs est épurée : ceux qui ont soutenu Napoléon sont écartés. En revanche les pairs maintenus reçoivent l’hérédité que ce qui leur donne une certaine indépendance. Par ailleurs, il faut élire une nouvelle chambre des députés puisque celle de 1814 a été dissoute par Napoléon et celle des Cent jours a été de facto associée à la tentative napoléonienne. Le Roi convoque donc les électeurs censitaires. Le résultat est une assemblée ultra-royaliste, à tel point que le Roi lui-même la qualifie de « chambre introuvable ». Cette chambre va d’ailleurs embarrasser le gouvernement, et même parfois entrer en conflit avec lui, en se montrant « plus royaliste que le Roi. ». À sa décharge, l’on peut comprendre l’irritation des fidèles de la royauté de voir se maintenir au pouvoir les hommes des régimes précédents. Par exemple, la chambre décide, dans le cadre de la loi d’amnistie du 12 janvier 1816, d’ordonner aux régicides qui ont soutenu les Cent Jours de sortir du royaume, et cela contre l’avis du gouvernement33. Le rusé Fouché a, cette fois, été surpris : il va devoir s’exiler jusqu’à sa mort34. De même, alors que le ministre des finances estime qu’un gouvernement doit tout payer, même ses erreurs, s’il veut avoir du crédit, la chambre veut s’opposer au paiement des créanciers des Cent Jours, accusant le gouvernement de vouloir donner le denier de la veuve et l’orphelin aux « vautours de Bonaparte. » En 1816, Louis XVIII décide de dissoudre la chambre introuvable.
La refonte de l’armée et la normalisation des institutions [VLR]
En ce qui concerne les fonctionnaires, une ordonnance royale de juillet 1815 a remis les choses en l’état où elles étaient avant les Cent Jours. Fonctionnaires et officiers de la garde nationale sont invités à reprendre leurs fonctions telles qu’au départ du Roi. Toutes nominations effectuées depuis sont nulles. Un quart environ des fonctionnaires et officiers subit l’épuration.
L’armée, qui est massivement passée à Napoléon, est particulièrement visée. Elle est totalement refondue. Une ordonnance du 23 mars 1815, prise peu après le débarquement impérial, avait déjà prévu la dissolution des unités rebelles. Elle fut exécutée après les Cent Jours et après la soumission des troupes repliées au-delà de la Loire (ordonnance du 5 août 1815). À la place des unités dissoutes, le Maréchal Gouvion Saint-Cyr crée une légion par département, composée de volontaires royaux. Puis une commission qui siège entre octobre 1815 et mars 1817 choisit des officiers capables et fidèles parmi ceux de l’ancienne armée et parmi les membres des forces royalistes. Quant à la maison militaire du Roi, dont la reconstitution avait été critiquée, elle est réduite, et les compagnies supprimées sont remplacées par une garde royale composée de militaires de métier.
Le gouvernement mis en place en juillet 1815 dure d’ailleurs seulement jusqu’au 26 septembre. Pour tenir compte de la sensibilité fortement royaliste de la chambre, et pour mieux négocier avec les Alliés le Roi va faire appel à Armand-Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu, un personnage rigoureux et honnête qui, en émigration pendant l’Empire, était devenu un proche du tsar qui l’avait fait gouverneur d’Odessa, ce qui lui valait d’être brocardé par Talleyrand comme l’homme de France qui connaissait le mieux la Russie. Toujours est-il que le tsar exerce une action modératrice lors des négociations.
De fait, le pouvoir royal rétabli doit aussi faire face aux lourdes conséquences diplomatiques de la défaite napoléonienne. La Prusse, en particulier, souhaite priver la France d’une partie son territoire. Au final, au second traité de Paris du 20 novembre 1815, le rattachement des enclaves conservées en 1814 n’est pas remis en cause, mais la France perd quelques petits territoires frontaliers d’intérêt stratégique, au nord et à l’est35 et son morceau de la Savoie, outre quelques colonies que la Grande-Bretagne annexe. En outre il est décidé qu’une partie du territoire sera occupée par les troupes alliées pendant plusieurs années et, corrélativement, que de lourds frais d’occupation seront imposés36.
Conclusion
Les Cent-Jours : un tournant qui fragilise durablement la Restauration [VLR]
L’année 1815 a été celle d’une grande surprise : le retour de Napoléon. L’événement a surpris la royauté et l’a terrassée momentanément, contre toute attente. Le caractère passionnel du phénomène explique sans doute pour partie la rapide décrue de l’enthousiasme bonapartiste. La reprise de la guerre a sans doute profondément contribué à ce retour au réel. Mais ces trois mois ont eu une importance capitale pour le destin de la France au XIXe siècle.
La légende napoléonienne : un mythe fondateur pour le XIXe siècle [VLR]
Après la fin de l’aventure Napoléon est exilé à Sainte-Hélène. Là, sur ce rocher éloigné de l’Atlantique, il dicte ses souvenirs et ses réflexions et soigne son image pour la postérité. Le Mémorial de Sainte-Hélène forgera le trône non de son fils, qui mourra en Autriche en 1832, mais de son neveu. Alors que Napoléon est, par goût, un classique, sa trajectoire, qui l’inscrit dans la lignée d’Alexandre, de César et de Charles XII, va fasciner le siècle romantique de Stendhal à Barrès en passant par Hugo. Son retour a mis de son côté les puissances du sentiment, de l’imagination et de l’énergie. Cette épopée va rendre beaucoup plus difficile la ré-acclimatation de la royauté bourbonienne. L’imagination va alimenter la propagande bonapartiste : du Mémorial de Sainte-Hélène aux chansons de Béranger en passant par les gravures et les récits à la veillée, la légende napoléonienne, associée désormais au triomphe de la Liberté révolutionnaire, qu’elle contribue à dégager des excès terroristes, va imprégner la mentalité populaire. Les souffrances de la conscription, et le despotisme seront éclipsés par la gloire, le sang des batailles dissimulera celui de l’échafaud. Républicains et bonapartistes se rendront un temps des services mutuels, avant d’être opposés par l’histoire37.
La Restauration face à l’héritage révolutionnaire et bonapartiste : un combat inégal [VLR]
En face de ce romantisme la royauté est mal armée : elle va essayer de rappeler la mémoire du saint roi Louis IX, celle d’Henri IV, le réconciliateur, et celle du martyre de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Mais ces évocations ont quelque peine à exorciser le spectre impérial, toujours brillant et plus proche dans les mémoires. L’on ajoutera à cela une certaine indifférence de la royauté à ranimer et à maintenir la flamme chez ses partisans. Alors que républicains et bonapartistes rivalisent d’activité au service de leur propagande, la royauté ne fait rien, même dans l’Ouest ou à Bordeaux et à Marseille pour conserver et encadrer le puissant royalisme populaire de ces régions… De même qu’elle s’était méfiée des volontaires royaux la royauté, qui s’appuie sur les nobles et les notables censitaires, se soucie peu de popularité. Tout au plus tente-t-on de re-christianiser le pays38.
La Restauration et les traités de 1815 : entre réalisme diplomatique et procès injuste [VLR]
Les Cent-Jours vont aussi entraîner la reprise d’accusations injustes : la royauté sera accusée d’être revenue dans les fourgons de l’étranger et d’avoir consenti aux traités de 1815. La fin catastrophique de l’aventure napoléonienne était pourtant prévisible ; pour y échapper il n’y aurait eu qu’une alternative : la victoire à Waterloo. Elle était plus qu’aléatoire, et il n’a pas dépendu des Bourbons qu’elle n’ait pas eu lieu39. Si on s’en tient aux réalités, les Bourbons, héritiers d’une défaite dont ils n’étaient pas les auteurs, ont sauvé l’essentiel, à savoir le territoire français.
Quant aux traités de Vienne, les Bourbons ont su, par leur diplomatie, diviser les vainqueurs, soutenir les petits États et obtenir autant que possible le rétablissement d’une Europe équilibrée et pacifiée. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, méconnaissant ces bienfaits, romantiques et révolutionnaires ne rêvent que de revanche et donc de reprise de la guerre, au risque d’enflammer de nouveau l’Europe. Quant au principe des nationalités, qu’il a été reproché aux traités de Vienne d’avoir ignoré, il convient d’observer que la Révolution, après l’avoir proclamé, l’a bafoué en exploitant les pays conquis, et que Napoléon ne l’a pas davantage respecté. Au demeurant ce principe si chéri des républicains s’est avéré nocif et dangereux pour la France en provoquant notamment la création de l’unité allemande au cours du XIXe siècle. Le procès fait à la Restauration par les républicains et les bonapartistes est donc injuste et infondé40.
Vers la fin de la Restauration : l’échec d’une réconciliation nationale [VLR]
Mais le plus grave est ailleurs : avec les Cent jours, la tentative de réconciliation de 1814 a fait long feu. Désormais face aux royalistes, qu’ils soient ultras ou constitutionnels, les libéraux, les républicains et les bonapartistes n’attendent qu’une occasion pour en découdre avec la royauté. Il y aura des conspirations militaires (les quatre sergents la Rochelle…), des assassinats (duc de Berry), les campagnes de propagande et presse à tendance anticléricale, notamment contre les jésuites, ou anti-dynastique41. Finalement, en 1830, la royauté tombera sans avoir épuisé tous ses moyens de défense.
La Restauration apparaît comme une grande chance perdue42, et les évènements de 1815 y sont pour beaucoup. Dans une certaine mesure, le débarquement de Napoléon en 1815 a pour pendant l’embarquement de Charles X pour l’exil en 1830. La gloire de la légende napoléonienne a brisé la tentative qu’avait faite Louis XVIII de renouer le fil des temps et de rétablir l’unité de l’histoire de France.
Franck Bouscau, Professeur Agrégé des Facultés de Droit.
Sources et bibliographie sommaire
Les événements sont décrits par les mémoires des contemporains (notamment les Mémoires d’Outre-Tombe de Chateaubriand), les biographies de Louis XVIII (La Gorce, Mansel) et les histoires générales de la Restauration (notamment Marie de Roux, Bertier de Sauvigny et Emmanuel de Waresquiel).
Pour les Cent Jours, l’on aura l’embarras du choix dans l’énorme bibliographie napoléonienne et l’on se bornera à rappeler quelques auteurs (Bainville, Jean Tulard…) L’ouvrage d’Emmanuel de Waresquiel Cent Jours. La tentation de l’impossible. Mars-juillet 1815 (Paris, Fayard, 2008, et Tallandier, 2014) a l’intérêt de présenter le point de vue royal pendant cette période.
Les textes de la Charte de 1814 et de l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire ont été maintes fois publiés dans des recueils de textes constitutionnels et peuvent être consultés sur internet.
Au plan de la vie politique et institutionnelle l’on pourra se reporter à divers ouvrages d’Histoire du Droit et de Droit constitutionnel. L’on citera ici, sans prétendre à l’exhaustivité, quelques uns des plus usuels :
Ponteil (Félix), Les institutions de la France au XIXe siècle, Paris, P.U.F., 1966 ;
Timbal (Pierre-Clément) et Castaldo (André), Histoire des institutions et des faits sociaux, Paris, Dalloz (précis Dalloz), 1985 ;
Ellul (Jacques), Histoire des institutions, tome 5, Paris, PUF (Thémis), 1992 ;
Antonetti (Guy), Histoire contemporaine politique et sociale, Paris, PUF (Droit fondamental),1999 ;
Morabito (Marcel), Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours, Paris, LGDJ, 2014.
- La liberté des cultes reste garantie, malgré la proclamation du catholicisme comme religion d’État.↩
- En particulier, il présidera à la conclusion d’un traité secret entre la France, la Grande-Bretagne et l’Autriche du 3 janvier 1815. Ce traité avait pour but de contenir les ambitions russes et prussiennes en Allemagne. Il rompait la coalition des anciens alliés que le retour de Napoléon allait ressouder.↩
- Le chassé-croisé entre Louis XVIII et Napoléon a fait l’objet d’une pièce de théâtre de Jean Anouilh, La foire d’empoigne.↩
- Cette indemnisation justifiée, mais partielle, sera réalisée plus tard, sous Charles X, par le ministère Villèle.↩
- La guerre a été déclenchée par l’Assemblée législative de 1792 et, jusqu’en 1814, il n’y a eu de paix générale que pendant un peu plus d’un an après la paix d’Amiens (25 mars 1802).↩
- Dans Servitude et grandeur militaires, Alfred de Vigny raconte des épisodes de la retraite de quelques soldats royaux qui ont accompagné Louis XVIII pendant les Cent Jours.↩
- Traité de Fontainebleau conclu entre Napoléon et les représentants de l’Autriche, de la Prusse et de la Russie.↩
- Le gouvernement de Louis XVIII a « hérité » de cette charge prévue par le traité de Fontainebleau, passé entre Napoléon et les Alliés, qu’il n’a pas négocié.↩
- C’est à cette occasion que commenceront, dans le roman d’Alexandre Dumas, le Comte de Monte-Cristo, les malheurs du héros du livre, Dantès.↩
- L’expression est restée. L’historien Jean Tulard a préféré parler des « Vingt jours », en portant son attention sur la brève période au cours de laquelle l’Empereur-revenant a repris à l’arraché le pouvoir au Roi. (Les Vingt Jours. Louis XVIII ou Napoléon ? , Paris, Fayard, 2001.)↩
- Deux ordonnances des 9 et 11 mars 1815 rappelleront même les demi-soldes… qui se rallieront à Napoléon.↩
- Par dérision, l’on fait circuler une fausse lettre de Napoléon à Louis XVIII dans laquelle l’Empereur écrit au Roi son « bon frère » de ne plus lui envoyer de soldats parce qu’il en a suffisamment…↩
- Le 11 mars 1815 une ordonnance royale invite les Conseils généraux à siéger en permanence et à prendre des mesures de salut public. C’est un précédent de la célèbre loi Tréveneuc du 15 février 1872 qui prévoit le recours aux Conseils généraux en cas d’impossibilité pour le Parlement de se réunir…↩
- Il est vain, de se demander ce qui se serait passé si le Roi était tombé entre les mains de son compétiteur. Le moins improbable n’est pas que Louis XVIII aurait pu devenir un prisonnier impuissant lors de la chute de Napoléon…↩
- Le romancier communiste Louis Aragon a décrit dans un roman, la Semaine sainte, qui se passe du 19 au 26 mars 1815, le voyage de Louis XVIII et de son entourage de Paris à Béthune. Il s’attache particulièrement à la figure du peintre Théodore Géricault qui accompagne la retraite du Roi.↩
- Cette discordance entre une armée quasi-unanimement bonapartiste et des populations majoritairement royalistes, au moins dans certaines régions comme le Nord, l’Ouest ou le Midi, est l’un des aspects les plus curieux des Cent Jours.↩
- L’on disait, il est vrai, que Louis XVIII était Roi partout comme Dieu est Dieu partout !↩
- Le jeune Lamartine fait partie du voyage, et le jeune Guizot ira voir le Roi exilé.↩
- Bluche (Frédéric), Le plébiscite des Cent Jours (avril-mai 1815), Genève, Droz, 1974.↩
- Le 1er mars 1814, par le pacte de Chaumont, les quatre grandes puissances s’étaient promis une assistance mutuelle en cas d’agression française et s’étaient engagées à ne pas traiter séparément avec la France.↩
- La classe 1815 avait été licenciée par le gouvernement royal.↩
- C’est le nom qu’utilise Victor Hugo dans le long passage des Misérables où il décrit cette bataille.↩
- Envisageant de quitter la France pour l’Amérique, Napoléon gagne le rivage atlantique. Finalement, le 15 juillet, il se rend aux Anglais qui le déportent à Sainte-Hélène.↩
- Napoléon II, qui a ignoré son destin impérial à l’époque, va devenir le duc autrichien de Reichstadt.↩
- La Commission de Gouvernement n’affecte pas d’agir en son nom.↩
- Plutôt qu’à la République, difficilement acceptable pour les Alliés, certains pensent à la substitution d’un autre souverain à Louis XVIII (notamment, déjà, au futur Louis-Philippe).↩
- L’ambiance est bien rendue par la pièce Le Souper de Jean-Claude Brisville, écrite en 1989 et qui est censée se passer le 6 juillet 1815. Elle met en scène les tractations entre Fouché et Talleyrand.↩
- Cette attitude pragmatique de Louis XVIII s’est avérée efficace. Elle fait contraste avec celle de son petit-neveu, Henri, comte de Chambord, qui, lors de la tentative de restauration de 1873, est resté volontairement en exil au lieu de peser par sa présence sur les tractations en cours.↩
- Dans un passage célèbre des Mémoires d’outre-Tombe, Chateaubriand décrit cette promotion de l’ancien révolutionnaire, qu’il vit passer alors qu’il se trouvait à proximité du cabinet du Roi : « Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, M. de Talleyrand marchant soutenu par Monsieur Fouché ; la vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du Roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur ; le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr ; l’évêque apostat fut caution du serment. »↩
- Plusieurs lois restreignent les libertés publiques. Il en va ainsi de la loi de sûreté générale du 29 octobre 1815, qui permet l’emprisonnement des suspects de complots, et de la loi sur les discours et écrits séditieux du 9 novembre 1815.↩
- Il y a aussi une répression « sauvage » et populaire, la « terreur blanche » au cours de l’été et du début de l’automne 1815. Dans l’Ouest et dans le Midi des républicains et des bonapartistes sont massacrés par des partisans de royauté ou prétendus tels. Regrettable, ce phénomène n’a cependant rien des dimensions de la terreur jacobine ou de l’épuration de 1945. L’on évalue le nombre de victimes à trois cents à cinq cents.↩
- Le clan Bonaparte, d’ailleurs déjà dispersé, est exilé par une loi du 1er janvier 1816. Le cardinal Fesch ne fait pas exception.↩
- Cette mesure, critiquée par certains historiens, n’apparaît ni vraiment anormale, ni exagérément sévère.↩
- Nommé duc d’Otrante par Napoléon, l’exilé Fouché va faire souche de ducs suédois.↩
- La frontière de l’Est est restée la même jusqu’en 1870, époque à laquelle la France a été amputée de l’Alsace-Moselle. Lorsqu’elle récupérera ces provinces en 1918, le gouvernement de la République s’en tiendra à la frontière de 1815, alors qu’il eût été possible de revenir à celle, plus avantageuse, de 1814.↩
- Par la suite, le gouvernement du Roi réussit à obtenir une diminution de l’indemnité et l’occupation qui prit fin de manière anticipée en 1818.↩
- Sous la Restauration, républicains, bonapartistes et libéraux commencent un long compagnonnage. Unis à l’époque du retour de la monarchie légitime, ils vont cependant se séparer. Les libéraux feront les premières cavaliers seuls en 1830, en faisant triompher la royauté orléaniste. Bonapartistes et républicains la combattront et imposeront la République en 1848. Cependant en 1851 le coup d’État du Prince-président entraînera un divorce profond entre les alliés de la veille, les républicains s’estimant floués par Napoléon le Petit. En 1870, ils ne craindront pas de faire la révolution devant l’ennemi pour chasser la dynastie Bonaparte. L’héritage du bonapartisme se divisera alors entre une cause dynastique comparable au monarchisme, d’une part, et des velléités plébiscitaires et anti-parlementaires spasmodiques (ex : le boulangisme) redoutées des républicains et des libéraux réconciliés, d’autre part.↩
- À ce propos les adversaires du régime ne manqueront pas de critiquer l’alliance du trône de l’autel et d’attaquer la religion.↩
- Et encore… en cas de victoire à Waterloo, le sort de l’empire napoléonien aurait dépendu de la bataille suivante.
Dans une curieuse Histoire de la conquête du monde et de la monarchie universelle, 1812-1832, un auteur utopique, Louis Geoffroy, rêve de ce que l’histoire aurait été si Napoléon avait pu imposer sa domination générale…↩
- Faut-il voir une tradition républicaine dans le fait de faire endosser aux régimes qui liquident la faillite de leurs prédécesseurs la responsabilité de catastrophes dont ils ne sont pas les auteurs ? L’on sait le sort injuste réservé à la Libération au Maréchal Pétain et au Gouvernement de Vichy qui avaient tenté d’atténuer les conséquences de la défaite de 1940…↩
- Cf. Dernier (Francis), « Les modèles révolutionnaires du ‘’Parti National’’en 1830 », revue Romantisme, 1980, vol. 10, n°28, p. 47-68, qui montre la célébration de 1789 dans un sens libéral, et de la révolution anglaise de 1688 qui a abouti à un changement de branche royale.↩
- Cf. Raillat (Landric), Charles X, le sacre de la dernière chance, Paris, Orban,1991.↩