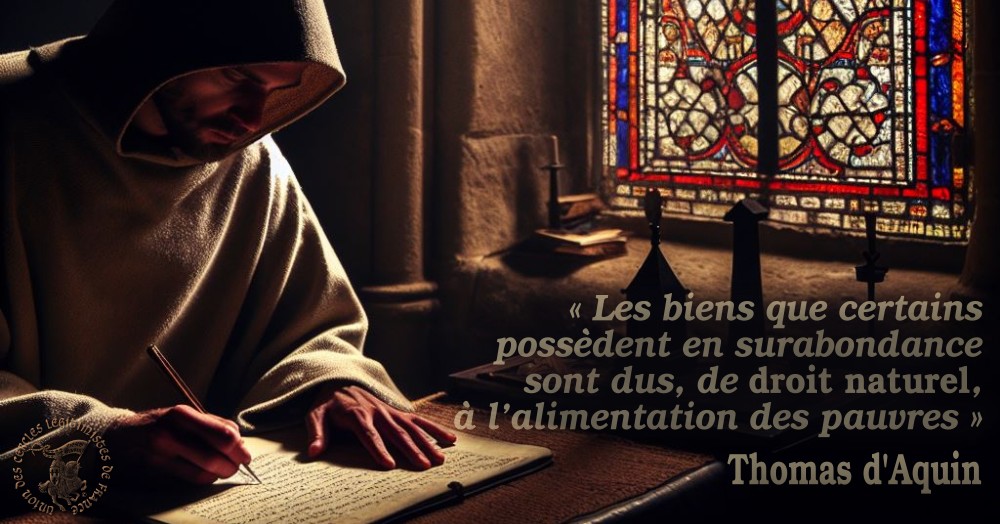La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 consacre le triomphe du matérialisme bourgeois et proclame la propriété comme un « droit naturel et imprescriptible * ». Or, rappelle Saint Thomas d’Aquin, la propriété, le commerce et l’argent, ne sauraient revêtir un caractère absolu. En effet, les biens extérieurs appartiennent à Dieu leur Créateur ; ils n’appartiennent à l’homme que pour leur usage, pour lui permettre une vie corporelle. Pour cette dernière raison, les biens que certains possèdent en surabondance sont dus, de droit naturel, à l’alimentation des pauvres. De même, en cas d’extrême nécessité, il est permis de se servir du bien d’autrui sans pour autant commettre un vol. Donc, si la propriété est souhaitable, elle n’est pourtant pas de droit naturel, mais de droit humain ; et en tant que telle, l’autorité politique peut la limiter et l’encadrer pour le bien commun.
Dans les textes qui suivent — tirés de la Somme théologique — saint Thomas rappelle ce devoir de chercher l’« égalité de la justice » pour régir la propriété, le commerce et l’argent. [La Rédaction]
* Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Article 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
Table des matières
Introduction de Vive le Roy
Textes tirés de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin.
SOURCE : Site Docteur angélique.
Signification d’une référence du type (II II 66 1) :
– La Somme théologique est divisée en trois parties principales, chacune étant subdivisée en questions, articles et arguments.
– La référence (IIa IIae 66 1) signifie : Deuxième partie (IIa), deuxième section (IIae), question 66, article 1er.
La possession de biens extérieurs est-elle naturelle à l’homme ? (IIa IIae 66 1)
Résumé de VLR
Les biens extérieurs n’appartiennent qu’à Dieu quant à leur nature, car la création appartient au Créateur qui en dispose à sa guise.
Les biens extérieurs n’appartiennent à l’homme que pour leur usage, pour lui permettre une vie corporelle.
Saint Thomas (Extrait)
Les biens extérieurs peuvent être envisagés sous un double aspect.
– D’abord quant à leur nature, qui n’est pas soumise au pouvoir de l’homme mais de Dieu seul, à qui tout obéit docilement.
– Puis quant à leur usage ; sous ce rapport l’homme a un domaine naturel sur ces biens extérieurs, car par la raison et la volonté il peut s’en servir pour son utilité, comme étant faits pour lui.
On a démontré plus haut, en effet, que les êtres imparfaits existent pour les plus parfaits. C’est ce principe qui permet à Aristote de prouver que la possession des biens extérieurs est naturelle à l’homme. Et cette domination naturelle sur les autres créatures, qui convient à l’homme parce qu’il a la raison, ce qui fait de lui l’image de Dieu, cette domination se manifeste dans sa création même, lorsque Dieu dit (Gn 1, 26) :
Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les oiseaux du Ciel…
Dieu a la maîtrise de tous les êtres, étant leur principe. Et c’est lui qui, selon l’ordre de sa providence, a ordonné certaines choses à sustenter la vie corporelle de l’homme. C’est pour cela que l’homme a la possession naturelle de ces choses, en ce qu’il a le pouvoir d’en faire usage.
Ce riche est blâmé parce qu’il croyait que les biens extérieurs lui appartenaient à titre principal, comme s’il ne les avait pas reçus d’un autre, c’est-à-dire de Dieu.
Est-il licite de posséder en propre un de ces biens ? (IIa IIae 66 2)
Résumé de VLR
La communauté des biens est de droit naturel, contrairement à la propriété qui n’est que de droit humain.
Cependant la propriété n’est pas contraire au droit naturel, elle s’y surajoute par une précision due à la raison humaine.
La propriété est même nécessaire à la vie humaine selon la raison. Entre autres, chacun est plus attentif et gère mieux le bien qui lui appartient que le bien d’une communauté.
Cependant l’homme ne doit pas posséder ces biens comme s’ils lui étaient propres, mais comme étant à tous, en ce sens qu’il doit les partager volontiers avec les nécessiteux.
Saint Thomas (Extrait)
Deux choses conviennent à l’homme au sujet des biens extérieurs.
D’abord le pouvoir de les gérer et d’en disposer ; et sous ce rapport il lui est permis de posséder des biens en propre. C’est même nécessaire à la vie humaine, pour trois raisons :
1° Chacun donne à la gestion de ce qui lui appartient en propre des soins plus attentifs qu’il n’en donnerait à un bien commun à tous ou à plusieurs ; parce que chacun évite l’effort et laisse le soin aux autres de pourvoir à l’œuvre commune ; c’est ce qui arrive là où il y a de nombreux serviteurs.
2° Il y a plus d’ordre dans l’administration des biens quand le soin de chaque chose est confié à une personne, tandis que ce serait la confusion si tout le monde s’occupait indistinctement de tout.
3° La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun est satisfait de ce qui lui appartient ; aussi voyons-nous de fréquents litiges entre ceux qui possèdent une chose en commun et dans l’indivis.
Ce qui convient encore à l’homme au sujet des biens extérieurs, c’est d’en user. Et sous tout rapport l’homme ne doit pas posséder ces biens comme s’ils lui étaient propres, mais comme étant à tous, en ce sens qu’il doit les partager volontiers avec les nécessiteux. Aussi saint Paul écrit-il (Tm 1 6, 17-18) :
Recommande aux riches de ce monde… de donner de bon cœur et de savoir partager.
La communauté des biens est dite de droit naturel, non parce que le droit naturel prescrit que tout soit possédé en commun et rien en propre, mais parce que la division des possessions est étrangère au droit naturel ; elle dépend plutôt des conventions humaines et relèvera par là du droit positif, comme on l’a établi plus haut. Ainsi la propriété n’est pas contraire au droit naturel, mais elle s’y surajoute par une précision due à la raison humaine.
Celui qui, arrivé le premier au théâtre, en faciliterait l’accès aux autres n’agirait pas d’une manière illicite, mais bien s’il leur en interdisait l’entrée. De même, le riche n’est pas injuste, lorsque s’emparant le premier de la possession d’un bien qui était commun à l’origine, il en fait part aux autres. Il ne pèche qu’en leur interdisant à tous d’en user. C’est pourquoi saint Basile peut dire :
Pourquoi es-tu dans l’abondance, et lui dans la misère, sinon pour que tu acquières les mérites du partage et lui pour qu’il obtienne le prix de la patience ?
Est-il permis de voler en cas de nécessité ? (IIa IIae 66 7)
Résumé de VLR
La propriété n’est jamais un absolu, car elle est de droit humain.
En revanche les biens que certains possèdent en surabondance sont dus, de droit naturel, à l’alimentation des pauvres.
Ainsi, en cas d’extrême nécessité, est-il permis de se servir du bien d’autrui sans pour autant commettre un vol, car, du fait de cette nécessité, ce que nous prenons pour conserver notre propre vie devient nôtre.
Saint Thomas (Extrait)
Ce qui est de droit humain ne saurait déroger au droit naturel ou au droit divin. Or, selon l’ordre naturel établi par la providence divine, les êtres inférieurs sont destinés à subvenir aux nécessités de l’homme. C’est pourquoi leur division et leur appropriation, œuvre du droit humain, n’empêchent pas de s’en servir pour subvenir aux nécessités de l’homme. Voilà pourquoi les biens que certains possèdent en surabondance sont dus, de droit naturel, à l’alimentation des pauvres ; ce qui fait dire à saint Ambroise et ses paroles sont reproduites dans les Décrets :
C’est le pain des affamés que tu détiens ; c’est le vêtement de ceux qui sont nus que tu renfermes ; ton argent, c’est le rachat et la délivrance des miséreux, et tu l’enfouis dans la terre.
Toutefois, comme il y a beaucoup de miséreux et qu’une fortune privée ne peut venir au secours de tous, c’est à l’initiative de chacun qu’est laissé le soin de disposer de ses biens de manière à venir au secours des pauvres.
Si cependant la nécessité est tellement urgente et évidente que manifestement il faille secourir ce besoin pressant avec les biens que l’on rencontre — par exemple, lorsqu’un péril menace une personne et qu’on ne peut autrement la sauver —, alors quelqu’un peut licitement subvenir à sa propre nécessité avec le bien d’autrui, repris ouvertement ou en secret. Il n’y a là ni vol ni rapine à proprement parler.
Se servir du bien d’autrui que l’on a dérobé en secret dans un cas d’extrême nécessité n’est pas un vol à proprement parler, car, du fait de cette nécessité, ce que nous prenons pour conserver notre propre vie devient nôtre. Cette même nécessité fait que l’on peut aussi prendre subrepticement le bien d’autrui pour aider le prochain dans la misère.
Y-a-t-il un précepte de faire l’aumône ? (IIa IIae 32 5)
Résumé de VLR
Les biens temporels d’un homme le sont quant à la propriété (de droit humain), mais ils ne sont pas à lui seul quant à l’usage (de droit naturel).
Donc le superflu appartient de droit naturel à celui qui est dans l’extrême nécessité.
Donc l’aumône de son superflu à celui qui est dans l’extrême nécessité est un devoir sous peine de péché mortel.
Saint Thomas (Extrait)
Puisque l’amour du prochain est de précepte, il est nécessaire que tout ce qui est indispensable pour le garder soit aussi de précepte. Or, en vertu de cet amour, non seulement nous devons vouloir du bien à notre prochain mais encore lui en faire :
N’aimons ni en paroles ni en discours, mais en acte et en vérité…
… dit saint Jean (1 Jn 3, 18). Mais on ne saurait vouloir du bien à son prochain, si on ne le secourt pas dans la nécessité, c’est-à-dire si on ne lui fait pas l’aumône. Celle-ci est donc de précepte.
Mais parce que les préceptes portent sur les actes des vertus, faire l’aumône sera obligatoire dans la mesure où cet acte sera nécessaire à la vertu, c’est-à-dire selon que la droite raison l’exige. Or cela entraîne deux ordres de considérations, relatifs l’un à celui qui fait l’aumône, l’autre à celui qui doit la recevoir.
– Du côté du donateur, il est à remarquer que les aumônes doivent être faites de son superflu. Comme il est prescrit en saint Luc (11, 41) :
Faites l’aumône avec le surplus.
Par là il faut entendre non seulement ce qui dépasse les besoins du donateur, mais encore les besoins de ceux dont il a la charge. Chacun, en effet, doit pourvoir d’abord à ses besoins propres et aux besoins de ceux dont il a la charge (en ce sens on parle de ce qui est nécessaire à la « personne », ce mot impliquant la responsabilité.) Cela fait, on viendra en aide aux autres avec le reste dont on disposera. C’est ainsi que la nature se procure d’abord la nourriture nécessaire à soutenir le corps ; ensuite, par la génération, elle émet ce qui est superflu pour engendrer un être nouveau.
– Du côté du bénéficiaire, il est requis qu’il soit dans le besoin ; sans cela l’aumône n’aurait pas de raison d’être. Mais comme il est impossible à chacun de secourir tous ceux qui sont dans le besoin, le précepte n’oblige pas à faire l’aumône dans tous les cas de nécessité ; seule oblige sous le précepte la nécessité de celui qui ne pourrait être secouru autrement. Alors s’applique la parole de saint Ambroise :
Nourris celui qui meurt de faim. Si tu ne le fais pas, tu es cause de sa mort.
En conclusion, voici ce qui est de précepte : faire l’aumône de son superflu, et la faire à celui qui est dans une extrême nécessité. En dehors de ces conditions, faire l’aumône est de conseil, comme n’importe quel bien meilleur.
Les biens temporels que l’homme a reçus de Dieu sont à lui quant à la propriété, mais quant à l’usage, ils ne sont pas à lui seul, mais également aux autres, qui peuvent être secourus par ce qu’il a de superflu. Comme dit saint Basile :
Si tu confesses avoir reçu de Dieu ces biens (c’est-à-dire les biens temporels), Dieu doit-il être accusé d’injustice pour les avoir inégalement répartis ? Tu es dans l’abondance, celui-ci est réduit à mendier ; pourquoi cela, sinon pour que toi tu acquières le mérite d’une bonne dispensation, et lui, la récompense de la patience ? C’est le pain de l’affamé que tu retiens, le vêtement de celui qui est nu que tu gardes sous clef, la chaussure de celui qui n’en a pas qui se détériore chez toi, l’argent de celui qui en manque que tu tiens enfoui. En conséquence, tes injustices sont aussi nombreuses que les dons que tu pourrais faire.
Saint Ambroise parle de même.
On peut déterminer un temps où faire l’aumône oblige sous peine de péché mortel ;
– du côté du bénéficiaire, l’aumône doit lui être faite lorsqu’elle apparaît d’une évidente et urgente nécessité, et que nul autre ne se présente à ce moment pour le secourir ;
– du côté du donateur, il doit donner lorsqu’il possède un superflu qui, selon toutes probabilités, ne lui est pas présentement nécessaire.
Et il n’y a pas ici à s’arrêter à tout ce qui pourrait arriver dans l’avenir : ce serait « avoir souci du lendemain », ce que le Seigneur interdit (Mt 6, 34). Ainsi, le superflu et le nécessaire doivent être appréciés d’après les circonstances probables et communes.
Tout secours donné au prochain se ramène au commandement d’honorer son père et sa mère. C’est ainsi que l’entend l’Apôtre (1 Tm 4, 8) :
La piété est utile à tout ; car elle a la promesse de la vie, de la vie présente comme de la vie future.
Il parle ainsi parce qu’au précepte d’honorer ses parents s’ajoute cette promesse :
afin d’avoir une longue vie sur terre (Ex 20, 12).
Or, dans la piété sont incluses toutes les espèces d’aumônes.
L’avarice est-elle un péché ? (IIa IIae 118 1)
Résumé de VLR
Les biens extérieurs sont ordonnés à une fin qui est d’assurer raisonnablement la vie de l’homme à mesure de sa condition.
L’avarice est un péché contre le prochain, car acquérir ou conserver les biens extérieurs plus qu’on ne doit, c’est forcément priver un autre qui en aurait besoin.
Saint Thomas (Extrait)
Partout où le bien consiste en une mesure déterminée, le mal découle nécessairement d’un dépassement ou d’une insuffisance de cette mesure.
Or, dans tout ce qui est moyen en vue d’une fin, le bien consiste en une certaine mesure, déterminée par cette fin, comme le remède par la santé à obtenir, selon Aristote.
Or les biens extérieurs ont raison d’outils en vue d’une fin, nous venons de le dire.
Aussi est-il nécessaire que le bien de l’homme à leur égard consiste en une certaine mesure ; c’est-à-dire selon laquelle il cherche à posséder des richesses extérieures pour autant qu’elles sont nécessaires à le faire vivre selon sa condition.
Et c’est pourquoi il y a péché dans le dépassement de cette mesure lorsqu’on veut les acquérir ou les garder au-delà de la mesure requise.
Et cela rejoint la raison de l’avarice, car celle-ci se définit « un amour immodéré de la possession ». Il est donc évident que l’avarice est un péché.
Il est naturel à l’homme de désirer les biens extérieurs comme des moyens en vue d’une fin. C’est pourquoi il n’y a pas de vice pour autant que ce désir se maintient à l’intérieur d’une règle tirée de la raison de fin. Mais l’avarice passe outre à cette règle, et c’est pourquoi elle est un péché.
L’avarice peut impliquer une démesure de deux façons concernant les biens extérieurs.
– D’une première façon, elle est immédiate et concerne l’acquisition ou la conservation de ces biens, c’est-à-dire qu’on les acquiert ou qu’on les conserve plus qu’on ne doit. De cette façon l’avarice est un péché directement commis contre le prochain, parce qu’un homme ne peut avoir en excès des richesses extérieures sans qu’un autre en manque, parce que les biens temporels ne peuvent pas avoir plusieurs possesseurs à la fois.
– D’une autre façon, l’avarice peut impliquer une démesure dans les affections que l’on porte intérieurement aux richesses, parce qu’on les aime ou les désire, ou qu’on y prend son plaisir, d’une façon immodérée. Ainsi l’avarice est un péché commis par l’homme contre lui-même parce que ce péché dérègle ses affections, bien qu’il ne dérègle pas son corps, comme les vices charnels. Par voie de conséquence, c’est un péché contre Dieu, comme tous les péchés mortels, en tant que l’on méprise le bien éternel à cause du bien temporel.
Les inclinations naturelles doivent être réglées par la raison, qui a un rôle primordial dans la nature humaine. Et c’est pourquoi les vieillards, à cause de la diminution de leurs forces, recherchent plus aisément le secours des biens extérieurs, de même que tout indigent cherche à combler son indigence ; cependant ils ne sont pas, excusés de péché s’ils dépassent, au sujet des richesses, la juste mesure raisonnable.
Est-il permis de vendre une chose plus cher qu’elle ne vaut ? (IIa IIae 77 1)
Résumé de VLR
L’égalité de la justice est détruite si le prix dépasse en valeur la quantité de marchandise fournie, ou si inversement la marchandise vaut plus que son prix.
Donc, vendre une marchandise plus cher, ou l’acheter moins cher qu’elle ne vaut, est de soi injuste et illicite. Il faut toujours rechercher le juste prix.
Saint Thomas (Extrait)
User de fraude pour vendre une chose au-dessus de son juste prix est certainement un péché, car on trompe le prochain à son détriment. C’est ce qui fait dire à Cicéron :
Tout mensonge doit être exclu des contrats ; le vendeur ne fera pas venir un acheteur qui enchérisse, ni l’acheteur un vendeur qui offre un prix moins élevé.
Mais toute fraude exclue, nous pouvons examiner l’achat et la vente sous un double point de vue.
D’abord en eux-mêmes. De ce point de vue, l’achat et la vente semblent avoir été institués pour l’intérêt commun des deux parties, chacune d’elles ayant besoin de ce que l’autre possède, comme le montre Aristote. Or, ce qui est institué pour l’intérêt commun ne doit pas être plus onéreux à l’un qu’à l’autre. Il faut donc établir le contrat de manière à observer l’égalité entre eux.
Par ailleurs la quantité ou valeur d’un bien qui sert à l’homme se mesure d’après le prix qu’on en donne ; c’est à cet effet, dit Aristote, qu’on a inventé la monnaie. Par conséquent, si le prix dépasse en valeur la quantité de marchandise fournie, ou si inversement la marchandise vaut plus que son prix, l’égalité de la justice est détruite. Et voilà pourquoi vendre une marchandise plus cher ou l’acheter moins cher qu’elle ne vaut est de soi injuste et illicite.
En second lieu, l’achat et la vente peuvent en certaines circonstances tourner à l’avantage d’une partie et au détriment de l’autre ; par exemple lorsque quelqu’un a grandement besoin d’une chose et que le vendeur soit lésé s’il ne l’a plus.
Dans ce cas le juste prix devra être établi non seulement d’après la valeur de la chose vendue, mais d’après le préjudice que le vendeur subit du fait de la vente. On pourra alors vendre une chose au-dessus de sa valeur en soi, bien qu’elle ne soit pas vendue plus qu’elle ne vaut pour celui qui la possède.
Mais si l’acheteur tire un grand avantage de ce qu’il reçoit du vendeur, et que ce dernier ne subisse aucun préjudice en s’en défaisant, il ne doit pas le vendre au-dessus de sa valeur. Parce que l’avantage dont bénéficie l’acheteur n’est pas au détriment du vendeur, mais résulte de la situation de l’acheteur ; or on ne peut jamais vendre à un autre ce qui ne vous appartient pas, bien qu’on puisse lui vendre le dommage que l’on subit. Cependant celui qui acquiert un objet qui lui est très avantageux, peut spontanément payer au vendeur plus que le prix convenu ; c’est honnête de sa part.
Comme nous l’avons écrit la loi humaine régit une société dont beaucoup de membres n’ont guère de vertu ; or elle n’a pas été faite seulement pour les gens vertueux. La loi ne peut donc réprimer tout ce qui est contraire à la vertu, elle se contente de réprimer ce qui tendrait à détruire la vie en commun ; on peut dire qu’elle tient tout le reste pour permis, non qu’elle l’approuve, mais elle ne le punit pas. C’est ainsi que la loi, n’infligeant pas de peine à ce sujet, permet au vendeur de majorer le prix de sa marchandise et à l’acheteur de l’acheter moins cher, pourvu qu’il n’y ait pas de fraude et qu’on ne dépasse pas certaines limites ; dans ce dernier cas, en effet, la loi oblige à restituer, par exemple si l’un des contractants a été trompé pour plus de la moitié du juste prix. Mais rien de ce qui est contraire à la vertu ne reste impuni au regard de la loi divine. Or la loi divine considère comme un acte illicite le fait de ne pas observer l’égalité de la justice dans l’achat et dans la vente. Celui qui a reçu davantage sera donc tenu d’offrir une compensation à celui qui a été lésé, si toutefois le préjudice est notable.
Si j’ajoute cette précision, c’est que le juste prix d’une chose n’est pas toujours déterminé avec exactitude, mais s’établit plutôt à l’estime, de telle sorte qu’une légère augmentation ou une légère diminution de prix ne semble pas pouvoir porter atteinte à l’égalité de la justice.
Saint Augustin explique au même endroit :
Ce comédien, en se regardant lui-même ou d’après son expérience des autres, a cru que tout le monde veut acheter à bas prix et vendre cher. Mais comme ce sentiment est certainement vicieux, chacun peut acquérir la justice qui lui permettra d’y résister et de le vaincre.
Et il cite l’exemple d’un homme qui, pouvant avoir un livre pour un prix modique à cause de l’ignorance du vendeur, paya néanmoins le juste prix. Cela prouve que ce désir généralisé n’est pas un désir naturel mais vicieux. Aussi est-il commun à beaucoup : ceux qui marchent dans la voie large des vices.
En justice commutative, on considère principalement l’égalité des choses échangées. Mais dans l’amitié utile, on considère l’égalité de l’utilité respective ; et c’est pourquoi la compensation qu’il faut accorder doit être proportionnée à l’utilité dont on a tiré profit. Dans l’achat au contraire, elle sera proportionnée à l’égalité de la chose échangée.
La vente injuste en ce qui concerne la marchandise (IIa IIae 77 2)
Résumé de VLR
L’égalité de la justice est rompue, et il y a faute du vendeur, si sciemment il trompe l’acheteur sur la nature de son produit, sa quantité ou sa qualité.
Saint Thomas (Extrait)
Trois défauts peuvent affecter un objet à vendre.
– L’un porte sur la nature de cet objet. Si le vendeur sait que l’objet qu’il vend a ce défaut, il commet une fraude dans la vente, et celle-ci par là-même devient illicite. C’est ce qu’Isaïe (1, 22) reproche à ses contemporains : « Votre argent a été changé en scories ; votre vin a été coupé d’eau », car ce qui est mélangé perd sa nature propre.
– Un autre défaut porte sur la quantité que l’on connaît au moyen de mesures. Si donc au moment de la vente on use sciemment d’une mesure défectueuse, on commet encore une fraude et la vente est illicite. Aussi le Deutéronome (25, 13) prescrit-il :
Tu n’auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n’auras pas dans ta maison deux sortes de boisseaux, un grand et un petit,
et plus loin :
Car il est en abomination à Dieu, celui qui fait ces choses ; Dieu a en horreur toute injustice.
– Le troisième défaut possible est celui de la qualité ; par exemple vendre une bête malade comme saine. Si le vendeur fait cela sciemment, il commet une fraude et la vente est illicite.
Dans tous ces cas, non seulement on pèche en faisant une vente injuste, mais on est tenu à restitution. Si cependant le vendeur ignore que l’objet qu’il vend est affecté de ces défauts, il ne pèche pas, car il ne commet que matériellement une injustice et son action morale elle-même n’est pas injuste, nous l’avons déjà vu. Mais lorsqu’il s’en aperçoit, il est tenu à dédommager l’acheteur.
Ce que nous disons du vendeur vaut également pour l’acheteur. Il arrive en effet que le vendeur estime moins cher qu’elle ne vaut l’espèce de l’objet qu’il vend, lorsque, par exemple, il croit vendre du cuivre jaune alors que c’est de l’or ; l’acheteur, s’il en est averti, fait un achat injuste et est tenu à restitution. Il en va de même pour les erreurs de qualité et de quantité.
Il est nécessaire que les mesures appliquées aux marchandises varient avec les lieux, selon l’abondance ou la pénurie de ces produits ; parce que là où règne l’abondance, les mesures sont ordinairement plus fortes. Cependant en chaque lieu, c’est aux chefs de la Cité qu’il appartient de déterminer les mesures exactes des articles en vente, en tenant compte des conditions des lieux et des choses elles-mêmes. Ainsi n’est-il pas permis de dépasser ces mesures fixées par les pouvoirs publics ou par la coutume.
Le vendeur est-il tenu de dire les défauts de sa marchandise ? (IIa IIae 77 3)
Résumé de VLR
L’égalité de la justice est rompue si le vendeur cache volontairement à l’acheteur un défaut de la marchandise, tel que son usage peut entraîner un préjudice ou un danger.
Saint Thomas (Extrait)
Il est toujours illicite de fournir à autrui une occasion ou de danger ou de préjudice. Pourtant, il n’est pas nécessaire qu’un homme donne toujours à son prochain un secours ou un conseil capable de lui procurer un avantage quelconque ; ce ne serait requis qu’en certains cas déterminés, par exemple envers quelqu’un dont on a la charge, ou lorsque nul autre ne pourrait lui venir en aide.
Or le vendeur qui offre sa marchandise à l’acheteur, lui fournit par là même une occasion de préjudice ou de danger, si cette marchandise a des défauts tels que son usage puisse entraîner un préjudice ou un danger.
– Un préjudice, si le défaut est de nature à diminuer la valeur de la marchandise mise en vente, et que néanmoins le vendeur ne rabatte rien du prix ;
– un danger si, du fait de ce défaut, l’usage de la marchandise devient difficile ou nuisible ; comme par exemple, si l’on vendait un cheval boiteux comme un cheval rapide, ou une maison qui menace ruine comme une maison en bon état, ou des aliments avariés ou empoisonnés comme des aliments sains.
Mais si le défaut est manifeste, comme s’il s’agit d’un cheval borgne ; ou si la marchandise qui ne convient pas au vendeur, peut convenir à d’autres, et si par ailleurs le vendeur fait de lui-même une réduction convenable sur le prix de la marchandise, il n’est pas tenu de manifester le défaut de sa marchandise. Car à cause de cela, l’acheteur pourrait vouloir une diminution de prix exagérée. Dans ce cas, le vendeur peut licitement veiller à son intérêt, en taisant le défaut de la marchandise.
On ne peut porter un jugement que sur une chose connue, car…
… chacun, dit Aristote, juge d’après ce qu’il connaît.
Donc, si les défauts d’une marchandise mise en vente sont cachés à moins que le vendeur ne les révèle, l’acheteur n’est pas à même de se faire un jugement sur ce qu’il achète.
Au contraire si les défauts sont apparents. Il n’est pas nécessaire que l’on fasse annoncer par le crieur public les défauts de la marchandise ; des annonces de ce genre feraient fuir les acheteurs et leur laisserait ignorer les autres qualités qui rendent cette marchandise bonne et utile. Mais il faut révéler ce défaut à chacun de ceux qui viennent acheter ; ils pourront ainsi comparer entre elles les qualités bonnes et mauvaises. Rien n’empêche en effet qu’une chose atteinte d’un défaut puisse rendre beaucoup de services.
Si l’homme n’est pas tenu d’une manière absolue de dire la vérité à son prochain en ce qui regarde la pratique de la vertu, il y est cependant obligé quand, par son fait, quelqu’un serait menacé d’un danger où la vertu serait engagée, s’il ne disait pas la vérité. C’est le cas ici.
Le vice d’une marchandise diminue sa valeur présente. Mais dans le cas envisagé par l’objection, c’est seulement plus tard que la valeur de la marchandise doit baisser, du fait de l’arrivée de nouveaux marchands, et cette circonstance est ignorée des acheteurs. Par conséquent, le vendeur peut, sans blesser la justice, vendre sa marchandise au taux du marché où il se transporte, sans avoir à révéler la baisse prochaine. Si toutefois il en parlait ou s’il baissait lui-même ses prix, il pratiquerait une vertu plus parfaite ; mais il ne semble pas y être tenu en justice.
Est-il permis, dans le commerce, de vendre une marchandise plus cher qu’on ne l’a achetée ? (IIa IIae 77 4)
Résumé de VLR
Il existe deux types d’échanges :
– L’échange pour les nécessités de la vie de denrées contre denrées, ou de denrées contre argent. Cet échange est louable en vertu de sa nécessité.
– L’échange pour le gain d’argent pour de l’argent ou des denrées quelconques contre de l’argent (le négoce). Cet échange peut être licite à condition qu’il soit ordonné à une fin nécessaire, ou même honnête.
Il n’y a pas faute si le vendeur vend plus cher un bien qu’il a amélioré ou dont il a assuré le transport, car il reçoit alors la récompense de son effort.
Saint Thomas (Extrait)
Le négoce consiste à échanger des biens. Or Aristote distingue deux sortes d’échanges.
– L’une est comme naturelle et nécessaire, et consiste à échanger denrées contre denrées, ou denrées contre argent, pour les nécessités de la vie. De tels échanges ne sont pas propres aux négociants, mais sont surtout effectués par le maître de maison ou le chef de la Cité qui sont chargés de procurer à la maison ou à la Cité les denrées nécessaires à la vie.
– Il y a une autre sorte d’échange ; elle consiste à échanger argent contre argent ou des denrées quelconques contre de l’argent, non plus pour subvenir aux nécessités de la vie, mais pour le gain. Et c’est cet échange qui très précisément constitue le négoce, d’après Aristote.
Or, de ces deux sortes d’échange, la première est louable, puisqu’elle répond à une nécessité de la nature, mais il réprouve à bon droit la seconde qui, par sa nature même, favorise la cupidité, laquelle n’a pas de bornes et tend à acquérir sans fin. Voilà pourquoi le négoce, envisagé en lui-même, a quelque chose de honteux, car il ne se rapporte pas, de soi, à une fin honnête et nécessaire.
Cependant si le gain, qui est la fin du commerce, n’implique de soi aucun élément honnête ou nécessaire, il n’implique pas non plus quelque chose de mauvais ou de contraire à la vertu. Rien n’empêche donc de l’ordonner à une fin nécessaire, ou même honnête. Dès lors le négoce deviendra licite. C’est ce qui a lieu quand un homme se propose d’employer le gain modéré qu’il demande au négoce, à soutenir sa famille ou à secourir les indigents, ou encore quand il s’adonne au négoce pour l’utilité sociale, afin que sa patrie ne manque pas du nécessaire, et quand il recherche le gain, non comme une fin mais comme salaire de son effort.
[…] Si […] le vendeur vend plus cher un objet qu’il a amélioré, il apparaît qu’il reçoit la récompense de son travail. On peut pourtant viser le gain licitement, non comme une fin ultime mais, nous l’avons dit, en vue d’une autre fin nécessaire ou honnête.
Tout homme qui vend un objet plus cher que cela ne lui a coûté, ne fait pas pour autant du négoce, mais seulement celui qui achète afin de vendre plus cher. En effet, si l’on achète un objet sans intention de le revendre, mais pour le conserver et que, par la suite, pour une cause ou pour une autre, on veuille s’en défaire, ce n’est pas du commerce, quoi qu’on le vende plus cher. Cela peut être licite, soit que l’on ait amélioré cet objet, soit que les prix aient varié selon l’époque ou le lieu, soit en raison des risques auxquels on s’expose en transportant ou en faisant transporter cet objet d’un lieu dans un autre. En ce cas, ni l’achat ni la vente n’est injuste.
Les clercs ne doivent pas seulement s’abstenir de ce qui est mal en soi, mais encore ce qui a l’apparence du mal. Or cela se produit avec le négoce, soit parce qu’il est ordonné à un profit terrestre que les clercs doivent mépriser, soit parce que les péchés qui s’y commettent sont trop fréquents. Comme dit l’Ecclésiastique (26, 29) :
Le commerçant évite difficilement les péchés de la langue.
Il y a d’ailleurs une autre raison, c’est que le commerce exige une trop grande application d’esprit aux choses de ce monde et détourne par là du souci des biens spirituels ; c’est pourquoi saint Paul écrivait (2 Tm 2, 4) :
Celui qui est enrôlé au service de Dieu ne doit pas s’embarrasser des affaires du siècle.
Toutefois il est permis aux clercs d’utiliser, en achetant ou en vendant, la première forme de commerce qui est ordonnée à procurer les biens nécessaires à la vie.
Est-ce un péché de recevoir de l’argent à titre d’intérêt pour un prêt d’argent, ce qui constitue l’usure ? (IIa IIae 78 1)
Résumé de VLR
L’argent a été inventé pour favoriser les échanges, donc son usage propre est d’être consommé, dépensé. Or l’usure consiste à faire payer l’usage (usus) de l’argent prêté, ce qui constitue une inégalité contraire à la justice.
Saint Thomas (Extrait)
Recevoir un intérêt pour de l’argent prêté est de soi injuste, car c’est faire payer ce qui n’existe pas ; ce qui constitue évidemment une inégalité contraire à la justice.
Pour s’en convaincre, il faut se rappeler que l’usage de certains objets se confond avec leur consommation ; ainsi nous consommons le vin pour notre boisson, et le blé pour notre nourriture. Dans les échanges de cette nature on ne devra donc pas compter l’usage de l’objet à part de sa réalité même ; mais du fait même que l’on en concède l’usage à autrui, on lui concède l’objet. Voilà pourquoi, pour les objets de ce genre, le prêt transfère la propriété.
Si donc quelqu’un voulait vendre d’une part du vin, et d’autre part son usage, il vendrait deux fois la même chose, ou même vendrait ce qui n’existait pas. Il commettrait donc évidemment une injustice.
Pour la même raison, l’on pécherait contre la justice si, prêtant du vin ou du blé, on exigeait deux compensations, l’une à titre de restitution équivalente à la chose elle-même, l’autre pour prix de son usage (usus) ; d’où le nom d’usure (usura).
En revanche, il est des objets dont l’usage ne se confond pas avec leur consommation. Ainsi l’usage d’une maison consiste à l’habiter, non à la détruire ; on pourra donc faire une cession distincte de l’usage et de la propriété ;
– vendre une maison, par exemple, dont on se réserve la jouissance pour une certaine période ; ou au contraire
– céder l’usage de cette maison, mais en garder la nue-propriété.
Voilà pourquoi on a le droit de faire payer l’usufruit d’une maison et de redemander ensuite la maison prêtée, comme cela se pratique dans les baux et les locations d’immeubles.
Quant à l’argent monnayé, Aristote remarque qu’il a été principalement inventé pour faciliter les échanges ; donc son usage (usus) propre et principal est d’être consommé, c’est-à-dire dépensé, puisque tel est son emploi dans les achats et les ventes. En conséquence, il est injuste en soi de se faire payer pour l’usage de l’argent prêté ; c’est en quoi consiste l’usure (usure). Et comme on est tenu de restituer les biens acquis injustement, de même on est tenu de restituer l’argent reçu à titre d’intérêt.
Est-il permis, en compensation de ce prêt, de bénéficier d’un avantage quelconque ? (IIa IIae 78 2)
Résumé de VLR
Un prêteur ne commet pas de faute :
– s’il reçoit de l’emprunteur un avantage en remerciement, à condition de ne l’avoir exigé ni explicitement, ni implicitement.
– si, dans son contrat, il prévoit une indemnité pour le préjudice qu’il subit en se privant de ce qui était en sa possession. Est exclu du préjudice le fait qu’on ne gagne plus rien avec l’argent prêté, car on ne peut vendre ce qu’on ne possède pas encore.
Un prêteur peut réclamer une part de bénéfice s’il confie une somme d’argent à un marchand ou à un artisan par mode d’association. Par ce prêt, il ne leur cède pas la propriété de son argent qui demeure bien à lui, et, parce qu’il partage les risques de leur commerce, est-il juste qu’il en partage aussi les bénéfices.
Vendre un objet au-dessus de son juste prix parce que l’on accorde à l’acheteur un délai de paiement est une usure manifeste, car ce délai ainsi concédé a le caractère d’un prêt.
Saint Thomas (Extrait)
Selon Aristote…
… tout ce qui est estimable à prix d’argent peut être traité comme l’argent lui-même.
Par suite, de même que l’on pèche contre la justice, lorsqu’en vertu d’un contrat, tacite ou exprès, on perçoit un intérêt sur un prêt d’argent ou une autre chose qui se consomme par l’usage — nous l’avons vu dans l’article précédent —, de même quiconque, en vertu d’un contrat tacite ou exprès, reçoit un avantage quelconque estimable à un prix d’argent, commet pareillement un péché contre la justice.
Toutefois, s’il reçoit cet avantage sans l’avoir exigé et sans aucune obligation tacite ou expresse, mais à titre de don gracieux, il ne pèche pas ; car, avant le prêt, il lui était loisible de bénéficier d’un tel don, et le fait de consentir un prêt n’a pu le mettre dans une condition plus défavorable.
Mais ce qu’il est permis d’exiger en compensation d’un prêt, ce sont ces biens qui ne s’apprécient pas avec de l’argent : la bienveillance et l’amitié de l’emprunteur, ou d’autres faveurs.
Dans son contrat avec l’emprunteur, le prêteur peut, sans aucun péché, stipuler une indemnité à verser pour le préjudice qu’il subit en se privant de ce qui était en sa possession ; ce n’est pas là vendre l’usage de l’argent, mais obtenir un dédommagement. Il se peut d’ailleurs que le prêt évite à l’emprunteur un préjudice plus grand que celui auquel s’expose le prêteur. C’est donc avec son bénéfice que le premier répare le préjudice du second. Mais on n’a pas le droit de stipuler dans le contrat une indemnité fondée sur cette considération, que l’on ne gagne plus rien avec l’argent prêté ; car on n’a pas le droit de vendre ce que l’on ne possède pas encore et dont l’acquisition pourrait être empêchée de bien des manières.
La compensation pour un bienfait reçu peut être envisagée sous un double aspect.
– D’abord comme l’acquittement d’une dette de justice ; on peut y être astreint par un contrat précis, et cette obligation se mesure à la quantité du bienfait reçu. Voilà pourquoi celui qui emprunte une somme d’argent ou des biens qui se consomment par l’usage, n’est pas tenu à rendre plus qu’on ne lui a prêté. Ce serait donc contraire à la justice que de l’obliger à rendre davantage.
– En second lieu, on peut être obligé de témoigner sa reconnaissance pour un bienfait, par dette d’amitié ; alors on tiendra compte des sentiments du bienfaiteur plus que de l’importance du bienfait. Une dette de cette nature ne peut être l’objet d’une obligation civile, puisque celle-ci impose une sorte de nécessité, qui empêche la spontanéité de la reconnaissance.
Celui qui prête de l’argent en transfère la possession à l’emprunteur. Celui-ci conserve donc cet argent à ses risques et périls, et il est tenu de le restituer intégralement. Le prêteur n’a donc pas le droit d’exiger plus qu’il n’a donné.
Mais celui qui confie une somme d’argent à un marchand ou à un artisan par mode d’association, ne leur cède pas la propriété de son argent qui demeure bien à lui, de sorte qu’il participe à ses risques et périls au commerce du marchand et au travail de l’artisan ; voilà pourquoi il sera en droit de réclamer, comme une chose lui appartenant, une part du bénéfice.
Si, comme garantie de l’argent qu’il a reçu, l’emprunteur donne un gage dont l’usage est appréciable à prix d’argent, le prêteur devra déduire ce revenu de la somme que doit lui restituer l’emprunteur. S’il voulait en effet que ce revenu lui soit concédé gratuitement par surcroît, ce serait comme s’il prêtait à intérêt, ce qui est usuraire. À moins toutefois, qu’il ne s’agisse d’un objet dont on a coutume de se concéder gratuitement l’usage entre amis ; par exemple lorsqu’on se prête un livre.
Vendre un objet au-dessus de son juste prix parce que l’on accorde à l’acheteur un délai de paiement, c’est une usure manifeste, car ce délai ainsi concédé a le caractère d’un prêt. Par conséquent, tout ce qu’on exige au-dessus du juste prix en raison de ce délai est comme l’intérêt d’un prêt, et doit donc être considéré comme usuraire.
De même lorsque l’acheteur veut acheter un objet au-dessous du juste prix, sous prétexte qu’il le paiera avant sa livraison, il commet lui aussi le péché d’usure ; ce paiement anticipé, en effet, est une sorte de prêt, dont l’intérêt consiste dans la remise faite sur le juste prix de l’objet vendu.
Si toutefois on baisse volontairement les prix afin de disposer plus vite de l’argent, ce n’est pas de l’usure.
Les préceptes judiciaires qui concernent les rapports entre citoyens (Ia IIae 105 2)
Résumé de VLR
Il revient à l’autorité publique d’intervenir pour établir l’égalité de la justice dans la répartition de la propriété, de légiférer dans le sens de propriétés distinctes, mais dont l’usage soit partiellement commun et partiellement distribué par la volonté des propriétaires.
Saint Thomas (Extrait)
Peuple, autorité publique, pouvoir sur les personnes [VLR]
Saint Augustin cite cette définition du peuple par Cicéron :
C’est la multitude rassemblée par les liens de l’unité de droit et de la communauté d’intérêts.
Cela suppose essentiellement entre les citoyens des rapports réglés par de justes lois. Mais entre les citoyens il y a deux sortes de rapports :
– les uns sont fondés sur l’autorité publique,
– les autres sur la volonté individuelle des particuliers.
Et nulle volonté ne peut s’exercer que dans les limites de son pouvoir, il faut réserver à l’autorité publique, qui a pouvoir sur les personnes, la connaissance des litiges entre particuliers et le châtiment des malfaiteurs.
Pouvoir des particuliers sur leurs biens [VLR]
Au contraire, les particuliers ont pouvoir sur leurs biens ; ils peuvent donc, à cet égard, traiter librement entre eux, par exemple acheter, vendre, faire donation, etc.
Ces deux sortes de rapports ont été convenablement réglés par la loi.
Elle a établi des juges (Dt 16, 18) :
Tu établiras des juges et des greffiers dans toutes les villes, et ils jugeront le peuple avec justice.
Elle a établi une procédure équitable :
Jugez selon la justice : qu’il s’agisse d’un compatriote ou d’un étranger, qu’il n’y ait pas de différence entre les personnes (Dt 1, 16-17).
– En interdisant aux juges de recevoir des présents, elle a coupé court à une occasion d’injustice (Ex 23, 8 ; Dt 16, 19).
– Elle a fixé à deux ou trois le nombre des témoins (Dt 17, 6 ; 19, 15).
– Enfin, on le verra plus loin, elle a prévu des peines déterminées selon la diversité des délits.
L’idéal de la propriété privée avec usage partiellement commun [VLR]
Quant aux biens, l’idéal, selon Aristote, est que les propriétés soient distinctes, mais que l’usage en soit partiellement commun et partiellement distribué par la volonté des propriétaires.
Or ces trois principes se firent jour dans la loi.
I) En premier lieu, les terres furent partagées entre les particuliers (Nb 33, 53 s) :
J’ai mis cette terre en votre possession ; vous vous la partagerez au sort.
Mais comme, au témoignage d’Aristote, l’inégalité des biens a conduit maints États à la ruine, la loi a préparé un triple remède à cet égard.
– Le premier consistait dans une répartition des terres exactement proportionnée au nombre de têtes :
Vous donnerez un héritage plus grand aux familles plus nombreuses, un héritage moindre aux moins nombreuses (Nb 33, 54).
– Autre remède : les fonds n’étaient pas aliénables à perpétuité, mais revenaient au temps marqué à leur propriétaire, sans fusion des parts.
– Un troisième remède pour éviter ces accroissements, c’était la dévolution de l’héritage aux parents du défunt : au fils en premier lieu, puis à la fille, troisièmement aux frères, ensuite aux oncles paternels, enfin, en dernier lieu, à la parenté (Nb 27, 8 s). En outre, pour maintenir la répartition des patrimoines, la loi a établi que les filles héritières se marieraient dans leur tribu (Nb 36, 8).
II) En second lieu, la loi a établi dans une certaine mesure l’usage commun. Et tout d’abord, en ce qui concerne la gestion, le Deutéronome prescrit (22, 1-4) :
Si tu vois s’égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t’en détourneras pas, mais tu les ramèneras à ton frère.
On pourrait citer d’autres exemples. Puis, en ce qui concerne la jouissance : tous en effet, sans exception, étaient autorisés à entrer dans la vigne d’un ami et à y manger du raisin, sans toutefois en emporter.
À propos des pauvres en particulier, on devait leur abandonner les gerbes oubliées ainsi que les grappes et les fruits restants (Lv 19, 9-10 ; Dt 24, 19-21). De même les produits de l’année sabbatique étaient mis en commun (Ex 23, 11 ; Lv 25, 4-7).
III) En troisième lieu, la loi a organisé une distribution effectuée par les propriétaires eux-mêmes : tantôt à titre purement gratuit (Dt 14, 28-29) :
Tous les trois ans, tu mettras à part une autre dîme, et le lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve viendront s’en nourrir et s’en rassasier…
… tantôt contre un avantage équivalent, dans le cas d’une vente, d’une location, d’un prêt ou d’un dépôt ; de tous ces actes, les conditions sont précisées par la loi. D’où il ressort clairement que la loi ancienne a convenablement réglé la vie sociale de ce peuple.
L’Apôtre enseigne aux Romains (13, 8) qu’en aimant le prochain on accomplit la loi. C’est que tous les préceptes de la loi, et notamment ceux qui regardent le prochain, apparaissent orientés vers ce but : que les hommes se portent une affection mutuelle.
Or la direction incite les hommes à se communiquer leurs biens car, lisons-nous dans la première épître de saint Jean (3, 17),
si quelqu’un voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ?
Voilà pourquoi la loi tâchait d’accoutumer les gens à se faire part volontiers de leurs biens. L’Apôtre, (1 Tm 6, 18), enjoint lui aussi aux riches de distribuer et de partager libéralement. Or, interdire au prochain ces menus prélèvements qui ne lèsent guère le propriétaire, c’est manquer de libéralité.
Aussi la loi a-t-elle ordonné qu’il serait loisible d’entrer dans la vigne du voisin et d’y manger des grappes ; toutefois, elle interdit d’en emporter, ne voulant pas donner par là prétexte à un dommage sérieux qui troublerait la paix sociale. Mais, entre gens raisonnables, ces légers grappillages, loin d’avoir un tel effet, mettent le sceau à l’amitié et entretiennent une atmosphère de libéralité.
À propos de la transmission de patrimoine [VLR]
C’est à défaut de descendance mâle que la loi a admis la succession des femmes aux biens paternels. Mais, dans ce cas, il était nécessaire d’accorder cette consolation à un père qui aurait trouvé pénible de voir son héritage passer entièrement à des étrangers. Toutefois, avec une juste circonspection, la loi imposait aux filles héritières des biens paternels le mariage avec un homme de leur propre tribu, de façon à maintenir distincts les lots de chaque tribu (Nb 36).
Le salut de l’État ou de la nation est étroitement lié à l’équilibre des propriétés. Cette règle, formulée par Aristote explique selon lui pourquoi, en certaines cités de l’antiquité païenne, la constitution interdisait…
… la cession des patrimoines, hormis le cas d’une détresse évidente.
En effet, quand les propriétés peuvent être librement aliénées, elles risquent de se concentrer en quelques mains, et les habitants se voient obligés de quitter la cité ou le pays. Pour écarter ce danger, la loi ancienne a été conçue de telle sorte qu’il fût satisfait aux besoins de ses ressortissants, puisqu’elle admettait l’aliénation temporaire des fonds, mais sans encourir d’inconvénient puisque le fonds vendu devait à une certaine date faire retour au vendeur.
Ces dispositions tendaient à empêcher la confusion des lots et à maintenir toujours identique leur exacte répartition entre les tribus.
Mais les immeubles urbains, n’étant pas lotis, prouvaient légalement être aliénés sans retour, tout comme les meubles. C’est que le nombre des habitations urbaines n’était pas fixé comme était définie la surface des domaines, qui n’était pas susceptible d’extension, tandis que l’on pouvait accroître le nombre des immeubles urbains.
Quant aux maisons rurales, sises dans une campagne non close de murs, elles ne pouvaient être aliénées définitivement, attendu que ce genre de constructions n’est destiné qu’à l’exploitation et à la surveillance des domaines ; aussi la loi a-t-elle pu les assimiler à ceux-ci dans sa réglementation.
Inciter les gens à s’entraider grâce à la loi [VLR]
On vient de le dire, la loi se proposait par ses prescriptions d’incliner les gens à s’entraider de bonne grâce dans leurs besoins, car il n’est rien qui stimule davantage l’amitié. Cette prompte assistance trouvait place non seulement dans les actes gratuits et de pure libéralité, mais aussi en matière d’échanges réciproques, d’autant que les interventions de ce genre sont plus fréquentes et s’imposent à plus de gens. La loi s’y est prise de bien des façons pour inculquer cette attitude obligeante.
1) D’abord on consentirait de bonne grâce les prêts de consommation, sans se laisser arrêter par la proximité de l’année de rémission (Dt 15, 7-11).
2) De plus, en consentant un prêt de consommation, pour ne pas accabler l’emprunteur on ne stipulerait aucun intérêt, on ne saisirait pas en gage les objets indispensables à son existence, ou du moins on les lui restituerait au plus tôt. Tout cela est exprimé par le Deutéronome (23, 20) :
Tu ne feras pas à ton frère de prêt à intérêt.
et encore (24, 6) :
Tu ne prendras pas en gage la meule de dessus ni la meule de dessous : ce serait t’emparer de sa vie même.
et dans l’Exode (22, 26) :
Si tu as pris en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil.
3) En troisième lieu, on ne ferait pas de réclamation importune, comme le veut l’Exode (22, 25) :
Si tu as prêté de l’argent à un pauvre de mon peuple qui demeure avec toi, tu ne le harcèleras pas comme ferait un usurier.
Le Deutéronome prescrit dans le même sens (24, 10-11) :
Tandis que tu réclames à ton prochain ce qu’il te doit, tu n’entreras pas dans sa maison pour y saisir un gage, mais tu te tiendras à la porte et c’est lui qui t’apportera ce dont il peut disposer…
…, car la maison étant pour chacun l’abri le plus sûr, il serait intolérable d’y être pourchassé ; d’ailleurs la loi n’admet pas que le créancier se saisisse d’un gage à sa convenance, mais plutôt que le débiteur offre ce dont il a un moindre besoin.
4) En quatrième lieu, la loi décida que tous les sept ans les dettes seraient remises intégralement. À ceux qui le pouvaient commodément, il convenait de s’acquitter avant la septième année, et de ne pas frustrer celui qui gracieusement leur avait prêté. Mais, s’ils étaient définitivement insolvables, on devait leur faire remise de leur dette pour ce même motif de direction qui exigeait qu’on leur donne à nouveau, en raison de leur indigence.
Sur les animaux prêtés [VLR]
En ce qui concerne les animaux prêtés, la loi a décidé que l’emprunteur serait tenu à dédommagement, du fait de sa négligence, si en son absence les bêtes mouraient ou dépérissaient. Si au contraire elles étaient mortes ou avaient dépéri sous ses yeux et sous sa garde diligente, il n’y était pas tenu, et cela surtout s’il les avait en location ; car dans ces conditions les animaux risquaient aussi bien de mourir ou de dépérir entre les mains du propriétaire qui, par conséquent, eût tiré un avantage contraire à la nature du prêt gratuit, si la conservation de l’animal lui était ainsi garantie.
Cette règle s’imposait tout spécialement à propos d’animaux loués, puisque dans ce cas le propriétaire recevait pour l’usage de ses bêtes une redevance déterminée, en sorte que nulle compensation supplémentaire n’était due en raison de la moins-value, si les animaux avaient été gardés sans négligence.
En revanche, s’il ne s’était agi que d’un prêt gratuit, un dédommagement aurait pu paraître équitable, au moins jusqu’à concurrence du loyer qu’on aurait pu tirer de l’animal perdu ou détérioré.
Entre le prêt et le dépôt il y a cette différence que le prêt se fait pour l’utilité de l’emprunteur, tandis que le dépôt est pour l’utilité du déposant. Voilà pourquoi, le cas échéant, on était plus exigeant pour la restitution de la chose prêtée que pour la restitution du dépôt. Or la disparition du dépôt pouvait se présenter de deux façons :
– soit à cause d’un fait inévitable qui pouvait être naturel, comme la mort ou l’affaiblissement de l’animal remis en dépôt, ou d’origine extérieure, si par exemple il était tombé entre les mains de l’ennemi ou sous la dent des fauves. Dans ce dernier cas, le dépositaire était bien tenu de présenter au propriétaire ce qui pouvait rester de l’animal, mais dans tous les autres cas il n’avait rien à restituer ; tout au plus, afin d’écarter le soupçon de fraude, était-il tenu de prêter serment.
– Mais en second lieu le dépôt pouvait disparaître à cause d’un fait qui aurait pu être évité, par exemple à raison d’un vol. Dans ce cas, pour sa négligence, le dépositaire était tenu à ré était tenu même si l’animal était mort ou avait dépéri en son absence. Il fallait en effet une faute plus grave pour engager la responsabilité du dépositaire, tenu seulement en cas de vol.
Le salaire des journaliers [VLR]
Les journaliers qui louent leurs bras étant des gens peu fortunés qui vivent au jour le jour de leur travail, la loi a sagement décidé que le salaire leur serait versé immédiatement, afin d’assurer leur subsistance. Au contraire, ceux qui mettent d’autres biens en location sont généralement dans l’aisance et ils n’ont pas un besoin aussi urgent de leurs loyers pour vivre au jour le jour. Ainsi les deux cas ne sont pas comparables.
Les procédures judiciaires [VLR]
Les juges sont établis dans une société pour déterminer les points de droit qui demeureraient douteux entre les parties. Or le doute peut se présenter à deux niveaux. Et tout d’abord aux yeux des simples. Pour le résoudre dans ce cas, il est prescrit que…
… des juges et des greffiers soient établis en chaque tribu pour juger le peuple selon la justice…
… dit le Deutéronome (16, 18).
Mais le doute peut surgir aussi dans l’esprit des sages et alors, pour le lever, la loi impose à tous de recourir au chef-lieu désigné par Dieu ; on devait y trouver d’une part un grand prêtre qualifié pour trancher les différends en matière de rites, et d’autre part un juge souverain pour ce qui touche les litiges privés, de même qu’aujourd’hui encore par voie d’appel ou de consultation, la connaissance des procès passe du juge inférieur au juge supérieur. C’est ce qu’exprime le texte allégué du Deutéronome (17, 8 s) :
Si une affaire te parait difficile et douteuse et si elle soulève un désaccord entre les juges dans ta ville, monte au lieu désigné par le Seigneur et adresse-toi aux prêtres lévites et au juge alors en fonction.
Les difficultés de cette sorte étant relativement rares, le système n’était pas trop onéreux pour le public.
Dans les affaires humaines où les démonstrations ne parviennent pas à une rigueur infaillible, on se contente de ces présomptions vraisemblables qu’un orateur sait rendre persuasives. Et donc, bien que deux ou trois témoins puissent s’entendre pour mentir, un tel accord n’est ni commun ni probable ; aussi tient-on pour véridique leur témoignage, surtout s’ils n’hésitent pas dans leur déposition et ne sont par ailleurs nullement suspects. De plus, pour que les témoins ne s’éloignent pas aisément de la vérité, la loi a prescrit de les contrôler avec le plus grand soin et de punir avec la dernière rigueur ceux qui seraient convaincus de mensonge (Dt 19, 16 s).
Pour expliquer davantage pourquoi ce nombre de témoins a été arrêté, remarquons qu’il symbolisait la vérité infaillible des personnes divines ; celles-ci en effet apparaissent tantôt au nombre de deux, le Saint Esprit établissant un lien entre elles, tantôt explicitement au nombre de trois. C’est ainsi que saint Augustin commente cette parole en saint Jean (8, 17) :
Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai.
De la gravité de la peine infligée [VLR]
La gravité de la peine infligée ne tient pas seulement à la gravité de la faute, mais encore à d’autres motifs. Tels sont en premier lieu l’importance de l’infraction :
– si elle est grave, toutes choses égales d’ailleurs, elle mérite une peine plus lourde ;
– en deuxième lieu, le caractère habituel de l’infraction, car il n’est pas facile, sinon par des peines sévères, de détourner les hommes de leurs manquements habituels ;
– en troisième lieu, la vivacité de l’attrait ou du plaisir qu’offre l’acte défendu et qui fait qu’on s’en abstient difficilement, s’il n’est pas gravement puni.
– Enfin la facilité avec laquelle l’infraction peut être commise et tenue secrète exige que, si elle est découverte, les coupables soient plus fortement châtiés, pour l’intimidation des autres.
En ce qui concerne l’importance même de l’infraction, on notera quatre situations inégales, quand même il s’agirait d’un seul et même acte matériel.
– Le premier degré est celui d’une infraction commise involontairement. Alors, si l’acte est parfaitement involontaire, son auteur est exempté de tout châtiment ; c’est ainsi que le Deutéronome (22, 25 s) dispose que la fille qui est violentée en plein champ…
… n’est point passible de mort, car elle a crié à l’aide mais nul ne s’est trouvé là pour la délivrer.
Si la volonté est de quelque façon engagée, mais que le délinquant toutefois ait agi par faiblesse, notamment sous l’influence de la passion, le délit est atténué, et en toute justice la peine doit être moindre ; à moins cependant, répétons-le, que l’utilité commune ne requière une plus grande rigueur, de façon à détourner les gens de ce genre de fautes.
– Le deuxième degré est celui d’un délit commis par ignorance. Dans ce cas le délinquant était considéré comme coupable pour avoir négligé de s’instruire ; toutefois il n’était pas puni par les juges, mais il devait expier sa faute par des sacrifices, selon le Lévitique (4, 2 s) :
Lorsqu’un homme aura péché par erreur etc.
Du reste, il ne s’agit pas là de l’ignorance du précepte divin, que nul ne peut ignorer, mais d’une ignorance du fait.
– Au troisième degré, nous trouvons le péché d’orgueil, c’est-à-dire celui qui était commis par détermination ferme et malice assurée. Dans ce cas la peine suivait l’importance du délit.
– Au quatrième degré enfin se trouvait le pécheur cynique et obstiné. Alors, considéré comme un rebelle et un danger pour l’ordre public, il devait absolument être mis à mort.
La répression du vol [VLR]
En s’inspirant de ces principes, en répondra que dans la répression du vol, la loi prenait en considération la fréquence probable de chaque sorte d’infraction.
– Ainsi pour le vol de ces différents objets que l’on peut facilement soustraire aux entreprises d’un voleur, celui-ci ne restituait que le double.
– Mais les moutons qui paissent dans la campagne sont autrement difficiles à garder, et les vols de moutons se présentaient assez fréquemment ; la loi les assortit donc d’une peine plus forte qui consistait à rendre quatre têtes pour une.
– La garde des bovins est encore plus difficile car ils se tiennent aussi dans les champs, mais plus dispersés dans les pâturages que les troupeaux de moutons ; aussi la loi a-t-elle fixé une peine encore plus forte, à savoir la restitution au quintuple.
– Tout cela s’entend sauf le cas où la bête vivante aurait été retrouvée chez le voleur ; celui-ci ne restituait alors que le double, comme dans les vols ordinaires, parce qu’on pouvait présumer que le voleur l’avait laissée en vie dans l’intention de la rendre.
Ou bien, disons avec la Glose que l’on tire des bovins cinq sortes d’utilités : le sacrifice, le labour, la viande, le lait, le cuir ; voilà pourquoi pour une bête on en devait cinq. Mais la brebis ne présente que quatre utilités : le sacrifice, la viande, le lait, la laine.
Différentes peines infligées [VLR]
Ce n’est pas parce qu’il festoyait que le fils insoumis était mis à mort, mais à cause de son opiniâtreté et de sa rébellion, crimes capitaux, on l’a dit.
Et celui qui avait ramassé du bois le jour du sabbat fut lapidé parce que la loi de l’observance du sabbat qu’il avait violée signifiait la foi en la création du monde : c’est donc pour son infidélité que cet homme fut mis à mort.
– La loi ancienne infligeait la peine de mort pour certains crimes particulièrement graves : offenses contre Dieu, homicide, rapt, irrévérence envers les parents, adultère, inceste.
– Elle punissait de l’amende les autres vols.
– Aux coups et dommages corporels elle appliquait la peine du talion, ainsi qu’au crime de faux témoignage.
– Pour les autres délits de moindre gravité, les coupables étaient flagellés ou notés d’infamie.
La loi admit l’esclavage en deux cas.
– D’abord lorsqu’un esclave, au retour de la rémission septennale, refusait le bénéfice de la libération légale ; pour le punir, on l’obligeait à demeurer perpétuellement en esclavage.
– En second lieu, on voit dans l’Exode (22, 3) que cette peine était infligée au voleur incapable de restituer.
L’exil absolu n’a pas été admis comme peine légale. C’est que ce peuple était le seul à rendre un culte au vrai Dieu, tous les autres étant souillés d’idolâtrie ; l’homme qui aurait été définitivement exilé aurait donc été exposé à l’idolâtrie. Aussi le premier livre de Samuel (26, 19) rapporte-t-il cette protestation adressée par David à Saül :
Maudits ceux qui m’ont chassé aujourd’hui, pour m’empêcher de participer à l’héritage du Seigneur, en disant : « Va servir des dieux étrangers. »
Il y avait toutefois un exil relatif, puisque le Deutéronome (19, 4) nous apprend que…
… celui qui avait tué son prochain par mégarde et sans avoir été son ennemi avéré…
se rendait à l’une des villes de refuge et y demeurait jusqu’à la mort du grand prêtre. À ce moment il lui était permis de rentrer chez lui ; un deuil public ayant pour effet ordinaire d’apaiser les ressentiments privés, les parents du mort étaient moins tentés de mettre à mort le meurtrier.
On prescrivait la mise à mort des animaux, non à cause d’une faute quelconque de leur part, mais pour punir les propriétaires qui auraient dû les surveiller et les empêcher de commettre pareils méfaits. Aussi le propriétaire était-il puni plus légèrement si le taureau était devenu furieux à l’improviste que si l’animal avait déjà frappé de la corne la veille ou l’avant-veille, circonstance qui permettait de prévoir le danger. D’autre part abattre l’animal c’était réprouver son acte détestable et épargner à l’entourage certaine impression d’effroi que sa vue eût pu provoquer.
Voici la raison littérale de ce commandement selon Maïmonide. Le meurtrier appartient d’ordinaire à une cité du voisinage ; aussi l’abattage de la génisse avait pour but de faire la lumière sur un meurtre clandestin. Le but était atteint de trois manières :
– d’abord les anciens juraient qu’ils n’avaient rien négligé pour la sûreté des chemins ;
– d’autre part le propriétaire de la génisse subissait un dommage si la bête était abattue, mais elle ne l’était pas si l’affaire était éclaircie à temps ;
– enfin le lieu où son abattage était opéré devait demeurer en friche.
Pour éviter ce double dommage, les habitants de la localité étaient donc portés à révéler le meurtrier, s’ils le connaissaient, et il ne pouvait guère manquer de se produire quelque parole ou indice en ce sens.
Ou encore cette procédure tendait à l’intimidation, pour inspirer l’horreur de l’homicide. En immolant une génisse, animal utile et plein de vigueur, surtout tant qu’il n’a pas encore porté le joug, on signifiait que tout meurtrier, quels que fussent ses services ou sa valeur, devait mourir, et d’une mort cruelle, évoquée par la nuque brisée ; et que son objection et sa dégradation le mettaient au ban de la société, ce qui ressortait du fait que la génisse abattue était abandonnée, destinée à la pourriture, dans un lieu sauvage et désert.
En voici le sens mystique : la génisse enlevée au troupeau représente la chair du Christ ; elle n’a pas porté le joug, car elle n’a point péché ; elle n’a pas divisé la terre par le soc de la charrue, entendez qu’elle ne « s‘est souillée d’aucune marque de rébellion ». Si la génisse mourait dans un vallon en friche, cela signifiait le mépris dont fut entourée la mort du Christ, par laquelle tous péchés sont lavés et le diable désigné comme auteur de l’homicide.