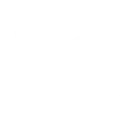En 1688, la victoire de Guillaume d’Orange — soutenu par le parti Whig issu de la bourgeoisie protestante — conduit à l’instauration d’une monarchie parlementaire en Angleterre après l’exil de Jacques II. Les Whigs cherchent alors à diffuser ce modèle politique favorable au capitalisme dans toute l’Europe, ce qui se traduit par le traité d’Utrecht (1713), qui sert les intérêts britanniques et affaiblit les monarchies de droit divin. Après la mort de Louis XIV, le Régent Philippe d’Orléans, inquiet pour la succession du jeune Louis XV dont la santé est fragile, s’allie à l’Angleterre contre Philippe V d’Espagne, petit-fils de Louis XIV et successeur désigné par les Lois fondamentales du Royaume de France. Dans ce contexte, des soulèvements légitimistes dans l’Europe du début du XVIIIe siècle éclatent, comme la conspiration de Pontcallec en Bretagne ou les rébellions jacobites en Écosse, illustrant la résistance à ces nouvelles monarchies malgré leur répression. [La Rédaction]
Table des matières
Introduction de Vive le Roy
Cet article a été publié en 1989 dans L’UNION documents, revue bimestrielle aujourd’hui disparue. Article repris ensuite par la revue légitimiste bretonne La Blanche Hermine (N° 88 et 89) sous le titre « Bretagne et légitimité sous la Régence », avec l’aimable autorisation de Madame del Perugia.
AVERTISSEMENT : Des titres ont été ajoutés ou modifiés par la rédaction de VLR pour faciliter la lecture en ligne.
Au XVIIIe siècle, sous la régence de Philippe d’Orléans, la santé fragile du jeune roi Louis XV laissait craindre la disparition de l’aîné de la Maison de Bourbon et soulevait la question d’une succession dynastique. Parti de Bretagne, un mouvement s’étendait bientôt à l’Espagne, la Suède, l’Écosse fidèle aux Stuart. Les « Renonciations » imposées par l’Angleterre au Traité d’Utrecht étaient bien présentes à tous les esprits. Jamais cependant il ne fut envisagé que la branche cadette des Orléans put approcher du trône, tant étaient claires et impératives les dispositions des Constitutions du Royaume.
La Bretagne dans le contexte international
L’Angleterre et le principe des monarchies légales opposées aux monarchies légitimes
L’Angleterre, dotée, par son Parlement, d’une Monarchie légale, mais non légitime, cherchait à introduire en Europe le principe de royaumes coupés, eux aussi, du consensus national afin de les manœuvrer par l’opinion.
L’abdication de Philippe V d’Espagne et l’avènement de Louis Ier s’inscrivent dans la logique du mouvement légitimiste, adversaire du légalisme parlementaire qui, au temps de la Régence, partit de Bretagne et, à travers un écheveau d’événements et de conspirations, toucha une partie de l’Europe.
Au XVIIIe siècle, la péninsule bretonne représentait, en effet, un point d’entreprise politique important, favorisé par les conjonctions de l’histoire et les données de la géographie.
Le rôle militaire de la Bretagne sous Louis XV et Louis XVI
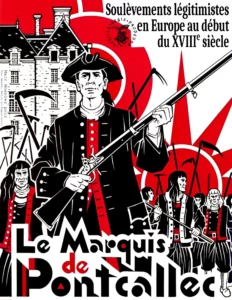
Un rapide coup d’œil sur son rôle pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI révèle la fonction de point d’appui joué par cette frontière récemment fortifiée par Vauban. L’antagonisme manifesté dès la Régence entre deux puissances maritimes : l’Espagne et l’Angleterre, reposait sur des conceptions politiques si fondamentalement inconciliables qu’elles imposaient la guerre. Au temps de l’« Europe Française », le Rhin perdait nécessairement de son importance. C’est sur notre frontière atlantique — où se crée au XVIIIe siècle la puissance navale de Brest et de Cherbourg — que se joua l’avenir du continent européen.
Sous Louis XV, la Bretagne formera d’abord une ligne de soutien pendant la conjuration du marquis de Pontcallec, puis lors des différents soulèvements jacobites en Écosse, dans les tentatives de débarquement en Angleterre, selon des plans étudiés par le Bien Aimé, et enfin lors des descentes anglaises dans les îles de Saintonge, d’Houat, d’Hœdic, à Lorient, Quiberon, dans la péninsule malouine et le Cotentin.
La concentration franco-espagnole sous Louis XVI
Sous le règne suivant, Louis XVI basera, près de Dinan, sa formidable concentration franco-espagnole menaçant l’Angleterre et commandée par les amiraux d’Orvilliers et Don Luis de Cordoba. Cette opération fut conçue par le Roi comme un des éléments de la manœuvre magistrale qui permit le débarquement de ses armées en Amérique. Elle amena les plénipotentiaires anglais à venir, en 1783, demander la paix à Louis XVI.
Et le siècle se terminera en Bretagne par les entreprises terrestres et navales que suscitait toujours la fidélité dynastique, soutenue à l’extérieur par l’Angleterre et l’Espagne [la chouannerie (NDLR)].
L’unité des événements en Bretagne
Cette suite d’événements intéressant la péninsule armoricaine est généralement présentée comme discontinue. Elle trouve son unité lorsque l’on considère, d’une part, les desseins diplomatiques du XVIIIe siècle et, d’autre part, les sentiments qui assuraient au monde celtique une identité politique.
Dans un ouvrage exhaustif, Pierre de la Condamine1 a récemment traité d’une manière extrêmement vivante la conspiration du marquis de Pontcallec. Elle se trouve imbriquée, à l’extérieur des horizons bien délimités de la Bretagne, dans une action diplomatique très compliquée, ayant pour toile de fond la Méditerranée et la Baltique, et pour objectif directeur la résistance continentale aux « Renonciations » dynastiques du traité d’Utrecht.
Contre les lois fondamentales, le parti bourgeois Whig soutient les Orléans
Les « Renonciations » dynastiques du traité d’Utrecht
Imposé à l’origine par l’Angleterre à la France et à l’Espagne, ce traité substituait, au principe si clair de la légitimité, une doctrine qui ne pourra finalement s’implanter qu’en Suède en 1719.
L’île libérale punira ainsi la couronne des Vasa d’avoir soutenu la politique de Charles XII, admiré de Voltaire. En violant le principe de la légitimité, l’Angleterre rayera à bon marché la Suède du rang des grandes puissances européennes. Par une simple manipulation de la constitution suédoise, elle supprimera un concurrent de sa puissance maritime.
L’opération aurait pu très bien réussir en France, dans le temps toujours politiquement faible des régences, d’autant que le parti Whig trouvait dans la personne du duc d’Orléans un esprit brillant tout à fait capable de se contenter d’une couronne « légale ».
Sous la pression de l’Angleterre, louis XIV avait dû admettre, à Utrecht, en 1713, que la branche cadette des Orléans monterait sur le trône de France si le futur Louis XV, de santé extrêmement délicate, venait à disparaître.
Ainsi, avant la signature du traité d’Utrecht, et en cas de mort du frêle héritier, ce n’était pas Philippe d’Orléans, mais Philippe V d’Espagne qui aurait dû légitimement régner en France. Quatorze semaines avant la mort du Roi-Soleil, le marquis de Grimaldi, ministre du roi d’Espagne, dans une lettre au cardinal del Guidice, n’en prévoyait pas moins que Philippe V garderait la couronne d’Espagne et que son fils, l’infant Don Luis, recevrait celle de France.
De toute façon, le trône de France, s’il devait être légitimement dévolu comme le souhaitait notre opinion publique, ne pouvait revenir à la branche cadette des Orléans, ainsi que l’exigeaient les Whigs à Utrecht.
Le parti Whig de la bourgeoisie anglaise et le pouvoir libéral
Ce parti, émanation de la bourgeoisie anglaise, cherchait à généraliser sur le continent une conception du pouvoir libéral qui renforcerait sa fortune. Pour y parvenir, il fallait violer en France les intangibles « lois fondamentales du Royaume ». Un simple traité de paix serait-il capable d’obtenir, en France comme en Suède, un résultat si ambitieux ?
Les rébellions écossaises
Les conflits intérieurs en Angleterre
Dans l’île même, le Parlement anglais ne pouvait résoudre que par la force ses conflits intérieurs, fruits eux-mêmes d’un problème de légitimité.
En 1713, la reine Anne, fille de Jacques II Stuart, n’avait plus que quelques semaines à vivre. Appuyée sur lord Bolingbroke, marié à une nièce de Madame de Maintenon, et sur le très curieux duc d’Ormond, elle avait vainement essayé d’ouvrir le chemin du trône à son frère, Jacques III, installé par Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye. La reine Anne d’Angleterre, dont le Parlement confisquait pratiquement toute l’autorité, cherchait, en effet, à empêcher l’implantation en Angleterre de la dynastie hanovrienne prévue en 1705 par le Bill de Régence.
L’union de l’Angleterre et de l’Écosse
En 1707, elle avait réalisé l’union de l’Angleterre et de l’Écosse. Par le rattachement autoritaire des Celtes aux Anglo-Saxons de l’île, elle ouvrait pour un demi-siècle une voie à l’intervention européenne dans les affaires intérieures du Royaume-Uni. L’Espagne, la Suède et surtout la France ne se privèrent pas de publier devant toute l’Europe que l’Angleterre, spécialiste en coalitions désunissant le continent, avait d’abord à réaliser chez elle une unité nationale que sapaient les rébellions celtes.
Pour protester plus précisément contre ce Bill d’Union, les rébellions écossaises lancèrent, lors de la guerre de Succession d’Autriche, leurs offensives victorieuses, est-il besoin de le rappeler, jusqu’à 30 lieues de Londres.
Le débarquement du roi légitime Jacques III en Angleterre
Une des plus importantes conventions du traité d’Utrecht avait été signée le 11 avril 1713. Six semaines plus tard, le vieux roi louis XIV pouvait assister à la première de ces grandes interventions armées dans les affaires de l’île. Sous l’impulsion de Bolingbroke et du duc d’Ormond, le prétendant Jacques III débarqua en Angleterre.
Pendant quatre mois, d’octobre 1713 à février 1714, le Roi-Soleil contempla le soulèvement général de l’Écosse. Il s’étendit comme un incendie aux cantons nord et jusqu’au comté de Strathmore. Le Prétendant était soutenu par le suffrage de toute l’Écosse. Sa propre sœur, la reine Anne, régnait ainsi sur un royaume écartelé entre les Hautes Terres écossaises et l’Irlande martyre.
Le Royaume-Uni ne représentait en rien le « pré Carré » français. L’encre d’Utrecht n’était point encore sèche que Louis XIV vit les Celtes et les Britanniques, les catholiques et les protestants légitimistes se rebeller contre les « Houses of Parliament », dont Montesquieu deviendra le thuriféraire. Ils feront couler des fleuves de sang lorsque Louis XV les appuiera.
La légitimité mise en péril par les banquiers et la classe nobiliaire
Deux morts royales et la question de la légitimité
Deux morts royales vont placer le problème de la légitimité au premier rang des préoccupations internationales.
Le 14 août 1714, la reine d’Angleterre, Anne Stuart, meurt à Londres. Sont-ce les Stuart, rois légitimes et anglais, qui lui succéderont ? ou au contraire l’électeur de Hanovre, choisi par le parti Whig, soutenu lui-même par les banquiers et les grands manufacturiers ?
Le 30 août 1715, Louis XIV meurt à son tour à Versailles. Est-ce un Bourbon qui lui succédera à Versailles en cas de mort du jeune Louis XV ? ou au contraire un prince cadet, Philippe d’Orléans, imposé lui-même par le parti Whig et soutenu par la classe nobiliaire française, écartée des affaires par le roi défunt ?
Les Whigs et les Orléans
Les hanovriens et les Orléans ont pour eux des papiers imposés par le parti Whig :
– pour le premier, le « Bill de Succession », écartant les Stuart du trône d’Angleterre ;
– pour les Orléans, le traité d’Utrecht enlevant la couronne de France aux Bourbons-Anjou.
Il suffisait donc au duc d’Orléans et au Parlement de Paris d’appliquer les clauses du traité d’Utrecht pour que les Bourbons légitimes fussent exclus du pouvoir en même temps que le seraient les Stuart d’Angleterre. Ainsi, de chaque côté du Channel, pourraient s’installer aux leviers de commande des hommes liés à deux types de classe dominante, soucieuses de s’enrichir très légalement par les nouvelles méthodes capitalistes, parfaitement indifférentes au suffrage universel des Nations.
L’Espagne et la Suède alliées contre l’Angleterre
Le capitalisme naissant suscite les réactions de Philippe V d’Espagne et Charles XII de Suède
Le capitalisme naissant en Angleterre servira le duc d’Orléans, mais suscitera d’immédiates réactions continentales pendant toute sa Régence. Elles furent conduites de 1715 à 1718 par deux souverains, Philippe V d’Espagne et Charles XII de Suède, s’appuyant chacun sur les conseils de deux étrangers :
– pour Philippe V, le cardinal italien Alberoni,
– pour Charles XII, le baron allemand Von Görtz.
L’un et l’autre luttaient contre Stanhope, chef du parti Whig, à qui sa large majorité parlementaire permettait de mener l’Angleterre souverainement.
La neutralisation de la puissance navale anglaise
À l’échelle continentale, Alberoni et Görtz, doués d’un esprit politique fécond en intrigues, articulèrent leur opposition contre le tsar Pierre Ier de Russie et l’empereur Charles VI d’Autriche. L’aspect de leur politique qui nous retiendra ici se limite à la neutralisation de la puissance navale anglaise. Le cardinal Alberoni l’a poursuivie d’abord en Méditerranée et le baron de Görtz dans la Baltique.
Leur lutte, très concertée, entrait dans le cadre général d’une opposition continentale ; mais c’est uniquement sa répercussion sur les terres celtiques de Bretagne et d’Écosse qui fixera notre attention pendant la décade 1714-1724.
Madrid et Stockholm observaient que la mort de la reine Stuart avait suscité un premier débarquement de Jacques III, et que celle de Louis XIV fut suivie d’un nouveau soulèvement sur les Hautes Terres écossaises. Bien qu’exilé par le régent en Lorraine, le Prétendant s’était rendu en Écosse dès 1715.
Pour libérer la baltique des infiltrations navales anglaises, le baron de Görtz pressa immédiatement le ministre de Suède à Londres, le comte de Gyllenborg, de soutenir par une conspiration une révolte anti-dynastique afin de confronter le parti Whig avec les dissensions intérieures de l’Angleterre.
Gyllenborg fut découvert et expulsé. Görtz se rendit alors à Deventer mais, repéré lui aussi par les agents anglais, il fut un temps emprisonné par les Hollandais. De cette subversion de l’Angleterre, méditée par la Suède, Voltaire disait lui-même : « C’était beaucoup de l’avoir commencée ».
En effet, la conspiration n’avait donné aucun résultat en raison des difficultés d’amener les Écossais à se discipliner eux-mêmes. Sur toutes les terres Celtiques, tant écossaises que bretonnes, l’opposition se montrera violente, mais son caractère passionnel la renfermait dans le domaine des chimères, plus romanesque que militaire.
Le cardinal Alberoni soutient la conjuration du marquis de Pontcallec
En même temps, le cardinal Alberoni soutenait en France deux complots distincts.
– À Paris, d’abord, il agissait, comme Görtz l’avait fait à Londres, par l’entremise commode d’un ambassadeur. Il chargea le prince de Cellamare de soutenir le mouvement anti-orléaniste. L’ambassadeur s’aboucha ainsi avec la duchesse du Maine. Au cas où mourrait le jeune Louis XV, elle favoriserait la prise de possession du trône de France par Philippe V.
– En Bretagne ensuite, Alberoni imprimait à la conjuration du marquis de Pontcallec —primitivement déclenchée pour le triomphe des « libertés bretonnes » — un ton nouveau.
Un pays vannetais traditionnellement engagé
Depuis toujours, la région, située autour de Vannes, était bien connue en Espagne.
– Récemment encore, le Vannetais avait représenté un point d’appui espagnol durant la Ligue.
– C’est devant son front de mer, en 1759, que l’amiral de Conflans subira la rupture d’une partie de sa flotte à la bataille des Cardinaux.
– Dans ses landes, Cadoudal établira sa résistance.
– A son voisinage, se déroulera la honteuse extermination de l’Armée Royale par Hoche en 1795.
– Lors du retour de l’île d’Elbe, c’est toujours de Vannes que partiront les éléments armés qui se mobilisèrent jusqu’à l’estocade finale de Waterloo.
– Quelques lustres plus tard, on y enregistrera toujours une adhésion instinctive à la dynastie légitime lors de la tentative de la duchesse de Berry.
Le cardinal Alberoni soutenait donc une conjuration dans un site géographique où se maintenait une opposition vivante. En 1718, elle s’appuyait sur un sentiment de la légitimité qui servait un des principes directeurs de la diplomatie européenne.
Philippe V d’Espagne et le cardinal Alberoni soutiennent les insurrections légitimistes écossaise et bretonne
C’est pourquoi, en mars, le cardinal avait prescrit au marquis de Berreti-Landi, son agent à La Haye, de reprendre, pour le compte de l’Espagne, le plan de débarquement sur les Hautes Terres d’Écosse. Depuis l’arrestation du baron de Görtz, la rébellion s’y trouvait, en effet, sans soutien extérieur.
Mais parallèlement, pour soutenir les Bretons, il décida de recevoir à Madrid le représentant de Pontcallec, le capitaine Hervieux de Mellac. Celui-ci, à deux reprises, se rendit de Bretagne à Madrid auprès du Cardinal. Naguère au service de la Hongrie sur le front de Turquie, l’émissaire breton avait participé dans les rangs des armées étrangères à des luttes qui ne pouvaient qu’élargir son horizon. Elles rattachaient le soulèvement breton, dont il était le messager à Madrid, au plan général dont la Cour espagnole tenait seule les données. Aux yeux de Philippe V, le cardinal engageait personnellement son autorité dans l’affaire Pontcallec.
Au moment où il faisait venir en Espagne Hervieux de Mellac, au printemps 1719, le cardinal pouvait encourager en toute sûreté, à partir de la façade atlantique de l’Espagne, les deux rebellions celtiques : la bretonne et l’écossaise.
Les escadres espagnoles en Méditerranée venaient de s’emparer sans coup férir de la Sardaigne et s’apprêtaient à appareiller vers la Sicile, inquiétant l’Autriche par le sud de l’Italie. Le succès du plan méditerranéen affermissait ainsi le crédit du cardinal, toujours suspect au clan espagnol italophobe. En tant qu’étranger, aucun échec ne lui serait pardonné. Les agents anglais n’auraient pas manqué d’exploiter à Madrid une maladresse pour provoquer son renvoi.
Philippe d’Orléans dans la Quadruple alliance
Stanhope, chef des Whigs, face à la stratégie du cardinal d’Alberoni
Stanhope à Londres, se trouvait maintenant dans l’incapacité de combattre de front une si vaste intrigue. Il ne pouvait employer des moyens politiques normaux pour renverser le plan d’Alberoni. Celui-ci agissait en Baltique et en Méditerranée tout en maintenant soigneusement la paix avec l’Angleterre. Ses menées en Écosse et en Bretagne ne faisaient qu’y soutenir, devant l’Europe, des mouvements intérieurs luttant contre l’oppression, pour leurs libertés.
Cet ensemble d’actions très cohérentes évitaient de provoquer le moindre incident qui eut amené Stanhope à déclarer la guerre à l’Espagne. Chaque secteur de son plan demeurait autonome. Dans les mains du cardinal, la Bretagne ne représentait qu’un des pions qu’il ferait mouvoir selon les alternatives d’une partie plus générale, à la mesure de l’échiquier européen.
La réponse de Stanhope : la Quadruple Alliance
C’est pour se donner le moyen d’agresser l’Espagne en utilisant le Régent que Stanhope fit signer à Cockpit, le 2 août 1718, la Quadruple Alliance.
– Par ce traité, le régent Philippe d’Orléans entrait officiellement dans la coalition anti-Bourbon formée par l’Angleterre, la Hollande et l’Autriche.
– L’empereur Charles VI, menacé par la Sicile, entra, de son côté, dans la combinaison anglaise. Il est significatif que l’Autriche y reconnaissait, d’une part, la candidature des Orléans au trône de France, mais qu’elle prévoyait, d’autre part, qu’en cas de déshérence des Bourbon d’Espagne, les princes de Savoie régneraient à Madrid.
– L’Angleterre, combattant le principe de la légitimité en Europe, cherchait à disposer des trônes au gré de ses intérêts.
Le traité de la Quadruple Alliance ruinait la politique de Louis XIV et faisait des Orléans les obligés de l’Angleterre.
L’attentat de l’amiral Byng
Mais alors que le Régent s’engageait à Cockpit dans la croisade anti-Bourbon, le premier ministre Whig Stanhope arrivait à Madrid le 7 août pour des conversations pacifiques. Quatre jours plus tard, alors qu’Alberoni s’entretenait paisiblement avec lui, l’amiral Byng coulait, au cap Passaro, sans déclaration de guerre, la flotte espagnole cinglant de Sardaigne en Sicile. Alberoni essuyait ce forfait, calculé en toute tranquillité de conscience par le gouvernement anglais.
Le Régent déclare la guerre à son cousin Philippe V
L’impact de l’attentat de l’amiral Byng
Toute l’économie des plans écossais et breton s’en trouvait bouleversée, car le coup de l’amiral Byng se produisait au moment précis où le cardinal s’engageait sur l’Atlantique.
Son appui à Hervieux de Mellac perdrait donc de son ampleur, mais, plus encore, le soutien qu’il avait promis à l’Écosse.
Philippe V invite Jacques III en Espagne et arme d’une flotte pour l’Écosse
Sur son initiative, Philippe V avait invité le prétendant Jacques III en Espagne et prenait ainsi position devant toute l’Europe. Il lui avait donné à Valladolid une splendide résidence qui le dédommageait de celle de Saint-Germain-en-Laye, inutilisée depuis que le duc d’Orléans avait pris le pouvoir.
De son côté, le duc d’Ormond avait été élevé au rang de capitaine général espagnol, tandis qu’une flotte de dix vaisseaux de guerre et de transport formait escadre sur l’Atlantique. Alberoni l’avait voulue forte de six mille hommes de troupe et armée pour équiper un corps de 12 000 maquisards écossais. Placée sous les ordres de Don Blas de Loya, cette armée constituait une puissante force d’intervention en Angleterre. Mais les agents anglais se trouvaient informés de tous ces préparatifs dans les ports atlantiques de l’Espagne.
Philippe d’Orléans déclare la guerre à Philippe V
C’est pourquoi, après l’attentat de l’amiral Byng, au cap Passaro, le Régent dût immédiatement acquitter sa dette envers l’Angleterre. Exploitant la découverte du complot Cellamare, il déclara la guerre à Philippe V. Lui aussi agissait en homme très informé.
Commandée par le maréchal de Berwick, fils naturel de Jacques II, l’armée française campa, le 10 mars 1719, près de Bayonne. Le prétendant Jacques III se trouvait de l’autre côté de la Bidassoa, à la veille du départ de l’escadre qui allait relancer en Angleterre l’insurrection légitimiste.
La stratégie d’Alberoni mise à mal
Le 21 avril, les troupes françaises franchirent le petit cours d’eau, incendièrent méthodiquement les arsenaux de la marine, les docks, et saccagèrent les chantiers de construction espagnols.
À l’entrée de la Manche, une série de tempêtes empêchèrent l’escadre du duc d’Ormond de poursuivre jusqu’en Écosse.
Tant donc en Sicile que dans le secteur de la Manche, si vital pour les entreprises d’Écosse et de Bretagne, la flotte espagnole était réduite à l’impuissance.
Au début de 1719, le crédit du cardinal se trouvait donc symétriquement ébranlé sur mer par l’attentat de l’amiral Byng, et, sur terre, par l’agression de Philippe d’Orléans. Alberoni ne pouvait soutenir le marquis de Pontcallec qu’avec la plus extrême prudence. La guerre, déclarée par le Régent, avait affaibli les bases de ravitaillement et d’accueil de l’escadre du duc d’Ormond.
Un soutien, verbal, de l’Espagne aux conjurés bretons
La réception d’Hervieux de Mellac en 1719
En 1719, Alberoni reçut donc Hervieux de Mellac, mais dans des conditions toutes différentes de celles qui eussent été envisagées avant le désastre de Passaro.
L’émissaire breton arrivait à Madrid après une conférence réunie le mois précédent dans les landes de Lanvaux. Dans cette réunion, passablement romantique, les conjurés n’avaient pu établir leur plan de campagne. Par là, ils offraient eux-mêmes au cardinal une raison de demeurer encore plus réticent dans son appui à la Bretagne. À un degré voisin des Écossais, les Bretons se montraient incapables de se donner des structures de combat.
En entendant Hervieux de Mellac, le ministre jugea du peu de consistance de la conjuration du marquis de Pontcallec. Bien que déjà engagé dans les filets du Régent, elle passionnait cependant une partie de la Bretagne.
Les désastres accablent Alberoni
Les désastres entouraient maintenant Alberoni :
– perte de la flotte de Sicile,
– invasion de l’Espagne par l’armée française,
– blocage de la flotte du duc d’Ormond dans la Manche,
– engagement décisif de Charles XII contre la Norvège,
– négociation encore indécise du baron de Gërtz qui évoquait, en tête-à-tête avec l’empereur de Russie, les problèmes de l’Écosse.
Avertis de conversations si dangereuses pour eux, les Anglais travaillaient à Stockholm à détrôner Charles XII et à éliminer son puissant conseiller.
Au milieu de cette incertitude, le cardinal ne pouvait se compromettre davantage en Bretagne avec un mouvement dépourvu d’organisation. Philippe V était maintenant loin de le suivre dans cette voie.
La lettre de Philippe V aux Bretons
Le capitaine Hervieux de Mellac ne revint pas cependant les mains vides au château de Kergrois en Locminé où l’attendait, en juillet 1719, l’état-major de Pontcallec. Aux chefs de la conjuration, il apportait une lettre du roi Bourbon :
le Sieur de Mellac Hervieux, écrivait Philippe V aux Bretons, m’a apporté des propositions de la part de la Noblesse de Bretagne, concernant l’intérêt des deux couronnes (France et Espagne). Je m’en remets à ce que le dit sieur leur dira sur cela de ma part. Mais je les assure ici moi-même que je leur sais très bon gré du glorieux parti qu’ils prennent et que je les soutiendrai de mon mieux, ravi de pouvoir marquer l’estime que je fais de sujets aussi fidèles du Roi, mon neveu (Louis XV), dont je veux le bien et la gloire. — Au camp de San Esteban, le 22 juin 1719.
Signé Philippe.
La lettre ne promettait rien. Philippe V donnait verbalement son accord à l’envoi de trois frégates. De la Corogne, ces unités rallieraient Santander pour embarquer une partie des munitions destinées à la Bretagne et se présenter devant Vannes. Là, elles prendraient contact avec les éclaireurs des conjurés.
Le Régent Philippe d’Orléans déjoue la conjuration de Pontcallec
À ce moment, la conspiration de Pontcallec se trouvait dans les mains de la police. Le Régent tenait maintenant tous les fils du complot breton. Alors que les frégates espagnoles se préparaient à appareiller pour la Bretagne, le duc d’Orléans créait à Nantes, le 30 octobre 1719, une Chambre Royale afin d’enquêter sur « les projets de traité avec une puissance étrangère ».
À la Toussaint, une frégate espagnole prit contact, dans les brouillards, au large de Vannes, avec deux émissaires de Pontcallec.
En novembre, la Chambre Royale commençait à rechercher les « traîtres ». Pour le Régent, il s’agissait d’une affaire criminelle ourdie en temps de guerre au bénéfice du Bourbon de Madrid. Son instruction se déroulera dans un cadre juridique autrement solennel que celui de l’affaire Cellamare.
Échecs des insurrections légitimistes en Bretagne et en Écosse
L’échec de l’insurrection jacobite et bretonne provoque la chute d’Alberoni
Le cardinal apprit à la fois l’échec de l’insurrection jacobite confiée au duc d’Ormond et celle de Pontcallec. Il avait tenu les réseaux d’une politique qui couvrait toute l’Europe.
Mais c’est son échec en Bretagne qui, pour Philippe V, représenta la goutte d’eau qui fit déborder le vase :
ce qui m’a perdu dans l’esprit de mes maîtres, écrivait le cardinal, c’est l’affaire de Bretagne. Elle ne m’inspirait aucune confiance. Pour en finir, et la faire échouer absolument, j’écrivis, sans la participation du Roi, une lettre à Don Blas de Laya que j’avais auprès du duc d’Ormond, et ces messieurs n’hésitèrent point à faire débarquer les troupes… C’est cette lettre, portée à leurs Majestés qui les a indignées contre moi et a achevé ma perte.
Stanhope obtint de Philippe V ce qu’il recherchait d’abord : le départ immédiat d’Alberoni.
En Suède, au cours de l’année 1718, les agents anglais avaient renversé la politique du baron de Görtz. Celui-ci, à la conférence des îles d’Aland, avait obtenu l’accord de Pierre le Grand pour la conquête de la Norvège sur le Danemark. Mais les Anglais savaient aussi qu’il s’était ouvert au tsar de l’entreprise sur l’Écosse. Dans le Nord, elle représentait un élément du plan concourant, dans le Sud, au succès de l’entreprise d’Alberoni.
La mort suspecte de Charles XII de Suède et son remplacement par une usurpatrice promue par l’Angleterre
C’est alors qu’en décembre de cette même année 1718, alors qu’il se rendait des îles d’Aland au siège de Frederikshall dirigé par Charles XII, Görtz apprit que le roi de Suède avait été frappé à mort en combattant.
Cette disparition parut étrange. D’un seul coup, elle renversa la politique suédoise. Des historiens ont indiqué que Charles XII fut tiré dans la tranchée par un mercenaire hessois. On sait les intérêts liant la Hesse à la dynastie hanovrienne d’Angleterre, intérêts renforcés par des liens de famille.
Le coup de mousquet, en décembre 1718, sur Charles XII et la chute d’Alberoni, en décembre 1719, laissaient, à un an de distance, les mains libres à l’Angleterre, tant au Nord qu’au Sud. Sur la façade atlantique, l’appui donné par Alberoni et Görtz aux conjurés Bretons et Écossais, s’effondrait.
Londres fit immédiatement monter sur le trône des Vasa une femme à sa dévotion. Ulrique-Éléonore ne put y parvenir qu’en usurpant les droits légitimes de son neveu, Charles-Frédéric de Gottorp.
Émergence en Europe de nouvelles monarchies sans légitimité placées par la classe bourgeoise
L’Europe comprit alors suivant quelle procédure pouvaient être attribués les trônes selon la volonté des classes liées au pouvoir de l’argent Le principe des « Renonciations » consistait, en effet, à introduire en Europe des Constitutions qui ne fussent pas fondées sur le droit naturel mais sur des fictions juridiques tranchant les liens liant Pouvoir et Nation.
L’oligarchie financière et marchande qui régnait à Londres voulait imposer sous le couvert d’idéologies parlementaires, des régimes dont les chefs demeureraient sous le contrôle de l’opinion, de l’argent, de l’étranger et représentés, comme sur la Tamise, par des « dynasties » d’aventure.
Ce complot médité contre les nations du Continent, l’Europe en aperçut le mécanisme à Stockholm. En haine du « Despotisme » de son frère Charles XII, la reine Ulrique-Éléonore dut bien préciser qu’elle était appelée, non par le droit dynastique, mais par l’« élection » du Sénat de Stockholm. Comme le nouveau monarque anglais, George Ier, la nouvelle reine suédoise incarnait un pouvoir placé tout entier dans les mains des féodaux modernes. Elle était un souverain sans autorité, régnant sans pouvoir gouverner.
Fidèle serviteur de Charles XII, le baron de Görtz fut déshonoré par un tribunal d’épuration « légal » et s’appuyant sur le principe de la rétroactivité des lois. Il n’eut pas l’autorisation de se défendre. Cette liberté, les paysans et les petits bourgeois suédois voulaient cependant qu’elle lui soit accordée, mais les possédants la lui refusèrent. Au nom de la nouvelle morale, la tête du baron de Görtz, condamné en Suède à une mort ignominieuse, fut tranchée le 11 mars 1719.
Celle du marquis de Pontcallec tomba à Nantes, un an plus tard, le 26 mars 1720.
Mort du Régent et renonciation de Philippe V à la Couronne d’Espagne
En 1724, c’est-à-dire cinq ans après le renvoi du cardinal Alberoni et le supplice du baron de Gôrtz — les deux « bêtes noires » des Whigs — quelle était la position des deux pays d’Europe : la France et l’Espagne ? Toutes deux avaient maintenu, contre l’Angleterre, le principe de la légitimité.
Les morts de Stanhope et du Régent affaiblissent les oppositions anti-dynastiques
Stanhope, chef du parti Whig, était mort en février 1721 au milieu du scandale de la Compagnie des Mers du Sud qui compromettait son parti.
Le Régent avait été frappé d’apoplexie en 1723 sans voir l’ouverture du Congrès de Cambrai.
Mais, en Espagne, Philippe V régnait et se réservait toujours pour la Couronne de France. À Versailles, la santé de son neveu, le Roi Louis XV, provoquait sans cesse les mêmes alarmes et rendait l’avenir de l’Europe incertain.
Au Régent, venait de succéder, comme premier ministre, le duc de Bourbon, qui veillait au réveil toujours possible d’un orléanisme appuyé sur le parti Whig.
La mort du Régent provoqua à Madrid un vif soulagement. Non seulement se terminait une carrière qui avait permis à un prince d’Orléans de déclarer la guerre à un roi Bourbon, mais, à Paris, l’opposition anti-dynastique se trouvait privée pour un temps de tout soutien, hors le parti des ducs, dont Saint-Simon demeure une des plus belles parures.
La santé de Louis XV chancelante, Philippe V s’apprête à lui succéder en renonçant à la Couronne d’Espagne
Dès la mort du Régent, l’accession de Philippe V au trône de France ne dépendait plus que de la santé de Louis XV. Depuis des années, l’opinion envisageait avec réalisme la mort du jeune roi. Une lettre de la duchesse de Brancas traduit bien les appréhensions du public devant le souffle de vie qui animait Louis XV :
L’enfance de cet homme, écrit-elle plus tard, que vous voyez si beau, si fort maintenant, fut tellement longue et souffrante qu’elle semblait ne tenir qu’à un souffle. À peine si osait-on approcher de lui de peur d’arrêter sa respiration. Quand on pensait que les destinées de tant d’hommes, que le sort de la France dépendaient pourtant d’une existence si fragile, on éprouvait une sorte de terreur. On ne pensait pas, sans trembler, que le berceau d’un malheureux enfant put devenir d’un moment à l’autre le tombeau de la Monarchie entière et que des guerres civiles en puissent sortir.
C’est bien dans les perspectives de guerres civiles signalées en ce texte que se mouvait la diplomatie européenne.
La mort du Régent fut connue à Madrid au début de décembre 1723. En l’apprenant, Philippe V décida sans hésiter de renoncer immédiatement à la couronne d’Espagne. Sa femme, Élisabeth Farnèse, inspirée de toutes autres vues, appuya cette décision.
Le 10 janvier 1724, Philippe V abdiqua officiellement en faveur de son fils aîné qui régna sous le nom de Luis Ier.
Accueil de la renonciation de Philippe V à la Couronne espagnole en Europe et en France
Dans les cours européennes, ce changement de roi fit l’effet du tonnerre. Les puissances comprenaient bien que Philippe V n’abandonnait la Couronne d’Espagne que pour se rendre libre vis-à-vis de la France. Le marquis de Grimaldi avait prévu, dix ans plus tôt, que Philippe V garderait la Couronne d’Espagne et réserverait celle de France à l’Infant Don Luis. Mais depuis, les intérêts espagnols, notamment en Italie, sur laquelle veillait Élisabeth Farnèse, avaient bien évolué.
À Utrecht, Louis XIV s’était incliné pour faire une paix au moindre frais. Mais en 1724, l’Europe trouvait parfaitement normal que la France se donne un Roi suivant les lois immémoriales qui dépendaient, non pas du Roi, mais de la Nation et de ses coutumes constitutionnelles.
Du côté de la branche cadette, l’acquiescement fut absolu : aucune voix n’eut osé s’élever en sa faveur. Ses titres se trouvaient inscrits dans un document issu des malheurs de la Patrie, et aucun ne songeait à s’en prévaloir, pas plus d’ailleurs que le fils du Régent qui restait à la place que lui assignait sa naissance dans la Maison de Bourbon. À Versailles, Philippe V ne comptait que des amis — même Saint-Simon, naguère Conseiller du Régent, mais qui avait appris à connaître l’Aîné dynastique au cours de son Ambassade à Madrid — toute la Cour l’avait aimé lorsqu’il était duc d’Anjou. Personne ne le considérait en France comme étranger.
Le testament politique de Philippe V à son fils Luis Ier
Philippe V s’était fait édifier en 1721, sur les hauteurs de la Guadarama, une retraite lui rappelant Marly. Elle était achevée en 1723. C’est là, à San lldefonso, qu’il se retira au milieu de la fraîcheur et des eaux vives en attendant que le sort eût décidé si Louis XV vivrait ou non. Cinq semaines après la mort du Régent, le 14 janvier 1724, il envoya à son fils, le Roi Luis Ier, son testament politique :
Dieu, m’ayant fait connaître depuis quelques années par sa miséricorde infinie, mon très cher fils, le néant de ce monde et la vanité des grandeurs, et donné en même temps un grand désir des biens éternels, préférables sans nulle comparaison à tous ceux de la terre, qu’il ne nous a donnés que pour cette unique fin, j’ai cru ne pouvoir mieux répondre aux bontés d’un Père si bon qui m’appelle à son service et qui m’a donné dans toute ma vie tant de marques d’une protection visible sur moi, tant dans les maladies par lesquelles Il lui a plu de me visiter que dans les conjonctures de mon règne où Il m’a conservé et a protégé la Couronne contre tant de puissances liguées qui voulaient me l’arracher, qu’en Lui sacrifiant et mettant à Ses pieds cette même Couronne pour ne songer uniquement qu’à Le servir, à pleurer mes fautes passées et à me rendre moins indigne de paraître devant Lui, quand il Lui plaira de m’appeler à son jugement, bien plus redoutable pour les Rois que pour les autres hommes.
Songez que vous ne serez Roi que pour faire servir Dieu et pour rendre vos peuples heureux, que vous avez un Maître au dessus de vous.
Rendez justice également à tous vos sujets, tant grands que petits, sans acception de personnes ; protégez les derniers contre les violences et les extorsions qu’on voudrait leur faire, et remédiez aux vexations que les Indiens souffrent ; soulagez vos peuples autant que vous pourrez et suppléez en cela à ce que les temps difficiles de mon règne ne m’ont pas permis de faire.
L’unité organique de la Maison de Bourbon
Le règne éphémère de Luis Ier témoin du caractère irréformable de la Constitution de la Monarchie française
Luis Ier fut proclamé roi d’Espagne le 9 février 1724. Son ambassadeur au Congrès de Cambrai reçut de celui d’Autriche le décret donnant l’institution des États de Toscane de Parme et de Plaisance à l’Infant Don Carlos, son frère.
Ainsi s’installait à Madrid un règne reprenant fermement les données de la politique espagnole, mais affirmaient aussi devant l’Europe l’unité organique de la Maison de Bourbon.
Le jeu normal et irréformable de la Constitution française avait provoqué l’abdication du Chef dynastique en Espagne afin de le mettre à même de régner en France. Son fils avait pris calmement sa place à Madrid sous le nom significatif de Louis Ier. La décision n’avait soulevé aucun étonnement en Europe.
Aucun juriste ne préparait de réserve. Ni les « Renonciations », ni la branche cadette ne trouvaient de défenseurs au moment où l’héritier légitime attendait la mort de Louis XV pour se présenter à Versailles.
Louis Ier apparaît ainsi dans l’histoire comme un test de l’opinion européenne devant l’inanité pratique des « Renonciations » n’engageant ni la France, ni l’Espagne, malgré les papiers timbrés et les Cortès. Sa silhouette, lumineuse et fragile, telle qu’on la voit aujourd’hui au Prado, répond au même moment à celle de son cousin de Versailles.
Luis Ier et Louis XV, tous deux de sang Bourbon, avaient le même grand-père, Victor-Amédée de Savoie, leurs mères étant sœurs. Le premier avait 17 ans, le second 14 ans. Tous deux moururent de la même maladie, la petite vérole, mais Louis XV à un demi-siècle de son aîné. Luis Ier expira en effet, après 32 semaines de règne, le 31 avril 1724.
L’année suivante, à Versailles, au cours de la nuit du 18 février 1725, son cousin français eut un violent malaise, le dernier d’une enfance si menacée. Longtemps la mort du jeune Louis XV avait fait partie des calculs ordinaires des chancelleries. Le premier ministre, duc de Bourbon, accourut dans sa chambre et pensa que le jeune roi succomberait avant l’aube. De cette nuit d’angoisse, qui rameuta immédiatement la faction des Orléans, sortit la décision d’un mariage capable de rassurer l’opinion sur la pérennité de la Monarchie.
Le mariage de Louis XV
Louis XV avait quinze ans. Il pouvait physiquement faire échec, selon les lois de la nature, aux incertitudes provoquées dans les masses populaires par les « Renonciations » du Traité d’Utrecht. Il lui fallait seulement une princesse nubile. Marie Leszczynska fut choisie.
C’est ainsi que, quelques mois après la mort de Luis Ier et cette dernière alarme sur la santé de Louis XV, le principe de la légitimité se trouva assuré. Mais les Chancelleries européennes qui faisaient vivre le Droit international avaient montré la valeur qu’il fallait accorder aux clauses d’un traité qui prétendait bouleverser le fondement des libertés françaises. Un Roi de France, signant un traité avec l’étranger, ne pouvait jamais aliéner un droit sagement placé hors de sa portée parce qu’il demeurait gardé par son peuple.
Durant les quelques semaines où Luis Ier régna en Espagne, Philippe V s’était retiré à San Ildefonso. Il y apparaissait vêtu de bure brune, éclairée seulement du Cordon Bleu français et de la Toison d’Or. En dépit d’humiliantes dépressions nerveuses qui le torturaient, il n’hésita pas à dédoubler la fonction royale pour faire échec aux principes d’Utrecht aussi opposés à la Constitution espagnole qu’à la Constitution française. Le mariage de Louis XV rendit sans objet son opposition.
Philippe V reprit la Couronne d’Espagne. Tant à Madrid qu’à Versailles et à Stockholm, les « Renonciations » avaient mis en jeu la diplomatie d’un siècle fécond en ressources politiques.
Au sein de si vastes intrigues, elles passionnèrent, en leur temps, les vieilles terres de Bretagne et d’Écosse, si mystérieusement attachées à la Légitimité.
Paul del PERUGIA
- Pierre de la Condamine, Pontcallec, le fin mot de l´histoire, Édidions Yves Floch, 1988.↩