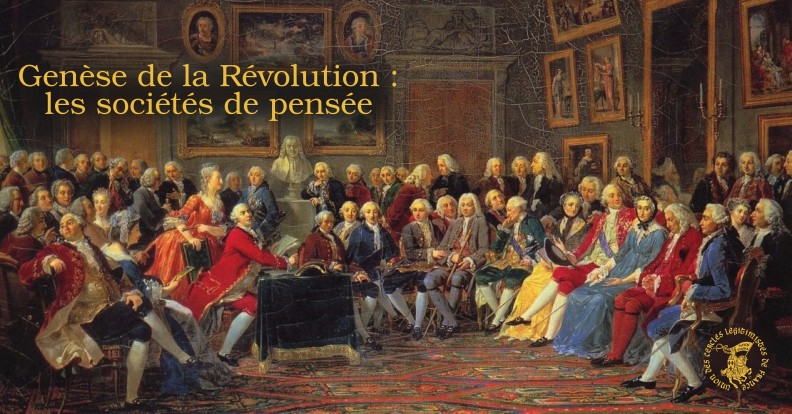Les sociétés de pensée n’ont a priori rien d’effrayant : tout d’abord loisir d’une haute aristocratie désœuvrée, elles se propagent ensuite à toutes les classes sociales et jusqu’aux plus petites villes. Rien de mal en effet : on s’y amuse à tout remettre en question, on y construit un monde imaginaire. Aucune autorité ne prévaut, aucune connaissance préalable sur le sujet abordé n’est requise, mais on y vote des motions qui refléteront la pensée moyenne du groupe et seront transmises aux autres sociétés sœurs. L’objet est d’y élaborer l’opinion publique, qui sera bientôt identifiée au « peuple », à la Nation. Elle ne souffrira plus alors aucune contradiction, et on glissera inexorablement dans la Terreur. [La Rédaction]
Table des matières
Préalable de viveleroy.net
Le texte suivant est la troisième partie du livre d’Antoine de Meaux Augustin Cochin et la genèse de la révolution1.
– Ire partie : Problématique à l’origine de l’œuvre d’Augustin Cochin.
– IIe partie : Genèse des sociétés de pensée.
– IIIe partie : Le mécanisme sociologique des sociétés de pensée.
– IVe partie : Les concepts fondamentaux des sociétés de pensées et de la modernité
Afin de faciliter la lecture en ligne, nous avons ajouté de nombreux titres — signalés par un astérisque (*) — qui ne figuraient pas dans le texte original.
En lisant Augustin Cochin
Une œuvre au formalisme difficile*
Abordons maintenant Augustin Cochin. On trouvera à la fin de ce volume la bibliographie de ses ouvrages. Au premier contact, le lecteur éprouvera sans doute quelque surprise des termes spéciaux fréquemment employés, quelque peine aussi à se reconnaître dans l’amoncellement des idées et des faits. Certaines phrases trop denses, toutes chargées d’incidentes parce que trop chargées de pensée, sont parfois pénibles à suivre.
Une œuvre qui identifie enfin le « on », le « peuple », ou la « nation » des historiens de la Révolution*
Cette difficulté une fois surmontée, tout s’illumine : une explication cohérente et logique surgit ; les actes déconcertants, les faits extraordinaires voient apparaître leurs causes, et les mouvements « spontanés » se trouvent pourvus d’antécédents.
« On » se personnifie et se situe ; la « nation », le « peuple », êtres anonymes et abstraits, se définissent et se délimitent. À travers le dédale des motions et des journées populaires, nous tenons enfin le « fil conducteur 2 ».
Avec Cochin, nous ne sommes plus en présence d’une histoire générale de la Révolution. Nous avons affaire à une conception particulière du phénomène révolutionnaire, exposée dans son ensemble, et étayée par des exemples historiques judicieusement choisis, et étudiés à fond.
Une œuvre qui éclaire singulièrement les autres travaux*
Une telle œuvre est d’un intérêt autrement puissant qu’une nouvelle synthèse : elle entreprend le défrichement, d’un champ d’exploration encore vierge, où l’auteur souhaitait bien souvent voir s’engager à sa suite d’autres chercheurs ; elle ouvre en outre, à travers la masse des faits déjà connus et utilisés, des perspectives jusqu’alors cachées, en introduisant un facteur nouveau qu’il est désormais impossible de négliger. Du coup les ouvrages déjà lus se transforment ; « tant de savantes et consciencieuses études » qui « sonnaient creux » 3 deviennent instructives et pleines de sens. L’œuvre du génial initiateur possède, en effet, une vertu qui lui est propre : elle jette un jour tout nouveau sur les œuvres connexes, elle les complète ou plutôt elle les éclaire ; elle agit comme un révélateur, et tout autre ouvrage, de quelque esprit qu’il s’inspire, ne peut que gagner en précision et en clarté à la lumière des idées de Cochin4.
Nous n’entreprendrons pas d’analyser ici l’ensemble de ces idées. Nous essayerons seulement de préciser quelques points, de poser quelques jalons, en vue d’amener le lecteur au seuil de l’édifice. Notre seul désir est de l’y voir pénétrer.
Les Principes. L’organe de propagation
Les nouveautés apportées par Cochin*
On peut dégager de l’œuvre d’Augustin Cochin trois points de vue fondamentaux.
– D’abord, en matière historique, la mise à jour de l’organe et du mécanisme de propagation des idées révolutionnaires.
– En second lieu, l’élaboration au sein de cet organe, et au moyen de ce mécanisme, d’une doctrine en perpétuelle évolution.
– Enfin, la synthèse de cette doctrine, depuis son origine philosophique jusqu’à son aboutissement révolutionnaire.
La Révolution n’est pas spontanée mais l’œuvre d’une « machine sociale »*
Dans le domaine des faits, toutes les recherches de Cochin aboutissent à une conclusion essentielle : la négation du mouvement spontané. La Révolution n’a été ni spontanée, ni de consentement unanime. Elle apparaît comme une œuvre préparée, organisée, artificielle, depuis le début jusqu’à la fin, depuis l’ère des philosophes jusqu’au règne des terroristes. C’est ainsi qu’en Bretagne la thèse du « peuple » alerté par le « bruit public » et s’assemblant spontanément (en 1788 et 89), pour délibérer sur « l’intérêt général », est à écarter :
Quelles que soient, dit Cochin, les causes profondes du mouvement, ces assemblées ont toutes une occasion immédiate… précise ; le « bruit public » est une mise en demeure par circulaire… de prendre connaissance de certains imprimés et d’y adhérer… L’enthousiasme attendit partout pour éclater l’arrivée des pièces de Rennes — et n’éclata pas, quand le courrier manqua. C’est là un fait général attesté par la teneur même de la plupart des arrêtés, prouvé par la date des autres. Nous sommes en présence, non d’un soulèvement spontané, mais d’une consultation populaire en règle, dirigée méthodiquement et à son heure par le pouvoir du jour : la machine sociale5.
La « machine sociale » ― ou « sociétés de pensée » ― diffuse les idées révolutionnaires*
Ces considérations s’appliquent à l’ensemble de la France et pendant toute la durée du phénomène : l’enfantement, puis la propagation, enfin la mise en pratique des idées révolutionnaires ont été l’œuvre de groupements particuliers, de réunions d’adeptes opérant entre eux d’abord, faisant pression sur le reste du pays ensuite. Cochin englobe tous ces groupements sous le nom générique de « Sociétés de pensée ». Nous constaterons plus loin l’exactitude de cette dénomination6.
Les sociétés de pensée pour créer une opinion publique artificielle*
Ces Sociétés, coteries de lettrés et de gentilshommes tout d’abord, associations diverses, loges maçonniques ensuite, clubs enfin, commencent à créer entre elles et bientôt constituent, à elles seules, l’opinion publique.
Elles parlent, puis agissent — non pas au nom de la France — mais comme étant elles-mêmes et seules la voix de la France. Elles forment — non pas un État dans l’État, car elles ne gouvernent rien — mais une nation dans la nation, et l’opinion artificielle ainsi créée s’impose au reste du pays tout à fait à son insu.
Caractère inédit de la machine et de son œuvre*
Cette opinion se propage dans le temps et dans l’espace, avec le fonctionnement à la fois aveugle et irrésistible d’un mécanisme, d’une machine ; c’est le mot qu’emploie constamment Cochin, peut-être avec trop d’insistance, notamment dans son ouvrage sur la Bretagne.
Toutefois, le mot ne fait rien à la chose, le phénomène est patent et sans précédent dans l’histoire. Sans doute, il y a eu beaucoup de révolutions politiques, sociales, religieuses, mais la Révolution en soi, établie en permanence, la Révolution à l’état de fin et non de moyen, ne s’était encore jamais vue : le « révolutionnaire » est un produit du dix-huitième siècle7.
Origine et développement des sociétés
Les sociétés de pensée n’émergent que dans une société de haut de degré de civilisation*
Ainsi donc, la formation et le développement d’un milieu « social » particulier fut la condition primordiale de l’emprise philosophique et révolutionnaire. Ce milieu ne pouvait se constituer que dans un vaste État, unifié, pacifié intérieurement pour une longue période et parvenu à un haut degré de civilisation. C’est Rousseau lui-même qui déclare dans le Contrat social que « l’abondance et la paix » sont nécessaires pour « instituer un peuple » ; (nous verrons plus loin ce qu’il faut entendre par cette expression).
Semblable condition était réalisée par la monarchie française depuis Louis XIV. Grâce aux loisirs et à l’absence de tout souci immédiat d’existence qui en résulte pour les classes élevées, la vie de société prend un essor sans précédent, et des facilités jusqu’alors inconnues s’offrent au commerce des idées.
Le divertissement en apparence anodin d’une haute aristocratie désœuvrée*
Le mouvement commence donc d’une façon bien anodine, dès la régence et même dans les années qui précèdent, par des conversations de salon, des réunions de petits groupes de grands personnages et de gens de lettres, tel le fameux club de l’Entresol.
Ce qui me gêne, dit Cochin, c’est de ramener ces effrayantes conséquences (les atrocités de la Terreur) au tout petit fait qui les explique, si banal, si menu : causer. Là est pourtant l’essentiel 8.
Bien des historiens ont décrit l’oisiveté de l’aristocratie, dépouillée de ses fonctions naturelles, amenée dès lors pour se distraire à la recherche exclusive du plaisir sous toutes ses formes, plaisir des sens et plaisir de l’esprit, le libertinage des mœurs associé au libertinage de la pensée, l’un portant l’autre9. Dès avant Taine, un petit livre oublié signale la « triomphante alliance des libres penseurs et des libres viveurs », l’amitié de Voltaire et du maréchal de Richelieu10.
Propagation aux autres classes sociales et dans tout le Pays*
Le goût des choses de l’esprit ne devait pas rester longtemps confiné dans quelques cénacles de haute aristocratie et de lettrés notoires. La mode se propage et gagne de proche en proche, à Paris, en province, dans la haute puis dans la moyenne bourgeoisie, principalement chez les gens de robe ; c’est alors que commencent à se former les « Sociétés » : chambres de lecture, sociétés littéraires, académies provinciales, comme celle de Dijon qui met au concours les sujets traités par Rousseau, enfin les loges maçonniques.
Dès 1750, ces sociétés diverses commencent à se répandre à travers le pays, elles établissent entre elles des relations régulières et permanentes ; elles couvrent ainsi la France d’un réseau aux mailles de plus en plus serrées.
De l’élaboration des idées révolutionnaires à l’effort progressif de leur mise en pratique*
Nous pénétrons ici dans le domaine de Cochin, et dans la partie la plus connue de ses travaux. Nous pouvons donc passer rapidement, et nous nous contenterons de marquer une distinction entre deux périodes.
– La première est d’ordre purement théorique : c’est l’époque où s’élaborent les doctrines, les travaux des pères de la Révolution, l’époque de la diffusion et de l’échange des idées pures ; d’après M. Roustan, les intellectuels établissent leur prédominance vers 1760 et forment ce qu’il appelle le « clergé laïc »11.
– La deuxième période est celle de la préparation effective, de l’adaptation des théories en vue de leur mise en pratique. Cette seconde phase commence dans les quinze ou vingt dernières années qui précèdent 1789. Ici, d’après le récent ouvrage de M. Gaston Martin12, c’est la Maçonnerie qui entre en scène, et prend le rôle principal, après l’établissement du Grand-Orient (1773).
Du rôle important, mais non exclusif de la Maçonnerie*
Les historiens de cette secte13 nous renseignent sur son origine anglaise et son passage en France dès le début du dix-huitième siècle, probablement en 1732. Après quarante ans de tâtonnements et de rivalités, le Grand-Orient se constitue en 1773 et ne tarde pas à prendre le dessus. Il entreprend aussitôt le travail de coordination, d’adaptation pratique des idées philosophiques, et il le fait de main de maître : l’emprise maçonnique pénètre jusque dans les plus humbles localités : M. Lantoine estime à huit cent vingt-cinq le nombre des loges des deux obédiences (Grand-Orient et Grande-Loge) existant en France dès 1777.
Il faut ajouter que les autres groupements n’en subsistent pas moins ; il s’en fonde même de nouveaux aux abords immédiats de la Révolution, surtout dans la jeunesse : « jeunes-gens », « jeunes-citoyens », « sociétés patriotiques », où se distinguent les militants14 et qui seront l’embryon des clubs.
Dans l’idée de Cochin, il faut bien le spécifier, la Maçonnerie ne tient qu’une partie dans l’orchestre philosophique, partie importante assurément, mais nullement unique.
De 1769 à 1780, on voit sortir de terre des centaines de petites sociétés… cachant mal des visées politiques sous des prétextes officiels de science, de bienfaisance ou de plaisir : sociétés académiques, littéraires, patriotiques, musées, lycées, sociétés d’agriculture même15.
Finalement, il n’est « pas une bourgade » qui n’ait sa société, et toutes ces associations « fédérées, animées du même esprit, concourent au même grand œuvre16. » On peut dire qu’à la veille de 89, tout le pays est intoxiqué de « sociomanie », s’il est permis de forger un néologisme barbare pour qualifier la diffusion de ce microbe social précédemment inconnu17.
Caractère des sociétés
Qu’est-ce qu’une société de pensée ?*
Il convient maintenant de préciser le caractère essentiel de tout organisme « social ». Qu’est-ce qu’une société de pensée ?
On peut la définir, répond Cochin, une association fondée sans autre objet que de dégager par des discussions, de fixer par des votes, de répandre par correspondance l’opinion commune de ses membres18. C’est une société formée en dehors de toute préoccupation d’œuvre, de travail réel, on est là pour parler, non pour agir19.
De quoi parle-t-on ? De tout ce qui se dit et s’écrit.
Les chambres de lecture reçoivent les ouvrages, les mémoires ou libelles venus de la capitale.
Elles seules assurent, du reste, aux écrivains un public.
Les membres des sociétés communiquent les lettres de leurs correspondants, et les commentaires font l’objet du « travail », terme consacré, qui veut dire, ici, parole.
Tous ces gentilshommes, ecclésiastiques, hommes de loi, négociants, qui se réunissent fraternellement en « égaux », dans chaque cité petite ou grande, discutent et pérorent ; puis, une fois les loges organisées, ils présentent ou reçoivent des motions, les développent et les critiquent, les votent et les transmettent.
Les sujets abordés*
Or, les beaux esprits de Paris et, à leur suite, les disciples de province, abordent tous les sujets, des plus légers aux plus graves.
Tout est matière de discussion : théologie ou morale, art ou littérature, physique ou métaphysique, économie nationale, structure des sociétés, gouvernement des États.
Tout ce qui touche de près ou de loin à ces divers objets est dénommé « philosophie », et tout homme qui adhère aux idées propagées devient un « philosophe », depuis le romancier Marmontel, le musicien Rameau, par exemple, jusqu’au dernier adepte d’une société de bourgade. « Il y a des philosophes jusque dans les échoppes », dit Voltaire ; ces derniers ont la foi du charbonnier20.
Bien entendu, saint Thomas ou Bossuet, s’ils se présentaient à la porte du temple, seraient éconduits comme il sied. Ils ne sont pas, eux, des « philosophes » selon Voltaire. Il n’est que de s’entendre sur le sens des mots.
Où est le mal de refaire le monde en riant de tout ce qui fonde la vie morale et sociale ?*
Paris ne dicte pas seulement le choix des sujets, mais impose également le ton de la discussion, ton ironique et léger, selon le goût du jour. Dès lors, toutes les bases de l’ordre social, toutes les convictions qui étayent la vie morale sont sapées et démolies comme en se jouant. D’ailleurs, se demande Cochin, où serait le mal ? Ce n’est effectivement qu’un jeu.
Il en est de la monarchie française depuis Louis XIV comme de l’Empire romain aux premiers siècles. L’édifice paraît si solide que l’existence même de l’État, les assises de la société sont hors de question dans la pratique. Tout cela existe de soi, et pour un temps indéfini. Il est donc tout loisible de se distraire en philosophant.
On ne manque pas à Dieu, au roi, au soin de ses affaires parce qu’on s’amuse à discuter quelques heures chaque soir, en philosophe. L’adepte est homme d’église, d’épée, de finance, qu’importe ? Il y aura un jour, une heure, chaque semaine où il oubliera ses ouailles, ses soldats, ses affaires, pour jouer au philosophe et au citoyen, quitte à rentrer ensuite dans son être réel où il aura bientôt fait de retrouver ses devoirs et ses intérêts aussi21.
Ainsi donc les sociétés créent, dit encore Cochin, une République idéale en marge de la vraie, un petit État à l’image du grand, à une seule différence près : il n’est pas réel. Les décisions prises ne sont que des vœux, et (fait capital) les adeptes n’ont ni intérêt personnel, ni responsabilité engagée dans les affaires dont ils parlent22.
Établissement d’une société irréelle, construite sur le papier par des irresponsables, telle est la matière du travail dans les sociétés de pensée. Et ce caractère fondamental commandera inéluctablement toute la suite des événements.
Quand l’utopie est prise au sérieux*
En effet, après les sceptiques et les plaisantins de haute allure, viendront les bourgeois épais et positifs qui prennent, eux, les choses au sérieux. Ils rechercheront les moyens de faire passer dans la pratique les belles théories de MM. Mably ou Rousseau, qu’on leur a appris à admirer. Ils élaboreront des plans de constitution, des projets de transformations politiques ou sociales ; l’affaire se gâte.
Toutefois, tant qu’il ne s’agit encore que de discours ou de brochures, de propositions non suivies d’effet, les conséquences ne sont pas immédiatement sensibles et il n’y a encore que demi-mal : « Le papier souffre tout », disait la grande Catherine à Diderot.
Plier le réel à l’idéologie jusqu’à la Terreur*
C’est lorsqu’il faudra passer de l’exposé verbal à l’application réelle, du jeu de la parole aux difficultés de l’action, que les lois naturelles, les faits se mettront en travers. Mais alors, les frères et adeptes, ou plutôt leurs successeurs, les « patriotes » et le « peuple » des sans-culottes, n’admettront pas cette opposition : ils ont appris de Rousseau que tout le mal provient de la société mal bâtie23. Les faits ont tort contre les principes ; la machine devra donc marcher coûte que coûte, envers et contre tous ; et dès lors, il faudra pousser jusqu’à la Terreur.
C’est là toute l’histoire de la Révolution proprement dite. La thèse des « circonstances », chère aux défenseurs du régime révolutionnaire, n’est qu’une manière particulière d’envisager l’antagonisme irréductible entre l’idéologie des gouvernants et la logique des faits. Tel est aussi l’objet du grand recueil des Actes du gouvernement révolutionnaire. Dans sa préface, Cochin cite une série d’exemples frappants : « Les marchés se garnissent mal ; la Convention décrète… qu’on ne vendra plus le grain que là : à l’instant, les marchés se vident », et ainsi de suite24.
Continuité du phénomène
Filiation directe entre clubs philosophiques, Révolution de 1793 et Terreur de 1793*
De l’exposé qui précède une première conclusion découle, c’est qu’il n’y a aucune solution de continuité, encore moins une opposition quelconque entre le philosophisme et son succédané révolutionnaire. L’un est simplement l’application de l’autre. Mais doctrine et méthodes sont les mêmes.
On découvrirait dans les sociétés philosophiques de 1785, dit Cochin, le même engrenage, les mêmes procédés que dans les sociétés populaires de 179425.
Voici le témoignage d’un contemporain :
C’est de vos temples, mes très chers frères, et de ceux de la véritable philosophie qu’est partie l’étincelle qui, à travers toute la France, a embrasé les cœurs de tous les citoyens.
Ainsi s’exprime Corbin de Pontbriand à la parfaite Union de Rennes, le 23 juillet 178926. Cent ans après, un rapport au convent maçonnique de 1883 lui fait écho : « La Révolution était faite en loge, avant d’être un fait accompli », dit l’auteur de ce document27.
à l’avènement de la Révolution, la Maçonnerie peut s’effacer devant les Comités et les Clubs, puis disparaître en 179328. Elle a accompli son « travail » et peut « tomber en sommeil ». Des équipes successives poursuivront la même œuvre, sous d’autres vocables.
La Révolution est un bloc avec une même loi de fonctionnement*
Cette idée de continuité appliquée à la Révolution détruit l’opposition entre les « bons » principes de 89 et leur sanglante déviation en 93, les « généreux » députés de la Constituante et les sinistres proconsuls de la Terreur. Cette thèse était chère à nos pères, et les descendants d’éminents parlementaires d’autrefois ont toute raison de la saluer avec respect, mais elle est historiquement insoutenable. Taine précédait déjà son ennemi, M. Aulard, dans cette affirmation ; leur successeur l’établit définitivement.
Le quatre-vingt-neufisme, dit Cochin, est une position sage peut-être en politique, indéfendable en histoire.
Et il raille cette littérature historique « mesurée, sensée, libérale, dérisoire, qui, depuis cent ans, corrige, atténue l’effrayant souvenir29. »
La Révolution est un bloc, suivant la formule célèbre. « Sans doute, le mode — au niveau moral, qualité du personnel, nature des actes, lettre des doctrines — a changé. Mais la loi reste la même, et les frères polis et poudrés de 89 y obéissent avec la même rigueur et la même inconscience que les frères grossiers et crasseux de 9325. »
- Augustin Cochin et la genèse de la révolution, Librairie Plon, 4e série, Paris, 1928, pp. 21-39.↩
- C’est le terme très juste employé par un critique de conviction opposée, mais fort compréhensif, M. G. Martin, dans sa brochure : Augustin Cochin et la Révolution.↩
- Les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne, tome Ier, p. 289.↩
- C’est ainsi, par exemple, que le grand ouvrage d’Augustin Cochin les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne peut utilement s’encadrer entre l’étude antérieure de M. Barthélémy Pocquet, Les Origines de la Révolution en Bretagne (Paris, Perrin, 1885), et la thèse récente de M. l’abbé Pommeret, l’Esprit public dans le département des Côtes-du-Nord pendant la Révolution. (Saint-Brieuc, René Prud’homme, 1921.) Cochin appréciait ainsi l’ouvrage de M. Pocquet : « Étude exacte et complète, mais extérieure pour ainsi dire, qui s’en tient à une description bien vue et bien menée de la parade patriote. » (Les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne, tome Ier, p. 153.) Cette appréciation rend bien compte de la différence de points de vue.↩
- Les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne, tome Ier, pp. 365-366.↩
- On dit en octobre 1788 que les parlementaires sont vaincus d’avance parce qu’ils sont « chassés de toutes les sociétés »… On parle de « l’opinion des sociétés… » On dit en 1792 : « La société de telle ville. » R. L., Introduction, p. XXVII.↩
- Sur le mot « révolutionnaire », cf. Les Sociétés de pensée et la démocratie, p. 79.↩
- Les Sociétés de pensée et la démocratie, p. 8.↩
- Cf. notamment dans l’Ancien régime de Taine, livre III, chap. II, et livre IV, chap. I-III (Malesherbes, MmeRoland, Saint-Just.)↩
- La Révolution et l’Empire, par le vicomte de Meaux (1868).↩
- M. Roustan, les Philosophes et la Révolution française. (Lyon, 1906.)↩
- G. Martin, la Franc-maçonnerie française et la préparation de la Révolution. (Paris, 1926.)↩
- Sur la franc-maçonnerie, au dix-huitième siècle, cf. entre autres : G. Bord, la Franc-maçonnerie en France, dont le tome Ierseul existe (Paris, 1908) ; — Émile Lesueur, la Franc-maçonnerie au dix-huitième siècle (Thèse de doctorat, Paris, 1914) ; — Albert Lantoine, Histoire de la franc-maçonnerie française (Paris, 1926).↩
- Par exemple, le futur général Moreau à la tête des « Jeunes-Gens » de Rennes.↩
- La Révolution et la libre pensée, Introduction, p. xxviii.↩
- Les Sociétés de pensée et la démocratie, p. 217.↩
- Dans son ouvrage sur la Bretagne, Augustin Cochin décrit, par le menu, les organismes locaux et leurs agissements au cours de la période de préparation immédiate de la Révolution. Dans le tome II, il donne la liste des loges, sociétés littéraires, puis des comités, corps, députations, etc., enfin la liste des « patriotes » de Rennes.
Les comités se juxtaposent ou se substituent aux autorités régulières ; leurs membres, au début de la Révolution, s’emparent des municipalités ou leur imposent leur tutelle. (Cf. ci-dessus, p. 16, citation Sagnac.) M. Pommeret, qui ne s’inspire aucunement des idées de Cochin, décrit ainsi le fonctionnement de cette vaste machine, dans les premiers mois de la Constituante : « Du salon breton où ils se réunissent pour concerter une action commune, les représentants de la Bretagne dirigent en même temps les efforts de leurs partisans dans la province. Les correspondances des municipalités et des comités entre eux contribuent encore à cette unité de vues. Nul ne prend une décision, une délibération ou un vœu de quelque importance sans le communiquer aussitôt aux villes voisines qui, gagnées par la contagion de l’exemple, l’adoptent, et parfois renchérissent sur les mesures proposées. Ainsi se forme comme une immense toile d’araignée dont les fils, divergeant de Versailles sur toutes les cités bretonnes, sont encore reliés entre eux, de sorte que toute impulsion, en quelque lieu qu’elle soit donnée, se transmet dans tous les sens et est ressentie partout. » (Pommeret, op. cit., p. 60.)↩ - La Révolution et la libre pensée, p. 7.↩
- Les Sociétés de pensée et la démocratie, p. 9.↩
- Les Sociétés de pensée et la démocratie, p. 4. Tels par exemple, le serrurier « la Lime », le menuisier Maillot, le traiteur Charvel, trois « philosophes » chargés d’endoctriner la petite troupe recrutée par le meneur Kervelegan, pour tenir l’emploi de « peuple », lors des troubles de 1788, en Bretagne. (B. 1, p. 147.)↩
- Les Sociétés de pensée et la démocratie, p. 12.↩
- La Révolution et la libre pensée, Introduction, p. xxx.↩
- Cf. Les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne, tome Ier, p. 215.↩
- Les Sociétés de pensée et la démocratie, p. 151.↩
- Les Sociétés de pensée et la démocratie, p. 103.↩↩
- Les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne, tome Ier, p. 37, note 1.↩
- Les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne, tome Ier, p. 37, note 2.↩
- Le dernier vestige du Grand-Orient : la Chambre d’administration, se sépare le 13 mai 1793 pour ne ressusciter que trois ans plus tard, le 7 juin 1796. (Lantoine, Histoire de la franc-maçonnerie française, p. 74.)↩
- Les Sociétés de pensée et la démocratie, pp. 131 et 105.↩