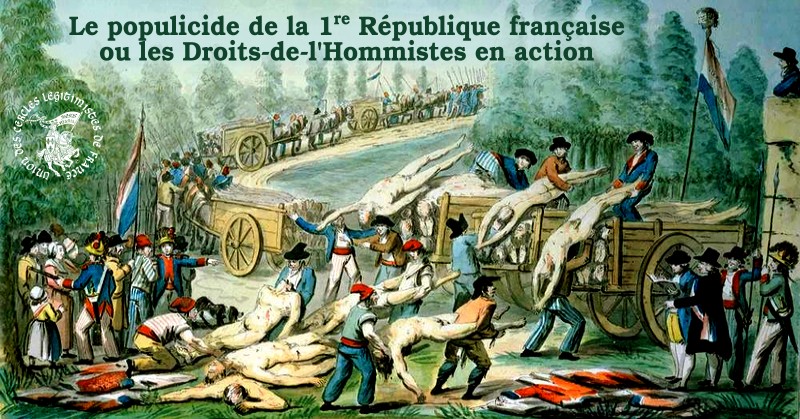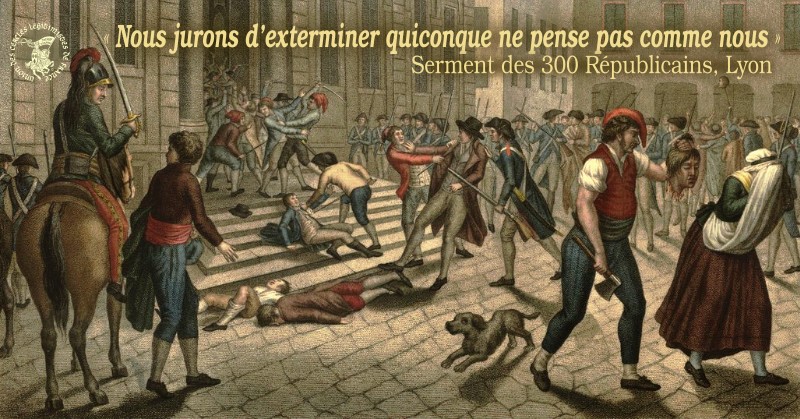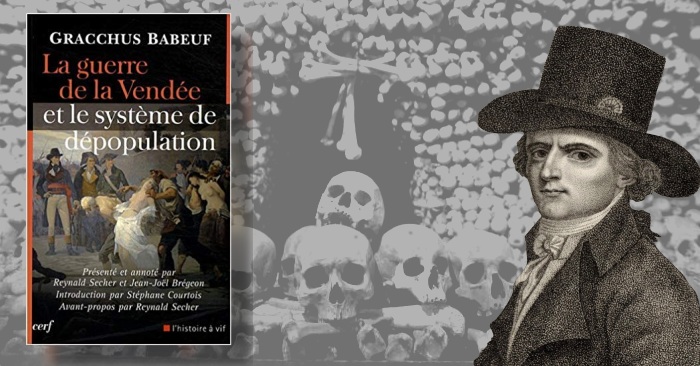Terreur
La terreur cherche à « stabiliser » les hommes en vue de libérer les forces de la Nature ou de l’Histoire. C’est ce mouvement qui distingue dans le genre humain les ennemis contre lesquels libre cours est donné à la terreur ; et aucun acte libre, qu’il soit d’hostilité ou de sympathie, ne peut être toléré, qui viendrait faire obstacle à l’élimination de l’« ennemi objectif » de l’Histoire ou de la Nature, de la classe ou de la race.
Culpabilité et innocence deviennent des notions dépourvues de sens: « coupable » est celui qui fait obstacle au progrès naturel ou historique, par quoi condamnation a été portée des « races inférieures », des individus « inaptes à vivre », des « classes agonisantes et des peuples décadents ».
La terreur exécute ces jugements, et devant son tribunal, toutes les parties en cause sont subjectivement innocentes : les victimes parce qu’elles n’ont rien fait contre ce système, et les meurtriers parce qu’ils n’ont pas vraiment commis de meurtre mais ont exécuté une sentence de mort prononcée par une instance supérieure.
Les dirigeants eux-mêmes ne prétendent pas être justes ou sages, mais seulement exécuter les lois historiques ou naturelles ; ils n’appliquent pas des lois, mais réalisent un mouvement conformément à la loi qui lui est inhérente. La terreur est légalité si la loi du mouvement est une force surhumaine, la Nature ou l’Histoire.
Hannah Arendt, Le Système totalitaire, Les origines du totalitarisme, chap. IV, Gallimard, col. Points, Paris, 2002, p. 289.
Il y aurait à écrire, de ce point de vue, une histoire de la gauche intellectuelle française par rapport à la révolution soviétique, pour montrer que le phénomène stalinien s’y est enraciné dans une tradition jacobine simplement déplacée (la double idée d’un commencement de l’histoire et d’une nation-pilote a été réinvestie sur le phénomène soviétique) ; et que, pendant une longue période, qui est loin d’être close, la notion de déviation par rapport à une origine restée pure a permis de sauver la valeur suréminente de l’idée de Révolution. C’est ce double verrouillage qui a commencé à sauter : d’abord parce qu’en devenant la référence historique fondamentale de l’expérience soviétique, l’œuvre de Soljenitsyne a posé partout la question du Goulag au plus profond du dessein révolutionnaire ; il est alors inévitable que l’exemple russe revienne frapper comme un boomerang son « origine » française. En 1920, Mathiez justifiait la violence bolchevique par le précédent français, au nom de circonstances comparables. Aujourd’hui, le Goulag conduit à repenser la Terreur, en vertu d’une identité dans le projet. Les deux révolutions restent liées ; mais il y a un demi-siècle, elles étaient systématiquement absoutes dans l’excuse tirée des « circonstances », c’est-à-dire de phénomènes extérieurs et étrangers à leur nature. Aujourd’hui, elles sont accusées au contraire d’être consubstantiellement des systèmes de contrainte méticuleuse sur les corps et sur les esprits. Le privilège exorbitant de l’idée de révolution, qui consistait à être hors d’atteinte de toute critique interne, est donc en train de perdre sa valeur d’évidence. (p. 28, 29)
Toutes les situations d’extrême péril national ne portent pas les peuples à la Terreur révolutionnaire. Et si cette Terreur révolutionnaire, dans la France de la guerre contre les rois, a toujours ce péril comme justification elle-même, elle s’exerce, en fait, indépendamment de la situation militaire : les massacres « sauvages » de septembre 1792 ont lieu après la prise de Longwy, mais la « grande Terreur » gouvernementale et robespierriste du printemps 94 coupe ses têtes alors que la situation militaire est redressée. Le vrai est que la Terreur fait partie de l’idéologie révolutionnaire, et que celle-ci, constitutive de l’action et de la politique de cette époque, surinvestit le sens des « circonstances » qu’elle contribue largement à faire naître. (p. 105)
François Furet, Penser la Révolution française, Gallimard, col. Folio histoire, Paris, 1978.