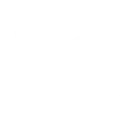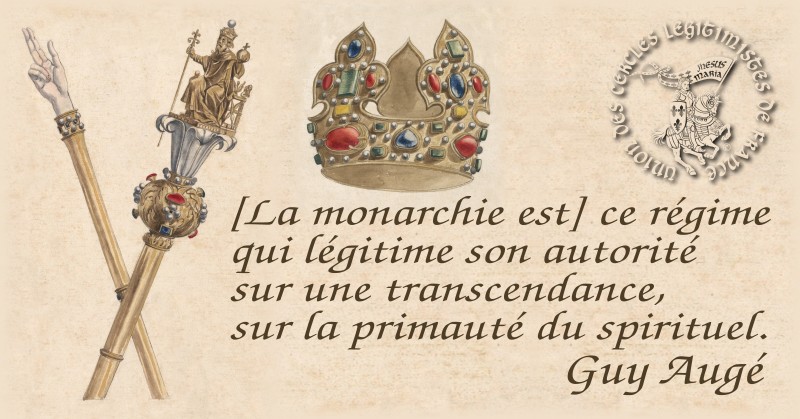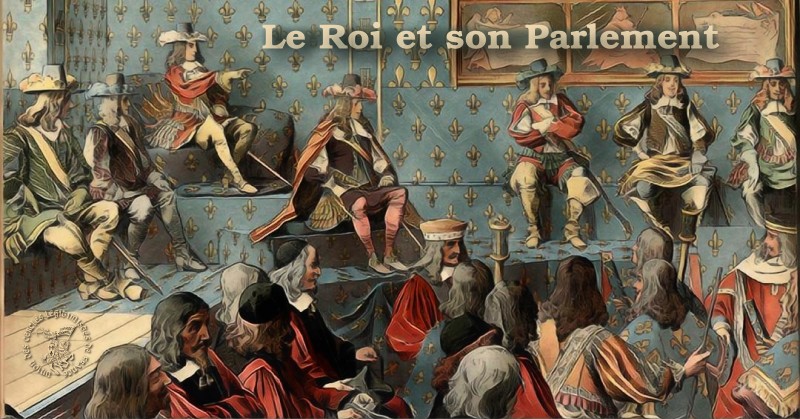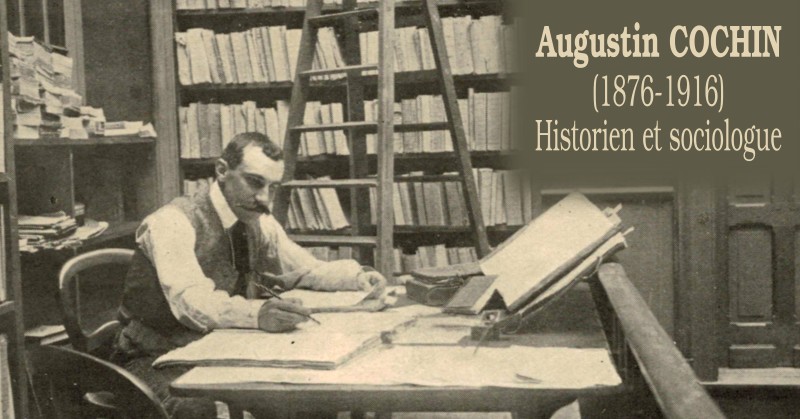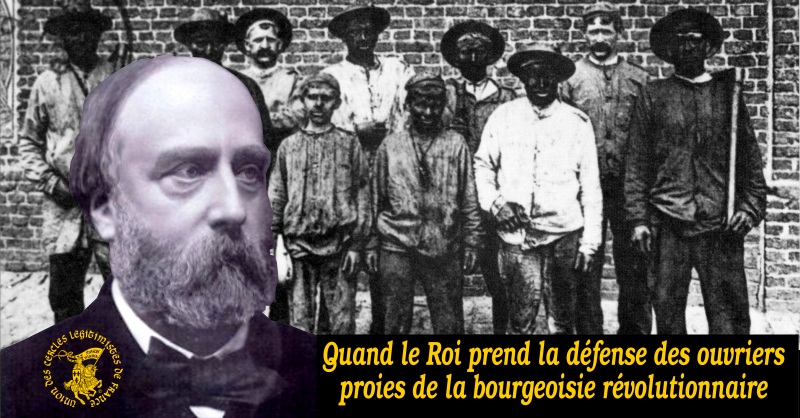Qu’est-ce que la monarchie ? par Guy Augé La monarchie dans la tradition politique occidentale (1992)
Quelle est la situation de la monarchie dans la philosophie politique ? Quel est le modèle historique de la monarchie française, et enfin, quel est son héritage ? Telles sont les questions abordées par Guy Augé dans cette remarquable synthèse.